03/11/2006
Mariage gay et équilibre social
François, du Swissroll a relayé hier un article intéressant sur l’impact qu’a le mariage gay sur le mariage hétérosexuel, et sur la famille. Pour faire très court, l’idée est que, loin de remettre en cause la sacro-sainte organisation de la famille avec le père, la mère et les enfants, le mariage gay est en fait un facteur de renforcement de la valeur du mariage et de la notion de famille.
Les commentaires à l’article de François sont assez intéressants aussi, notamment celui d’Authueil, qui dit en substance que c’est parfaitement logique puisque les gays en se mariant, montrent l’attrait que le mariage (tout court) représente pour un couple, quelque soit son orientation sexuelle, et un autre commentateur (au nom trop long) indique qu’il s’agit en fait là de l’illustration de la démarche mimétique des gays vis-à-vis de ce qu’il appelle « l’esthétisme bourgeois ».
Ces deux commentaires m’intéressent beaucoup, j’adhère complètement à celui d’Authueil, et le second, bien qu’un peu dur, voit quelque chose d’assez juste. Mais ils ne vont pas assez loin dans leur idée pour tout dire, et il passe à côté de l’analyse la plus intéressante qu’on peut faire de ce phénomène (enfin ce n’est que mon avis remarquez…). Je ne vais pas faire un billet trop long ici, mais plus tracer quelques lignes de réflexion qui méritent à mon avis plus d’attention.
La première, et ici j’avance prudemment car pour produire quelque chose d’un peu clair je suis obligé de caricaturer, rejoins une idée que j’ai déjà évoquée il y a quelques temps sur ce blog. En gros cette tendance provient de la nécessité d’équilibrage de la position sociale que les gays pensent avoir.
Ils ont encore bien malheureusement raison lorsqu’ils disent qu’ils font encore l’objet de discriminations. Par discrimination j’entends le fait qu’une personne, en parlant d’eux, ou encore plus simplement en pensant à eux, va inclure dans les éléments de sa réflexion l’orientation sexuelle des gays comme un élément d’analyse parmi d’autres. Je remarque sur ce point que ce processus est plus ou moins conscient chez la personne, et surtout, plus ou moins assumé. La discrimination naît dés cet instant où ce paramètre entre en jeu dans « l’évaluation » de la personne homosexuelle et de ses actes.
Je crois moi aussi que ce type de réaction reste très répandu, et pour être franc je ne suis pas surpris que l’évolution soit lente dans les sociétés de tradition patriarcale. Mais donc, cela génère un sentiment de discrimination bien compréhensible chez les gays. Cette discrimination peut d’ailleurs prendre des détours très sinueux. Il me semble assez évident qu’il existe une discrimination passive non négligeable qui est elle aussi une source de mal-être chez les gays. On la désigne couramment sous l’expression « la pression de la société », mais c’est plus précisément l’ensemble des apprentissages fait par un individu, qui vont à l’encontre de l’expression de sa sexualité comme une expression neutre d’un point de vue moral.
Pour être plus clair, c’est le gosse dont le père exerce une autorité mâle et virile sur la famille et qui ne s’abstient pas de quelques rires sarcastiques lorsqu’il croise un homme peut-être efféminé. L’enfant grandit avec une image salie de l’homosexualité, comme s’il s’agissait là d’une anormalité, d’une déviance à laquelle il aura rattaché une valeur sociale, et plus généralement, morale, négative. Le dilemme de la sortie de l’adolescence et de la découverte de sa sexualité dans un cadre sain est alors immense. Nombreux sont ceux qui adoptent alors une attitude de déni, afin de ne pas « tromper » l’image « saine » que leur entourage a construit d’eux. Le drame de l’étiquette collée au front et dont on ne veut pas soi-même prendre le risque de se séparer.
Mais je bifurque là. Revenons à nos moutons (…). La difficulté, face à cette situation, est de rétablir une situation d’équilibre social. Je l’ai déjà indiqué dans le billet référencé plus haut, nous cherchons tous à tout moment à maintenir notre équilibre, notre homéostasie, on pourrait même dire : nous cherchons tous à maintenir à tout moment l’image de normalité que pensons-nous les autres se sont fait de nous (je remarque rapidement ici, que dans le fond, on se sent « normal » lorsqu’on se sait accepté).
Les gays font face à une situation particulière. Leur orientation sexuelle dit-on, ne leur ouvre pas de voix « naturelle » au mariage. Ce serait contre nature. Ce raisonnement est évidemment une erreur profonde. Car en quoi le mariage procède-t-il d’un quelconque processus « naturel » ? Peut-on me dire ce que l’établissement d’un contrat moral entre deux personnes (tu me seras fidèle, je te serais fidèle) et d’un contrat civil a à faire avec la nature ? Le mariage est exclusivement affaire de culture sociale. Rien d’autre. Et une culture sociale comme son nom l’indique, n’est pas naturelle, elle est culturelle, c'est-à-dire construite, fabriquée sur la base de jugements de valeur valables pour un groupe donné, à une époque donnée, dans un environnement donné. Si le mariage était réellement d’essence naturelle, alors son mécanisme pourrait avoir valeur d’universalité. On se rend bien compte à la lueur de la courte analyse qu’on vient de produire (et qui est bien suffisante) qu’il n’en est rien.
Mais je bifurque encore. Pour répondre donc à ce déséquilibre, les gays ont besoin de compenser d’une certaine façon. Je n’aime pas beaucoup ce terme parce qu’il est souvent accompagné de mauvais sous-entendus, mais je n’en trouve pas vraiment d’autres. Afin donc de rétablir leur orientation sexuelle dans le champ d’une orientation « normale », les gays font comme beaucoup d’entre nous dans d’autres situation : ne pouvant agir sur la substance de la chose (et pour cause, on ne peut pas demander à quelqu’un de « décider » de changer d’orientation sexuelle !), ils agissent sur les signes extérieurs qui, aux yeux de trop nombreuses personnes, et ça va durer encore des siècles comme ça, rendent compte de la substance. Dans cette démarche, vouloir accéder au mariage est évidemment une étape reine. C’est un des signes de normalité sociale les plus forts. Et ce n’est pas qu’une question pour les homosexuels d’ailleurs, les célibataires endurcis, quelque soit leur sexe, ressentent très certainement une « pression sociale » assez proche.
Je voulais poursuivre ce billet avec une deuxième réflexion sur la notion de conformisme, mais je ne vais malheureusement pas avoir le temps. La semaine prochaine, promis.
19:21 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (11) | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2006
Sa raison d'être
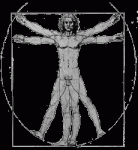 Le point de départ, me semble-t-il, de toute la réflexion de Laborit, tient en une phrase synthétique : l’être n’a pas d’autre raison d’être que d’être. Ce que cela veut dire, c’est que l’activité de notre organisme est toute entière dédiée à assurer sa propre conservation dans le temps. Il travaille à tout moment à maintenir ou à retrouver son équilibre, et à faire en sorte qu’il se maintienne dans le temps. Cannon parlait pour désigner cet état que nous recherchons d’homéostasie, Freud évoquait le principe de plaisir, et Claude Bernard indiquait qu’il s’agissait là d’assurer « la constance des conditions de vie dans notre milieu intérieur ».
Le point de départ, me semble-t-il, de toute la réflexion de Laborit, tient en une phrase synthétique : l’être n’a pas d’autre raison d’être que d’être. Ce que cela veut dire, c’est que l’activité de notre organisme est toute entière dédiée à assurer sa propre conservation dans le temps. Il travaille à tout moment à maintenir ou à retrouver son équilibre, et à faire en sorte qu’il se maintienne dans le temps. Cannon parlait pour désigner cet état que nous recherchons d’homéostasie, Freud évoquait le principe de plaisir, et Claude Bernard indiquait qu’il s’agissait là d’assurer « la constance des conditions de vie dans notre milieu intérieur ».
J’aime bien cette dernière formulation, car elle permet d’envisager les choses de façon très globale. On comprend effectivement à travers elle, que l’équilibre recherché ne concerne pas simplement nos cellules ou nos organes considéré chacun isolément, mais qu’il est un état global qui concerne chaque élément qui nous constitue en tant qu’il participe au tout, à l’ensemble, au système pourrait-on dire, que nous sommes.
On comprend qu’il ne s’agit donc pas que d’un équilibre physiologique, mais également psychologique, ou pour dire cela de façon plus juste, que cet équilibre dépend autant du physiologique que du psychologique. L’un ne va pas sans l’autre. Cela permet de mieux saisir l’importance de notre construction psychologique dans le maintien de notre santé. Nos croyances, nos valeurs, affectent notre ressenti et nos sentiments à chaque moment de notre vie, et nous avons besoin de conserver dans ces aspects la même stabilité que celle recherchée par nos cellules.
C’est pour cela qu’il est fondamentalement mauvais d’agir à l’encontre de ses propres valeurs. Une des sources de stress en entreprise est notamment le fait d’exercer une activité qui nous amène à aller contre nos valeurs. Travailler dans une entreprise d’armement si l’on est pacifiste, chez un producteur de tabac si l’on est anti-tabac, ou, quelque soit le secteur, travailler pour un patron malhonnête. Celui qui se trouve obligé de poursuivre chez un tel employeur allant ainsi à l’encontre de ses propres valeurs génère en lui un déséquilibre qui nuit à l’équilibre de l’ensemble, et est donc susceptible d’aboutir à la maladie.
C’est aussi exactement ça qui intervient dans le déni. Afin de préserver son équilibre psychologique, la personne qui a mal agit finit par nier la réalité de ce qu’elle fait. Elle ne le nie pas de façon mensongère, ce qui signifierait qu’elle resterait consciente de son mensonge, et donc qu’elle n’apporterait pas de solution à son déséquilibre, mais bien de façon parfaitement sincère, c’est-à-dire qu’elle est elle-même persuadée de n’avoir rien fait de mal, ce qui est la seule possibilité de faire perdurer son harmonie intérieure.
Il y a quelques temps, j’avais indiqué chez clic (malheureusement son blog, tentative, n’existe plus) qu’on pouvait trouver là une idée permettant d’expliquer, en partie, le syndrome de Stockholm. Les personnes séquestrées sont mises en situation de très fort déséquilibre. Elles sont l’objet d’une agressivité très forte qui les met en péril. Leur psychisme notamment est attaqué et fait que même si elles ne sont pas brutalisées, elles se sentent mal. Elles ont alors besoin de rétablir l’équilibre psychologique perdu.
 Pour cela elles ont besoin de s’auto-persuader qu’elles ne vivent pas une expérience « anormale », mais que d’une certaine façon, tout est dans l’ordre. C’est cette perception d’anormalité qui crée le déséquilibre. Dés lors les victimes vont entrer dans un processus de déni de la réalité, et vont construire une représentation qui redonnera à celle-ci les apparences de la normalité. Pour ce faire, les victimes prennent le contre-pied de la réalité de l’action de leur persécuteur, et se persuader que celui-ci est dans le fond un homme bien. Ils procèdent comme avec une balance de Roberval et mettent sur un plateau un poids similaire à celui qu’il y a sur l’autre, mais qui s’oppose à lui. Et ainsi ils obtiennent l’équilibre.
Pour cela elles ont besoin de s’auto-persuader qu’elles ne vivent pas une expérience « anormale », mais que d’une certaine façon, tout est dans l’ordre. C’est cette perception d’anormalité qui crée le déséquilibre. Dés lors les victimes vont entrer dans un processus de déni de la réalité, et vont construire une représentation qui redonnera à celle-ci les apparences de la normalité. Pour ce faire, les victimes prennent le contre-pied de la réalité de l’action de leur persécuteur, et se persuader que celui-ci est dans le fond un homme bien. Ils procèdent comme avec une balance de Roberval et mettent sur un plateau un poids similaire à celui qu’il y a sur l’autre, mais qui s’oppose à lui. Et ainsi ils obtiennent l’équilibre.
Mais revenons-en à notre propos initial. Ce qui est intéressant à observer dans les organismes vivants, c’est donc qu’on constate la profonde interdépendance qu’entretient chaque partie avec le tout, et le tout avec chaque partie. Si l’un défaille, il remet en cause l’équilibre des autres et de l’ensemble. Laborit, pour bien en rendre compte, compare l’homme à la machine. Un ordinateur, fonctionne grâce au courant électrique, et à l’information qu’il contient. S’il ne contient pas d’information, il n’a pas de fonctionnement, et s’il n’a pas de courant, il s’arrête. Mais dans ce cas, il ne perd pas les informations qu’il a pu stocker avant. Et il suffit de le rebrancher pour qu’il fonctionne à nouveau.
Chez l’homme, cela est impossible. Toute sa structure fonctionnant comme un tout qui assure à chaque moment la pérennité de l’ensemble et celle de chaque élément qui la constitue, il est inenvisageable de lui couper sa source d’énergie (qui est l’énergie solaire). On remarquera toutefois, que notre organisme change au cours du temps : nous grandissons, nos cheveux changent de couleurs, nos cellules se renouvellent, etc. Mais ce qui reste invariable, c’est la structure qui soutien l’ensemble, c’est-à-dire les relations qu’entretiennent entre elles les parties de l’ensemble. La finalité d’un organisme vivant, dit Laborit, est le maintien de sa structure. On comprend bien avec cette formulation que l’équilibre de l’organisme vivant ne peut donc qu’être atteint que si chaque partie assure son équilibre, contribuant ainsi à assurer l’équilibre de l’ensemble, et si l’ensemble agit pour contribuer à l’équilibre de ses parties.
Il faut bien mesurer l’importance de cette idée, et l’impact qu’elle a sur la compréhension de nos comportements. Notre propre finalité est d’abord de maintenir notre homéostasie. Ce n’est pas de devenir avocat, médecin, mère, de voyager en Australie, d’offrir la soupe populaire, etc. Préalablement à toutes nos actions, quel qu’elles soient, il y a ce besoin auquel nous répondons de maintenir notre équilibre interne. Quand on a bien compris ce que cela implique, on se dégrise de pas mal de fausses idées sur soi-même.
13:10 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2006
Automatismes acquis, mes chéris
Le dernier commentaire de DG me donne l’occasion de revenir sur la question des comportements inconscients de façon plus détaillée que précédemment. Je n’entends pas répondre au début de son commentaire, qui me semble plus devoir être adressé à Koz qu’à moi, mais sur son étonnement devant le chiffre de 90% que j’ai indiqué comme étant la part de nos comportements inconscients.
En préambule, je voudrais faire deux remarques sur ce point. La première, c’est que ce chiffre ne constitue pas le résultat d’une quelconque mesure scientifique précise suite à une étude spécifique sur le sujet. Il est celui qui fut indiqué lors de l’émission Rayon X qui portait sur la question du cerveau, et que j’ai indiqué dans mon billet, et je note que ce chiffre ne fut remis en cause par aucun des scientifiques présents sur le plateau de l’émission, tous venant d’horizons relativement variés bien que leurs disciplines soient toutes en relation avec le cerveau.
Laborit de son côté, avance le chiffre de 99%. Je ne saurai dire lequel est le plus proche de la vérité, mais l’idée générale qu’ils cherchent à faire passer c’est que quoi qu’il en soit, c’est bien la très grande majorité de nos comportements qui sont aujourd’hui inconscients. Ce point est d’ailleurs un dada de Laborit, ce qui peut expliquer qu’il exagère légèrement sur le chiffre, puisque l’un de ses objectifs principaux est de parvenir à faire sortir l’homme de l’ignorance qu’il a de son déterminisme biologique et de l’impact de l’animal qui est resté en lui, même si ça n’est pas bon pour son orgueil.
Ma deuxième remarque préalable, c’est que ce chiffre de 90% ne doit pas, être pris comme une mesure absolue qui se vérifie chez chaque individu. C’est bien évidemment une sorte de moyenne, qui cherche plus à rendre compte d’une réalité générale qu’autre chose. Il est possible qu’on trouve des individus qui présentent un répartition plus équilibrée entre comportements conscients et inconscients, mais on peut d’ores et déjà parier qu’ils seront très minoritaires. Et que leur étude ne pourrait donc pas remettre en cause la théorie générale avancée.
L’introduction est terminée, venons-en au corps de ce billet. Pour bien se rendre compte de l’importance de nos comportements inconscients, voyons d’abord d’où ils viennent. En gros on en trouve deux types : nos comportements innés, issus de notre mémoire génétique, ceux qui répondent à nos besoins fondamentaux. Laborit les nomme « réflexes innés ». Et ceux que nous construisons nous-mêmes petit à petit en fonction de nos expériences, de nos sensations lors de tel ou tel événement, et que nous gravons dans notre mémoire affective. Laborit les appelle « réflexes acquis ».
Alors d’abord, quid des réflexes innés ? Sur ce point, il faut bien dire qu’il souffre tout de même peu de contradiction. On serait en effet bien présomptueux de se prétendre apte à commander et/ou modifier l’information contenue dans nos gènes. Cette mémoire de l’espèce qu’ils contiennent, et qui commande directement nos comportements lorsque nous avons faim, soif, sommeil, etc. n’est nullement une mémoire sur laquelle nous pouvons agir afin de la détourner de son objectif premier. On remarquera d’ailleurs que c’est tant mieux, puisque cet objectif est d’abord de nous maintenir en vie.
Ah, mais j’entends des protestations dans l’assistance. On me dit que pourtant, nous sommes bien capables de nous abstenir de manger pendant plusieurs jours alors que notre organisme nous réclame sa pitance , ou de nous retenir d’aller aux toilettes alors que l’envie s’en fait pressante. J’ose balayer cette objection d’un revers de main en faisant, là aussi, deux remarques. La première c’est que ce type de comportement visant à contenir nos pulsions innées est rare. Oui, oui, je sais, tout le monde l’a fait une fois dans sa vie, voire plusieurs, mais sur l’ensemble des occasions dans lesquelles nous devons répondre à ces pulsions, nous le faisons très majoritairement en satisfaisant notre envie plutôt qu’en la frustrant. Et quelqu’un qui agirait ainsi contre ses envies de façon récurrente, serait soit un type bien barré, soit un chercheur. On n’en croise pas à tous les coins de rue.
La deuxième, et la plus importante, c’est que ces refus de répondre aux appels de notre corps ne peuvent évidemment qu’être limités dans le temps. Il n’est pas besoin de développer sur ce point puisqu’il est évident. Et cette limitation dans le temps rend en quelque sorte caduque le raisonnement qui viserait à démontrer qu’on peut dominer sa mémoire biologique, puisque quoi qu’il en soit c’est toujours elle in fine qui prend le dessus.
Mais là une deuxième objection est soulevée. On me dit que mon explication est hors-sujet, car peu importe que nous soyons effectivement prisonniers de ces besoins fondamentaux, cela ne nous rend pas moins conscients de leur existence, et lorsque nous mangeons un steak, nous sommes bien conscients que nous le mangeons. Cette objection est plus subtile que la première, je remercie la personne qui l’a soulevée, car elle va nous permettre d’approfondir notre analyse, mais je ne la félicite pas, car si elle avait bien lu mon blog, elle ne l’aurait pas faite.
Il y a en effet méprise ici sur la notion d’inné. Car en aucun cas le fait de lever sa fourchette pour porter le morceau de steak à sa bouche ne relève de l’action de notre mémoire génétique. Nous ne sommes pas là dans le cas d’un réflexe inné, mais d’un réflexe acquis, qui provient de l’apprentissage que nous avons fait des techniques permettant de manger. En revanche, ce qui est bien inné, c’est la salive qui nous est venue à la bouche lorsque nous avons eu en tête l’image du steak saignant qui nous attendait dans notre assiette. Ce réflexe atavique est lui issu de fonctionnement biologique dont nous n’avons absolument pas conscience. Nous ne sentons pas en nous nos hormones et nos influx nerveux agir. Tout ce que nous pouvons sentir, ce ne sont que les effets terminaux de leur activité : nous marchons, nous mangeons, etc. Mais le processus qui les engendre nous reste parfaitement impalpable.
Venons-en maintenant au plus intéressant : nos réflexes acquis, qu’on peut aussi appeler automatismes acquis. Ces automatismes, ont l’a déjà montré précédemment (cf. lien précédent), sont issus de nos apprentissages, de nos expériences et de la façon dont nous avons intégré celles-ci dans nos parcours personnels. Ils viennent de notre mémoire émotionnelle, par laquelle nous gravons en nous los impressions liées aux événements auxquels nous sommes confrontés. Notons ici que ces événements peuvent être parfaitement bénins, ou perçus comme tel, pas besoin qu’ils sortent de l’ordinaire pour que nous les utilisions ensuite pour sculpter notre mémoire.
Ces automatismes acquis vont intervenir dans à peu près tout ce que nous faisons chaque jour. Pour s’en convaincre, il suffit de dérouler le fil d’une journée. Le matin, quand nous sommes encore un peu endormis, ils sont quasiment omniprésents. Ce sont eux qui nous font enfiler nos chaussettes toujours dans le même ordre, mettre la table de la même façon, aller au même rythme, arriver au boulot à la même heure, etc. Dans la journée d’ailleurs, certains de ces automatismes évidents surgissent encore : la pause café, l’heure du déjeuner, les personnes auxquelles on parle en priorité, les exemples sont encore multiples.
On les retrouve encore dans un tas de petits détails qui constituent nos tics de comportements ou de langage. On ne les perçoit pas toujours bien, et certains sont parfois un peu étranges, mais ils sont nombreux. Moi par exemple, j’en suis bourré : quand je parle à quelqu’un debout, je croise très souvent les mains derrière mon dos, j’appuie avec un doigt sur l’autre, j’enchevêtre mes ongles alternativement les uns aux dessus des autres, je penche la tête vers la gauche, je lève le sourcil gauche, je me gratte le lobe de l’oreille, bref vous voyez, j’en ai à la pelle (et arrêtez de rire, c’est vexant enfin).
Demandez-vous d’ailleurs pourquoi quand vous marchez vous avez telle démarche plutôt que telle autre. Et si vous vouliez en changer, pensez-vous que cela vous serait facile ? Elle est faite de tant de détails qu’il serait à mon avis bien compliqué de parvenir à la transformer complètement. Et pourtant, chacun des détails que vous ne sauriez modifier témoignerait de la profondeur de l’inconscience que vous en avez.
Pour terminer sur ces exemples, nous pouvons reprendre la dernière remarque faite par DG dans son commentaire, concernant la réflexion qu’elle a eut pendant le laps de temps de la lecture de mon billet et de la rédaction de son commentaire. DG semble supposer que le seul fait de réfléchir et de penser extrait de ce que l’on désigne par comportements inconscients. Pourtant, même la réflexion, bien qu’elle puisse paraître comme une activité éminemment consciente, recèle elle aussi une grande partie d’éléments inconscients. Il suffit de remarquer que lorsque nous réfléchissons, nous n’arrêtons pas l’activité de nos sens. Nos yeux, nos oreilles, notre nez, tous nos sens restent bien actifs et continuent de recueillir les informations venant de l’extérieur et de les intégrer. C’est ainsi qu’alors que nous philosopherons sur le sens de notre vie, la vue du tableau pendu au mur du salon nous fera songer que peut-être l’art peut constituer un objectif en soi. Pourtant, absorbés que nous serons dans nos pensées, nous ne nous apercevrons pas nécessairement que c’est la vision, quasi subliminale, du tableau en question, qui a amené le mot art dans notre pensée. Et on comprend ainsi qu’il y a bien une part inconsciente qui vient habiter nos réflexions.
En fait, pour sortir véritablement de ces automatismes acquis, il faut être capable d’opérer de façon réellement originale par rapport à ce que nous avons appris, et d’imaginer une solution nouvelle pour apporter une réponse à la situation vécue. Pour cela, on utilise les cellules nerveuses contenues dans la masse orbito-frontale de notre cerveau, cellules qui sont purement associatives. Ces cellules nous permettent, à partir des informations enregistrées et liées à différentes choses, de lier ces informations, et d’obtenir par ce travail associatif un résultat original, d’imaginer quelque chose de nouveau. C’est grâce à cette capacité que l’homme a commencé à fabriquer des outils, qu’il est devenu scientifique, en procédant par hypothèse et en faisant des tests.
Mais cette faculté, n’est pas si fréquemment mise à contribution. Si l’on la mesure par rapport à ce dont est fait une journée, on s’aperçoit bien que la part où nous l’utilisons est très minoritaire par rapport au reste. Ainsi le chiffre de 90% de comportements inconscients paraît avancé précédemment paraît tout à fait plausible.
Je voudrais terminer en indiquant que l’on aurait tort d’être trop méprisant envers ces automatismes acquis. Certes ils ne sont peut-être pas ce qui relève de l’activité cérébrale la plus noble et que nous voudrions chaque jour mettre en avant, mais ils présentent toutefois de grands avantages, que nous allons réhabiliter.
Tout d’abord, Laborit souligne qu’une société ne saurait se bâtir sans faire appel à ces automatismes. Lorsqu’elle établit des lois par exemple, elle entend bien que chacun s’y plie, et, lorsqu’une personne est en situation de commettre un larcin, si ses valeurs et ses expériences passées pouvaient provoquer en elle le sentiment d’un malaise corporel devant l’éventualité d’enfreindre la loi, cela permettrait probablement qu’elle ne commette pas ce larcin. D’une manière plus générale, si tous les individus avaient des comportements déliés de tout réflexe acquis, et agissait donc de façon aléatoire, la société qu’ils voudraient former ne le pourrait sur aucune base.
Par ailleurs, ces automatismes acquis présentent aussi un grand intérêt dans le fonctionnement de notre cerveau car ils libèrent en quelque sorte de la place pour le reste. Dans de nombreuses interviews ainsi que dans La Colombe assassinée, Laborit développe l’exemple du pianiste qui apprend une partition. Lors d’aborder un passage difficile de celle-ci, le pianiste mobilise toute son énergie et toute sa concentration afin d’en acquérir les subtilités. Ce travail est d’abord pénible, puis, petit à petit, avec l’entraînement et la répétition de cette difficulté, il parvient à la maîtriser avec une facilité grandissante. Que se passe-t-il au niveau de son cerveau ? Et bien il mémorise en fait les détails du passage, et inscrit leur réalisation dans sa mémoire afin de créer des automatismes nerveux. Ainsi, lorsque la difficulté sera parfaitement résolue, et sa réalisation bien automatisée, le pianiste va disposer de l’énergie et de l’attention qu’il a mobilisées pour progresser plus loin dans le morceau et résoudre de nouveaux problèmes. Comme le dit Laborit, ce sont ces automatismes qu’on appelle « le métier ».
Certes, il ne permettront jamais que d’être un bon exécutant, et non un créateur. Mais il y a fort à parier qu’il n’existe pas de créateur qui n’ait par ailleurs une compétence forte d’exécutant. C’est le cas chez les musiciens, tous les plus grands compositeurs ayant presque toujours été des interprètes virtuoses d’un ou plusieurs instruments. On pourrait donner bien d'autres exemples pour illustrer ceci, mais je ne m'y étends pas car j'ai à nouveau été un peu long.
18:15 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |
Facebook |
12/09/2006
Servomécanisme et écologie
 Lorsqu’on évoque aujourd’hui les grands défis à relever lors du prochain quinquennat et les questions les plus importantes sur lesquelles les différents candidats, déclarés ou non, doivent répondre, je suis frappé d’observer à quel point les questions d’écologie restent encore largement déconsidérées. Tout juste semblent-elles parfois faire l’objet d’un positionnement de posture pour que l’un ou l’autre puisse donner un vernis humaniste à son image. Mais aucun candidat majeur de la prochaine échéance électorale n’a encore abordé de façon sérieuse ces sujets.
Lorsqu’on évoque aujourd’hui les grands défis à relever lors du prochain quinquennat et les questions les plus importantes sur lesquelles les différents candidats, déclarés ou non, doivent répondre, je suis frappé d’observer à quel point les questions d’écologie restent encore largement déconsidérées. Tout juste semblent-elles parfois faire l’objet d’un positionnement de posture pour que l’un ou l’autre puisse donner un vernis humaniste à son image. Mais aucun candidat majeur de la prochaine échéance électorale n’a encore abordé de façon sérieuse ces sujets.
On remarquera d’ailleurs, que cette absence ne fait guère l’objet de réaction de la part de la population. Elle n’est remarquée ni chez les journalistes, ni chez les blogueurs, les seules maigres agitations sur cette thématique étant de savoir qui de Nicolas Hulot, José Bové ou Dominique Voynet est le plus légitime pour se présenter en 2007 sous la bannière écolo. Il est à mon sens particulièrement frappant que des questions aussi décisives, et dont la résolution devient de plus en plus urgente, restent à ce point en périphérie du débat public. Et il n’est sans doute pas inutile de rechercher les sources de cette négligence, qui devient toujours plus coupable avec le temps.
Tout d’abord, et ce n’est pas là un bien haut niveau d’analyse, il est évident que la très forte personnification du débat joue un rôle important dans ce processus. Ce qui compte le plus, et qui aliment la majeure partie des articles de journaux et des discussions de comptoir ce n’est pas quoi ou comment, mais qui. Sarkozy ici, Ségolène, là, Jospin encore là, Villepin, etc. La campagne ne s’annonce pas comme un grand débat d’idée mais comme un débat de nom et de personnalités. Sans doute cela n’a-t-il rien de très nouveau, mais j’ai le sentiment que cette orientation s’accentue progressivement avec les années, et qu’elle va connaître un point particulièrement culminant lors de la prochaine présidentielle.
D’ailleurs l’accumulation, qui frise désormais l’absurde, des sondages pour savoir quel nom est en tête, est une bonne indication de cette tendance. C’est exactement là qu’est la source du syndrome du surfeur d’argent. Ce que nous cherchons ce n’est pas une solution à nos problèmes, c’est un champion dont nous ayons une bonne image et qui nous renvoie, dans un subtil jeu de miroir, une bonne représentation de nous-même. Nous voulons un héros sur lequel tout reposer, une sorte de totem autour duquel nous pourrons faire notre catharsis sociale et repartir de zéro.
Mais on m’objectera avec justesse que ce phénomène ne touche pas plus les questions d’écologie que les autres. Que l’appauvrissement qu’il entraîne concerne toutes les composantes du débat, et que cette première remarque ne saurait donc rendre compte des raisons spécifiques qui relèguent l’écologie à l’arrière-plan des palabres politiques. On aura raison. Il faut chercher ailleurs les sources de cet étrange et paradoxal désintéressement.
Or, on trouve chez Laborit une idée très intéressante pour expliquer ce comportement. J’avais indiqué en introduction de cette série, que la démarche de Laborit dans ses recherches présentait ceci d’intéressant qu’il tentait le plus possible d’analyser les choses de façon pluridisciplinaire. Qu’il appréhendait ses travaux depuis différents points de vue pour parvenir, dans la mesure du possible à une compréhension globale des phénomènes sur lesquels ils se penchaient. C’est ainsi que, partant de l’analyse du fonctionnement d’une cellule, il observait comment son fonctionnement normal ou son dysfonctionnement vient modifier le niveau d’organisation qui englobe la cellule, l’organe, puis partant de l’organe il passait à l’organisme, puis partant de l’organisme, et donc de l’individu, il passait à des observations au niveau social.
En matière scientifique, on s’aperçoit effectivement qu’il existe une limite inhérente aux démarches de spécialisations. C’est qu’elles finissent par se stériliser si elles n’intègrent pas dans leurs recherches les liens qui existent entre les différents niveaux d’observations sur lesquelles elles se penchent. Ici je propose un mien exemple avec des vrais bouts d’imprécision scientifique dedans. Imaginons que Newton et un physicien quantique regardent ensemble la pluie tomber. Chacun, étant une sommité dans son domaine, va proposer son analyse du phénomène. Newton va dire en premier que les lois de la physique sont telles qu’il est obligatoire que la pluie tombe, c’est-à-dire que l’eau en provenance des nuages suive un trajet de bas en haut, puisque cette eau est, comme tous les autres corps sur la planète, attirée vers le sol par la force d’attraction. Mais le physicien quantique rétorquera immédiatement qu’il reste pourtant parfaitement impossible de décrire le trajet effectué par la pluie, et qu’en réalité si l’on cherche à suivre une goutte et à prédire sa trajectoire, cela sera impossible. Et bien tous les deux ont raison. On pourrait simplement synthétiser leurs observations en disant que globalement, il est tout à fait raisonnable de dire que la pluie va tomber et non pas monter au ciel, mais qu’en revanche on sera incapable de décrire par quelles détours chaque goutte de pluie va passer avant de se retrouver au sol. Et ainsi, on comprend que leurs observations sont complémentaires, et que c’est leur réconciliation qui peut le mieux rendre compte de la réalité du phénomène observé.
Laborit fait la même remarque en biologie. Il existe différents niveaux d’organisation du vivant, qui font tous l’objet d’une spécialisation scientifique. Au niveau de l’atome on trouvera le chimiste, au niveau organique le physiologiste, puis le psychologue au niveau de l’individu, le sociologue au niveau de la société, etc. Mais ce que montre Laborit donc, c’est qu’on ne peut pas bien comprendre un niveau d’organisation si on l’envisage de façon autarcique, sans prendre en compte ce qui le lie aux autres niveaux d’organisation, et notamment aux niveaux d’organisation supérieurs, car ce sont ceux-là qui contiennent en quelque sorte la commande qui dirige l’organisation du niveau inférieur.
L’électron va quitter ou rejoindre l’atome pour maintenir sa structure, l’atome maintient ainsi sa polarité pour maintenir celle de la membrane cellulaire qu’il participe à constituer, la cellule maintient sa structure ainsi pour être efficace dans l’organe dont elle fait partie, l’organe effectue les opérations nécessaires à l’activité normale et saine du corps et de l’individu, et l’individu agit conformément à ce qui est nécessaire à sa survie au sein de la société, sans troubler le cours de celle-ci. Si l’on ne comprend pas cette interdépendance des niveaux d’organisation on a une image très imparfaite du vrai rôle que chacun remplit.
Mais surtout, on s’aperçoit ici que chaque niveau d’organisation ne pourrait rien faire s’il n’était pas commandé par le niveau qui l’englobe et qui le régule. Le fonctionnement des atomes dépend de celui des cellules, celui des cellules de celui des organes, et ainsi de suite. Le mécanisme qui lie deux niveaux d’organisation entre eux par l’action d’un régulateur, Laborit la nomme servomécanisme. Je crois qu’on peut simplifier cela en disant qu’il s’agit ici de la pression de nécessité dans laquelle le niveau d’organisation supérieur enferme le niveau inférieur, exigeant, si l’on peut dire, de lui, qu’il effectue telle chose et pas telle autre.
Ces considérations seront peut-être apparues un peu longues à certains, mais elles me semblent indispensables pour bien comprendre la suite. Revenons donc maintenant à notre sujet de départ. Chaque niveau d’organisation donc, agit conformément à ce qui est nécessaire pour le niveau d’organisation supérieur, la commande de son activité venant de ce niveau supérieur. Ceci est vrai au niveau microscopique, et le reste au niveau macroscopique. En d’autres termes, l’organisation animale répond aujourd’hui à la commande contenue dans le niveau d’organisation qui lui est supérieure, à savoir la biosphère.
Mais l’homme, individu formidablement plus développé et abouti que toutes les autres formes vivantes sur notre planète, en particulier du point de vue neuronal, a perdu la notion de ce servomécanisme. Le fait d’être situé tout en haut de la chaîne de l’évolution lui a fait perdre de vue le fait qu’il n’en restait pas moins inclus dans la biosphère. Du fait de l'activité de son cortex, il s’est mis à se construire des règles, toutes issues du travail de son cortex, et qui l’ont détaché de la servitude naturelle à laquelle le reste du vivant est soumis : la religion, l’art, les idéologies, la morale, etc. Et ce faisant, il a oublié que, si ces nouvelles règles qu’il créait et qu’il s’imposait pouvaient avoir quelque pertinence, il n’en restait pas moins inclus dans la biosphère, qui a elle aussi ses règles. En gros, nous percevant comme un aboutissement ultime, nous ne nous envisageons pas comme pouvant être inclus par un autre niveau d’organisation qui nous serait supérieur et qui nous commanderait.
Dés lors dit Laborit, pas étonnant que nous n’ayons pas géré les biens naturels à notre disposition. La structure dans laquelle nous nous situons nous échappant, nous n’avons pas conscience, ou tout de moins de façon encore trop imparfaite, des nécessités qui existent au niveau de la biosphère. Nous ne sommes pas encore parvenu de façon satisfaisante à transformer nos constructions sociales de sorte qu’elles recréent un servomécanisme qui nous permettent de mieux prendre en compte notre place dans cette biosphère.
Alors comment recréer ce servomécanisme, ce lien avec notre environnement ? Je crois que là aussi, c’est une question de proximité. Les personnes se penchent en priorité sur ce qu’elles ont sous le nez. Ce qu’elles ne voient pas, ça n’existe pas puisque ça n’entre pas dans le champs environnemental (pris au sens global cette fois-ci) qui les impacte directement. Ce n’est pas surprenant que la majorité des astronomes, lorsqu’ils reviennent sur Terre raconter leur expérience, parlent très souvent d’écologie. Ils ont vu la Terre eux, pas nous, nous n’en voyons que des fragments, et ne l’envisageons pas comme un tout. Eux si, et ils ont pu ainsi sentir cette fragilité, née de l’interdépendance qu’entretient chaque zone géographique avec les autres du point de vue climatique, biologique, politique même.
Ainsi donc, il me semble que l'écologie ne pourra trouver la place qui doit être la sienne dans les débats que si l’on parvient à réintroduire cette proximité, qui, si elle est difficilement palpable, n’en est pas moins très réelle et impacte chaque individu. Recréer de la proximité avec notre environnement social, et avec notre environnement naturel, ça pourrait faire un joli programme politique non ?
18:35 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |
Facebook |
08/09/2006
Première critique envers Laborit: retour sur la dominance et la gratification
 Je voudrais aujourd’hui proposer une critique au billet que j’ai posté mardi sur le naturel et la mémoire. Dans ce billet, on a pu entrevoir que Laborit attribuait une grande importance aux stratégies de dominance dans nos comportements. Dans les processus de réenforcément (c’est-à-dire la répétition d’actions spécifiques) nous dit-il, nous cherchons en premier ressort à établir notre dominance sur notre environnement (géographique et social) afin de nous donner la meilleure garantie d’obtenir nos gratifications. De cette observation, Laborit tire une analyse générale sur la construction de hiérarchie à laquelle la plupart des sociétés modernes ont aboutis.
Je voudrais aujourd’hui proposer une critique au billet que j’ai posté mardi sur le naturel et la mémoire. Dans ce billet, on a pu entrevoir que Laborit attribuait une grande importance aux stratégies de dominance dans nos comportements. Dans les processus de réenforcément (c’est-à-dire la répétition d’actions spécifiques) nous dit-il, nous cherchons en premier ressort à établir notre dominance sur notre environnement (géographique et social) afin de nous donner la meilleure garantie d’obtenir nos gratifications. De cette observation, Laborit tire une analyse générale sur la construction de hiérarchie à laquelle la plupart des sociétés modernes ont aboutis.
Pour reprendre, rapidement, son idée, des individus se trouvant sur le même territoire, territoire qui contient un certains nombres de gratifications, vont s’affronter pour l’obtention de celles-ci, guidés qu’ils sont par le maintien de leur homéostasie, ou, dirait Freud, par leur principe de plaisir. Cet affrontement va résulter en l’établissement de dominances entre les uns et les autres, déterminant ainsi la quantité de gratifications que chacun va effectivement pouvoir obtenir. C’est ainsi que Laborit affirme que la notion de propriété (et non pas l’instinct de propriété, celui-ci n’existant pas puisque la notion de propriété est une chose apprise et nullement innée) est à la source de la guerre.
Mais donc, je voudrais proposer une critique de la vision de la dominance selon Laborit. Car à la lecture, qui reste forcément partielle, de ses travaux, il me semble qu’il envisage les notions de dominance et de gratification de façon trop monolithique. Il raisonne en effet en glissant à mon avis trop facilement du concept général, à son application concrète dans la vie de tous les jours. Et ainsi, d’une analyse globale, il passe à l’observations de comportements spécifiques, sans pour autant intégrer les circonstances et les contingences qui les entourent.
Je m’explique.
Lorsque Laborit explique les comportements de réenforcement, qui sont donc directement orientés vers la recherche de gratifications, il utilise ce terme de gratification sans aucune nuance, sans vraiment poser la question de ce qui constitue une gratification. On comprend bien que pour ce qui est des besoins fondamentaux (manger, boire, dormir, se reproduire), il n’y a pas vraiment place à la confusion les concernant. On mange afin de combler un déséquilibre dont notre corps nous a informé lorsque nous avions faim. Notre appétit comblé, nous avons retrouvé notre homéostasie.
Mais il n’est pas besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre qu’en dehors de ces besoins fondamentaux, on trouvera sous ce seul mot de gratification, des éléments très variés, et dont certains même pourraient nous sembler parfaitement opposés. On m’excusera, je l’espère, d’illustrer ce propos avec un exemple classé X, mais il me semble vraiment bon, donc je n’hésite pas plus.
Lorsque deux personnes cherchent à satisfaire leurs désirs sexuels, elles peuvent tout à fait, alors qu’elles recherchent toutes les deux une même chose, le plaisir, envisager des moyens opposés pour obtenir celui-ci. C’est ainsi que dans les pratiques sado-masochistes, certains vont préférer occuper la place du maître-bourreau, alors que les autres vont préférer jouer le rôle de la victime soumise. Et d’ailleurs dans ce cas, leurs "stratégies" pour obtenir le plaisir sont tout à fait complémentaires, puisque l’un va avoir besoin de l’autre pour se satisfaire. Leur recherche de plaisir, loin d’aboutir à une confrontation, si ce n’est celle des chairs, passe au contraire par une forme de collaboration.
Ainsi, si le principe de plaisir est effectivement le même pour chacun de nous, il s’en faut de loin que nous ayons tous une vision identiques des moyens qui permettent de l’atteindre. Nous voyons bien ici, que le schéma de deux personnes s’affrontant pour obtenir la même gratification est trop simpliste, puisque les personnes ne seront pas toujours au même moment à la recherche des mêmes gratifications, et qu’il ne saurait donc en résulter de façon systématique un affrontement.
D’ailleurs, on entrevoit déjà avec mon exemple l’autre flanc de ma critique. Car Laborit est trop restrictif lorsqu’il envisage la dominance comme la principale stratégie pour obtenir nos gratifications. On l’a vu dans le cas d’une relation sexuelle sado-masochiste, les partenaires entrent dans une relation de collaboration afin de satisfaire l’un et l’autre leur désir. On pourrait dire qu’ils passent un accord pour que l’un donne à l’autre ce qu’il désire, en échange du plaisir qu’il recevra en retour.
 En gros, ils négocient. Voilà un aspect oublié par Laborit dans son analyse. Au-delà de la stratégie de dominance, qui reste une attitude assez primitive, les hommes ont su trouver d’autres méthodes pour satisfaire leurs besoins et se faire plaisir. Petit à petit, au fil des siècles, ils ont mis en place des structures qui encadrent leurs activités, et ils ont trouvé des modes de fonctionnement qui répondent de façon efficaces à leurs attentes. Bref, ils se sont mis à négocier, et à collaborer.
En gros, ils négocient. Voilà un aspect oublié par Laborit dans son analyse. Au-delà de la stratégie de dominance, qui reste une attitude assez primitive, les hommes ont su trouver d’autres méthodes pour satisfaire leurs besoins et se faire plaisir. Petit à petit, au fil des siècles, ils ont mis en place des structures qui encadrent leurs activités, et ils ont trouvé des modes de fonctionnement qui répondent de façon efficaces à leurs attentes. Bref, ils se sont mis à négocier, et à collaborer.
Je sais qu’il existe déjà une littérature fournie sur ce sujet, les économistes qui me lisent peut-être ont déjà de multiples exemples en tête pour illustrer ceci. Mais je voudrais tout de même proposer mon petit exemple, parce qu’il me plaît (vous pouvez tout de même sauter la suite de ce paragraphe, et le suivant, si vous le souhaitez). Imaginons deux gamins un peu filous qui veulent aller profiter du pommier du voisin Alfred pendant que celui-ci s’est absenté. Il leur faut pour cela passer au-dessus du mur de clôture de la maison d’Alfred, mais tous les deux sont trop petits pour y arriver seuls. Toutefois, ils peuvent le faire s’ils se font la courte échelle.
Victor et Michel passent alors un deal, c’est Victor qui soulèvera Michel à l’aller, et Michel qui soulèvera Victor au retour. Evidemment on se dit que Michel pourrait tout à fait, une fois qu’il est sur le mur, décider de ne pas aider Victor à le rejoindre, et ainsi profiter de toutes les pommes pour lui tout seul. Mais ce serait en vérité un bien mauvais calcul, car alors il se priverait très probablement de la possibilité de rééditer ceci une prochaine fois, Victor n’acceptant pas de se faire pigeonner à deux reprises. Mais surtout, il serait bien en mal de revenir chez lui puisqu’il serait toujours incapable de franchir le mur au retour et se retrouverait ainsi piégé. On voit bien ici que les deux galopins vont devoir négocier et se mettre d’accord pour arriver à leurs fins. S’ils s’affrontent au contraire, cela résultera en une perte pour les deux.
Les économistes, s’il y en a qui me lisent, trouveront tout cela particulièrement évidemment. On ne fait en effet ici que redécouvrir la théorie des jeux, et, si je ne me trompe pas, en particulier celle des jeux à somme nulle (comme le dilemme du prisonnier). Cette théorie montre bien qu’il existe d’autres stratégies que la dominance pour arriver à ses fins, et que celle-ci ne saurait donc pas être envisagée comme la seule permettant de répéter nos actions gratifiantes. En fait, il n’est pas interdit de penser que dans tous les cas où les gratifications seront suffisamment nombreuses pour tout le monde, on aura plus intérêt à établir des stratégies de collaboration que de dominance pour les obtenir.
Mais il faudra que je revienne sur ce point dans un autre billet, pour cette fois-ci apporter un élément de soutien à Laborit.
17:05 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (10) | ![]() Facebook |
Facebook |
31/08/2006
Henri Laborit, biographie
 Henri Laborit était un biologiste français, né à Hanoi, Viêt-Nam en 1914, et mort à Paris en 1995. Son père, officier médecin des troupes coloniales, est mort lorsqu’il avait 5 ans, des suites d’un tétanos, et lui-même contracta une tuberculose à l’âge de 12 ans. Il suivi rapidement les traces de son père, devenant à son tour médecin de l’armée, dans laquelle il exerça l’activité de chirurgien. Pendant la 2ème guerre mondiale, il servit sur plusieurs bâtiments de la marine, dont le Sirocco qui fut coulé le 31 mai 1940 lors de l’évacuation de Dunkerque, ainsi que sur l’Emile-Bertin lors du débarquement d’Anzio en janvier 44, ainsi que lors du débarquement en Provence.
Henri Laborit était un biologiste français, né à Hanoi, Viêt-Nam en 1914, et mort à Paris en 1995. Son père, officier médecin des troupes coloniales, est mort lorsqu’il avait 5 ans, des suites d’un tétanos, et lui-même contracta une tuberculose à l’âge de 12 ans. Il suivi rapidement les traces de son père, devenant à son tour médecin de l’armée, dans laquelle il exerça l’activité de chirurgien. Pendant la 2ème guerre mondiale, il servit sur plusieurs bâtiments de la marine, dont le Sirocco qui fut coulé le 31 mai 1940 lors de l’évacuation de Dunkerque, ainsi que sur l’Emile-Bertin lors du débarquement d’Anzio en janvier 44, ainsi que lors du débarquement en Provence.
Après la guerre, il exerça dans les hôpitaux de Lorient et Bizerte (Tunisie) puis en 1949, il faut muté au laboratoire de physiologie du Val de grâce où son activité s’orienta vers la recherche. Et c’est en 1951 qu’il découvrit la chlorpromazine, aussi connue sous le nom de Largactil, premier médicament antipsychotique utilisé notamment pour soigner la schizophrénie.
A partir de 1958 il dirigea dans le cadre de l’hôpital Boucicaut le laboratoire d’eutonologie, créé comme une association de loi 1901 et qu’il ne finança qu’avec les ventes de ses brevets et ses droits d’auteurs (mais aucune aide de l’état). Il eût également une forte activité d’enseignant et de conférencier à travers le monde, en particulier aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, en Afrique et en Extrême-Orient.
Les travaux de Laborit reçurent un accueil très favorable aux Etats-Unis, où il reçu d’ailleurs le prix Albert-Lasker en 1957 pour saluer sa découverte de la Chlorpromazine, ce prix étant probablement le prix le plus prestigieux dans son domaine d’activité, en dehors peut-être du Nobel. Il fut également récompensé plus tard par la médaille de l’OMS, en 1972, et il reçu le prix Anokhin (URSS) en 1981. Le Prix Nobel cependant, Laborit ne le reçu jamais, bien qu’il fut pressenti pour le recevoir, très probablement en raison de sa démarche très indépendante qui l’éloignait des grands cercles scientifiques reconnus.
Car durant toute sa carrière il refusa de se fondre dans le moule habituel des chercheurs et des scientifiques, notamment dans le moule français, et il chercha sans cesse à éviter le conformisme tant dans ses méthodes de recherche que dans son comportement humain. C’est même là un des points importants de son travail que d’avoir chercher à disséquer les sources du conformisme et d’avoir dénoncer ce comportement. Cette attitude lui valu d’être longtemps très mal perçu, et d’ailleurs même sa mort fut accueillie par l’indifférence marquante des gens de son métier.
L’un des principaux intérêts de la démarche de Laborit, est qu’il n’a pas voulu restreindre sa réflexion au seul cadre de la recherche biologique. Comprenant l’impact de ses découvertes sur la compréhension du comportement humain, il s’aventura sur les terrains de la psychologie, de la sociologie, de l’économie et de la politique. On retrouve souvent dans ses livres ce souci de mettre en relation les différentes disciplines et sciences humaines, et de montrer que si on ne les considère qu’isolément on ne peut alors en extraire la vérité qu’elles contiennent, car l’une éclaire l’autre, et c’est par la reconstitution du puzzle qu’elles forment que l’on parvient à répondre réellement aux questions que chacune se posent.
Il a d’ailleurs ouvert en universités des unités de valeur qui regroupaient ces différentes disciplines, notamment à Vincennes où il créa une uv intitulée « biologie et urbanisme », ainsi qu’à l’université du Québec, à Montréal, où il assura un enseignement de bio-psycho-sociologie, de 1978 à 1983. Enfin, il intervint également dans le domaine de la cybernétique, ayant compris de façon remarquablement anticipée, le développement que l’information et son échange pourraient avoir sur nos sociétés modernes, cela bien avant l’apparition d’Internet tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Les principaux livres qu’il publia sont Biologie et structure (mars 1968), qui rencontra un certain succès notamment dans le cadre des évènements de mai de la même année, L’Agressivité détournée (1970), qui est l’introduction de tout son travail sur la biologie comportementale, La Nouvelle Grille (1974), L’Eloge de la fuite (1976), qui reste à ce jour le plus connu et le plus lu de ses ouvrages, L’Inhibition de l’action (1979), Dieu ne joue pas aux dés (1987), pour ne citer que ceux-là. Il s’est rendu célèbre dans le grand public par sa participation au film d’Alain Resnais, Mon oncle d’Amérique, dans lequel il présente une grande partie de ses travaux et réflexions.
15:55 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |
30/08/2006
Ecrire sur Laborit, c'est laborieux
Avec deux bons mois de retard, ce qui confirme ma tendance à la procrastination (un mot qui fait partie de ceux que tout bon blogueur doit avoir écrit au moins une fois dans un post s’il veut être reconnu par ses pairs), j’entame ma série concernant Henri Laborit. Au-delà de ladite tendance à la prostri, crospi, straco à la flemme, qui me caractérise encore trop souvent, je dois tout de même dire pour ma défense, que ce retard est en partie dû au fait que la production de quelque chose d’à peu près potable sur le sujet nécessite un travail plus que conséquent. Et que donc, cette série risque de ne prendre fin que dans pas mal de temps, contrairement à ce que j’avais souhaité initialement. Mais je pense que c’est un mal pour un bien, enfin je l’espère, je vous en laisserai juges.
En gros, voici le programme que je voudrais parvenir à suivre, en gardant la possibilité, comme ce fut le cas pour les autres séries, d’opérer quelques bifurcations et autres apartés :
1. Sa biographie. Bien sûr on en trouve déjà de très bonnes dans des encyclopédies, et même sur Internet, et d’ailleurs, c’est, on s’en doute, à partir de ces travaux déjà existants que je vais faire la mienne. Mais je l’inclus afin que cette série puisse constituer un ensemble relativement complet qui d’une certaine façon se suffise à lui-même.
2. Un petit lexique utile pour aborder les travaux de Laborit et ne pas être trop perdu dans un vocabulaire nouveau.
3. Une tentative de synthèse de ses travaux et de la théorie générale.
4. Un point précis sur l’agressivité.
5. Un point précis sur la notion de fuite.
6. Un point précis sur la question d’inhibition de l’action (oui, j’ai déjà écris plusieurs choses là-dessus, mais impossible de faire cette série sans aborder à nouveau cette question, d’autant que je ne l’avais pas assez approfondie).
7. Une tentative de critique de l’approche et de l’analyse de Laborit. Difficile étant donné mes maigres moyens, mais j’espère parvenir à quelque chose car le risque d’une telle série est bien sûr de tomber dans un ébahissement bêta qui empêche de vraiment réfléchir. Il est probable que ceci ne constitue pas un billet en lui-même, mais que je cherche dans chaque billet à indiquer quelles sont les limites que je vois dans tel ou tel raisonnement, lorsque j’en vois. On verra selon la façon dont tout cela se développe.
Evidemment, il me faut à nouveau préciser, ne serait-ce que pour les éventuels nouveaux arrivants, que je ne propose ce travail qu'en pur amateur du dimanche. C'est donc un esprit doublement critique qu'il vous faudra appliquer en me lisant: envers Laborit, et envers moi-même. J'espère toutefois que vous serez intéressés, et que je parviendrai à maintenir cet intérêt, car Laborit dans ses travaux, à produit des analyses comportementales aussi sérieuses qu'originales, de la lecture desquelles on ressort avec des pistes de réflexion très riches!
16:50 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2006
Retour sur l'inhibition de l'action
Koz a publié hier un billet intéressant qui me donne l’occasion de revenir sur la notion d’inhibition de l’action. J’ai déjà abordé cette notion en filigrane dans plusieurs de mes billets sur la gestion du stress, et de façon plutôt appuyée dans mon billet sur la gratification et la concurrence, mais je voudrais y revenir à nouveau pour préciser certains points. Sans doute y aura-t-il quelques redites par rapport à ce que j’ai pu écrire ici ou là, mais après tout, la pédagogie c’est peut-être savoir répéter les choses en partant d’angles varié.
Un des éléments qui nous guide de façon universelle est la recherche de l’équilibre, c’est-à-dire de l’équilibre intérieur. Nous avons besoin de nous sentir bien dans notre corps (en bonne santé) et bien dans notre tête (équilibre psychologique). Il en va de même chez toutes les populations, et à toutes les époques, que l'on soit européen, chinois, congolais ou kwakiutl. En effet, à chaque instant, notre organisme réagis aux stimuli qu’il subit, afin de rétablir l’équilibre que ceux-ci peuvent fragiliser. Un peu comme un funambule avançant sur une corde mince, notre corps nous informe lorsque nous penchons trop à droite ou trop à gauche pour nous permettre de rétablir la situation initiale et de continuer à avancer.
Afin d’atteindre ou de conserver cet équilibre, nous mettons en œuvre tout une batterie de moyens, certains basiques (manger, dormir), d’autres beaucoup plus élaborés (comme réfléchir – il faudra que je revienne précisément sur ce point plus tard, dans un autre billet). Tous ces moyens, pour divers qu’ils soient, reviennent en fait à réaliser le même objectif : nous procurer un plaisir qui rétablit un équilibre perdu ou insuffisant. Par exemple quand j’ai faim, le ventre me tenaille et me fait un peu mal, j’ai alors besoin de stopper cette souffrance en m’alimentant, ce qui va me faire retrouver l’état d’équilibre dans lequel j’étais avant d’avoir faim (le fait que la nourriture soit bonne est un détail en fait, disons que si elle l’est, c’est un plaisir rajouté).
Ces plaisirs que nous recherchons, ce sont les fameuses gratifications dont j’ai parlé de façon plus précise dans le billet indiqué plus haut. C’est par l’obtention de ces gratifications que nous pouvons parvenir à conserver notre équilibre biologique (corporel et psychologique). Si l’on ne parvient pas à les obtenir, on se trouve alors constamment en situation de déséquilibre, de manque, et cela peut conduire à des dégradations importantes du comportement et/ou de la santé.
Or, dans la situation de concurrence inévitable créée par la recherche des gratifications, ce que les hommes ont trouvé de mieux pour s’assurer leur obtention c’est le pouvoir. C’est par le pouvoir que l’on parvient à se tailler une part plus grande de gratifications. Plus on a de pouvoir, plus on peut obtenir de gratifications, plus on peut se faire plaisir et, au-delà de la seule réponse à nos besoins, plus on peut répondre à nos pulsions orientées vers le plaisir.
Et inversement, moins on n’a de pouvoir, moins on peut obtenir de gratification et ainsi satisfaire ses besoins et ses envies. On est alors dans l’inhibition de l’action, c’est-à-dire dans l’incapacité d’agir nous-même pour obtenir nos gratifications. Cette situation met les personnes concernées dans une situation difficile à supporter, d’autant qu’elle s’accompagne souvent d’un sentiment d’injustice porté par la question: « pourquoi moi plutôt qu’un autre ? ». Mais étant faits comme les autres, ceux-là qui ont peu de pouvoir n’en ont pas moins de besoins et de désir que les « puissants ».
Il va donc leur falloir trouver des moyens dérivés pour parvenir à leurs fins. Des voies par lesquels ces personnes qui n’ont que trop peu de possibilités de se satisfaire vont pouvoir rétablir une forme d’équilibre, soit intérieur (un vrai équilibre donc, un équilibre objectif), soit vis-à-vis des supposés « puissants » (un semblant d’équilibre, un équilibre relatif – i.e comparé à celui des autres) Et l’un de ces moyens, c’est la violence. Celle-ci agit je crois selon deux axes : d’abord elle peut permettre de prendre le pouvoir, et donc d’atteindre un équilibre objectif, et ensuite, en privant les autres de leurs gratifications, elle réalise une forme de « justice », via un nivellement par le bas. « Je suis malheureux, peut-être, mais les autres aussi. Du coup je me sens mieux. »
On me rétorquera, et avec une certaine raison, que toutes les personnes appartenant aux couches sociales défavorisées n’ont pas recours à la violence. Certes. Mais je répondrai que ce n’est qu’en vertu du fait que le recours à la violence engendrerait pour elles un déséquilibre encore plus fort, né de ce que celui-ci entrera en conflit direct avec leurs valeurs. Mais le jour où le déséquilibre social surpassera le déséquilibre qui naîtrait par la violence, alors ces personnes risquent fort d’avoir recours à la violence (qu’on pense seulement à une personne sans le sou qui en est réduite à voler. Humainement, sommes-nous nombreux à l’en blâmer ? Et pourtant elle use bien d’une méthode violente).
En d’autres termes, la situation d’inhibition de l’action est un facteur qui accroît, et de façon très importante !, le risque d’un recours à la violence, même s’il n’est pas seul à l’expliquer.
Voilà qui éclaire, en tout cas je l’espère, avec quelques précisions l’interrogation de Koz sur son blog. Le problème n’est pas tant la peur de l’inéluctable que la difficulté pour certaines catégories de personnes de satisfaire, comme le font tous les autres, leurs besoins et leurs envies. Koz a en revanche raison lorsqu’il indique que les gens ont probablement le sentiment grandissant de n’être plus que des pions dont certains usent à leur guise, et qui n’ont plus véritablement voie au chapitre.
Et on comprend aisément que la mondialisation accroît encore cette crainte. Dans un pays de 60 millions de personnes, nombreux sont déjà ceux qui estiment que leur voix ne compte pas, qu’ils ne peuvent rien changer au cours des choses (pour ma part je reste toujours sidéré du pourcentage d’abstention lors des élections, quelles qu’elles soient), alors dans un monde de 6,5 milliards d’individus… Le sentiment de dilution est immense, et avec lui, la perception d’une inhibition de l’action, d’une impossibilité d’agir et de s’exprimer autrement que vers des murs.
Je crois que c’est ce point qui constitue le principal défi et le principal intérêt de la décentralisation. En permettant aux personnes de retrouver une voix et un impact au niveau local on peut leur redonner le goût d’agir. Pour cela, il faut d’abord que la décentralisation soit réelle et que les décisions locales portent sur des points importants, soient véritablement relayées aux niveaux supérieurs, mais aussi que les mécanismes décisionnels soient plus transparents et mieux connus pour que l’on puisse sentir l’impact complet des mesures adoptées localement, et qu’on comprenne dans quel mouvement elles s’inscrivent.
12:30 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2005
La gratification et la concurrence
Aujourd’hui je propose une réflexion personnelle sur la notion de concurrence. Cette réflexion n’est pas vraiment arrêtée, et ce que je vous propose donc ici ne se veut pas une opinion définitive. C’est un domino en plus, que j’aimerais d’ailleurs parvenir à préciser. Peut-être vos commentaires m’y aideront-ils ?
Dans un billet récent, Paxatagore a rappelé certains des principes de base qui régissent selon lui l’activité humaine, notamment l’organisation de l’économie. Je le cite : « La mondialisation est un état de fait. La loi du marché semble la façon naturelle pour l'homme d'organiser son rapport à l'économie. Le capitalisme n'est que la résultante de la loi du marché, associée à des techniques juridiques somme toute anciennes (la société). » Je crois que Paxatagore aurait volontiers ajouté/précisé que la loi du marché est principalement que celui-ci fonctionne par la concurrence entre les entreprises. D’un premier abord, je crois que sauf à être excessivement idéaliste, on ne peut qu’être d’accord avec ces propos.
Pourtant, je voudrais proposer une réflexion « dissidente » sur ce sujet. Un contre-feu. L’essentiel de l’idée que je propose se fonde sur des écris de Henri Laborit, encore lui, et notamment sur un extrait d’une conférence qu’il donna en 1992 à Nice.
Commençons par préciser le présupposé que l’on entend ici remettre en question. Dans les Fondements de la métaphysique des mœurs Kant relève un paradoxe de notre comportement. Nous montrons à la fois un besoin de lien social : communiquer avec les autres, échanger des idées, jouer, rire, s’aimer, etc ; et une inclination naturelle à rechercher égoïstement la satisfaction de nos désirs propres. C’est ce que Kant appelle « l’insociable sociabilité ». Nous avons tous en nous une propension à agir de façon égoïste et individualiste pour la satisfaction de notre propre plaisir. A des degrés variables certes, mais enfin elle me semble tout de même universellement partagée. Et c’est cette propension que l’on voit à l’œuvre à travers « la loi du marché ». Partant, chercher à fonder un système tant politique qu’économique et social, qui ne prenne pas en compte cette réalité humaine semble dans le fond assez peu raisonnable et donc voué à l’échec. Le système actuel, malgré ses failles, étant probablement celui qui prend le plus en compte cette nature qui est la nôtre, semble donc le plus adapté.
Et pourtant.
Laborit montre dans ses travaux que le système de concurrence porte en lui le germe de la guerre. Laborit revient à l’âge des cavernes, au paléolithique pour être plus précis, lorsque pour la première fois la notion de propriété est née. A cette époque, les hommes se développent à tel point qu’ils commencent à mettre au point des stratégies de survie élaborées. Ils ne se contentent plus d’errer sur Terre à la recherche de nourriture en chassant. Ils se mettent à cultiver, et à stocker. Ce stock, cette nourriture toujours disponible en abondance, mais aussi toutes les autres richesses que le groupe saura produire et conserver sont ce que Laborit appelle des gratifications, c’est-à-dire des éléments qui permettent à l’homme de se sentir plus heureux, de se faire plaisir.
C’est important que ce point soit clair et je m’y attarde donc un peu. Laborit a démontré dans ses travaux que la source principale des problèmes que peut rencontrer un individu est le fait de se trouver en inhibition de l’action par rapport à la réalisation de ses envies. Chaque fois qu’un individu va se trouver en inhibition de l’action il va être déséquilibré intérieurement, et cela pourra entraîner du stress, des névroses, des maladies, etc. Laborit, un peu pour plaisanter disait : « Au départ lorsque j’étais chirurgien, j’étais tout content quand j’avais soigné un estomac, un utérus, etc. Maintenant je dis que plutôt de soigner l’estomac, on ferait mieux de tuer la belle-mère trois ans avant ! » Une autre situation qu’il décrit est celle de l’ouvrier que son patron ne peut pas encadrer, qui ne peut ni fuir (sous peine de perdre son boulot) ni taper sur son patron (idem + on lui amènerait les flics). Celui-ci se retrouve donc en inhibition de l’action. Ce sont ces classes sociales qui se font le moins plaisir et qui sont le plus en inhibition de l’action. On comprend l’envie de certains de se révolter. Ils n’ont pas assez de gratifications.
Cette stratégie de production des biens rend possible la sédentarisation. Dès lors le territoire, avec ce qu’il contient, devient important. Il devient ce qui rend possible la survie, parce qu’on y a trouvé les conditions qui la permettent. Que se passe-t-il à partir de ce moment si d’aventure un groupe errant vient à découvrir ces terres et leur richesse ? Ils veulent eux aussi profiter des gratifications qu’offre ce territoire. Mais là, le premier groupe dit : « non, c’est à nous ». La notion de propriété naît. Et avec elle le conflit entre les deux groupes, chacun voulant bénéficier de ce qu’apporte le terrain. Tous les deux s’affrontent pour obtenir un même gain, une même gratification. Lequel des deux gagne ? Le plus fort. C’est la loi animale qui régit l’issue des affrontements.
Petit schéma très simple pour bien comprendre ce qui se passe.
L’illustration est moche, certes, mais elle est claire. Ils sont deux pour une seule gratification. L’affrontement est inévitable ils la veulent autant l’un que l’autre.
Prenons quelques exemples simples et actuels pour illustrer encore cette idée. Imaginez deux amis d’enfance qui rencontrent ensemble une jeune fille dont ils tombent tous les deux amoureux. Chacun voudra parvenir à être l’élu de la demoiselle. Et pour cela il leur faudra entrer en concurrence l’un avec l’autre. Ils vont s’affronter, que ce soit verbalement ou physiquement (ou par tout autre moyen qu’ils souhaiteront). Leur amitié n’y résistera pas, pas si tous les deux sont vraiment amoureux de la jeune fille. Les exceptions doivent être bien rares.
Un autre exemple, et qui va me permettre de relier enfin tout ceci au monde de l’entreprise. Il y a quelques années j’avais postulé pour un stage dans une entreprise de crédit. Lors de l’entretien, celui qui eût été mon futur responsable m’indiqua qu’il avait pour habitude de mettre ses employés en concurrence afin de les stimuler à rendre de meilleurs résultats. Je n’ai pas été retenu pour le poste mais c’est un autre élève de mon école qui le fut, et il me raconta plus tard comment les choses s’étaient passées. L’ambiance de cette entreprise était calamiteuse. Chacun cherchait tous les jours à tirer dans les pattes de l’autre, toujours dans le dos, personne ne s’appréciait, les gens étaient tous très nerveux, etc. Bref, à tous rechercher la même gratifications (prime, plaire au patron, etc.) ils en étaient venu à se faire une guerre larvée, à mon avis aussi destructrice des gens que des intérêts de l’entreprise.
Car le principe de la concurrence est très exactement le même que celui que décrit Laborit dans son analyse. Deux entreprises sont en concurrence pour obtenir les faveurs d’une même clientèle (la gratification). C’est la plus forte de ces entreprises qui obtiendra sa gratification, et qui donc gagnera la bataille. Si l’on en croit Laborit, je crois que le terme de guerre économique n’est pas trop fort pour décrire les conséquences de la concurrence.
Prenons un peu de recul sur la situation actuelle du monde. Je ne vais pas faire une liste mais les conflits et les tensions sont nombreux et existent sur tous les continents : guerres entre pays, guerres civiles, terrorisme. Quelles raisons à ces affrontements ? Bien souvent ce ne sont que des luttes de pouvoirs, pour accéder aux territoires, aux richesses. Des luttes pour des gratifications. Que propose le système économique actuel ? Rien de très différent de ce que décrit Laborit il me semble. Pourtant il se pourrait bien qu’il y ait urgence. Kofi Annan lui-même déclarait récemment être extrêmement pessimiste sur l’état du monde et sur les chances de paix.
Alors quelle solution ? Et bien dans sa conférence Laborit n’en propose pas. Il ne sait pas et le confesse. Et pour ma part je ne sais pas non plus. Un système qui serait plus de type coopératif, donnant une place plus grande à la solidarité ?
21:30 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |




