09/04/2007
La légende des comportements: de l'innéité de l'agressivité et de l'agressivité prédatrice
 Pour entamer l’étude de l’agressivité, il me semble bon de tordre le cou à une idée qui reste trop répandue, et qui malheureusement conduit encore une grande part des réponses que les sociétés entendent donner à l’agressivité de certains de leurs citoyens : l’agressivité humaine n’a que peu à voir avec l’inné. Elle n’a rien de consubstantiel avec notre nature.
Pour entamer l’étude de l’agressivité, il me semble bon de tordre le cou à une idée qui reste trop répandue, et qui malheureusement conduit encore une grande part des réponses que les sociétés entendent donner à l’agressivité de certains de leurs citoyens : l’agressivité humaine n’a que peu à voir avec l’inné. Elle n’a rien de consubstantiel avec notre nature.J’ai déjà indiqué dans mon introduction un élément qui permet de bien comprendre ce point. Je le reprends car il me semble important de bien l’intégrer : notre organisme est fondamentalement programmé pour sa propre survie, pour la conservation de son homéostasie, ou encore, pour reprendre l’expression chère à Freud, pour répondre autant qu’il le peut au principe de plaisir. Sa principale raison d’être, c’est de poursuivre dans son être, et ce que nous appelons convictions ou valeurs ne sont trop souvent que les modalités sucrées de notre prise de pouvoir sur les autres et sur notre environnement, afin de nous assurer l’accès aux gratifications qui nous permettent de répondre à ces besoins que nous avons.
Il en résulte que nos comportements, c’est-à-dire nos actions, ne sont rien d’autres que les réponses que nous apportons à ces besoins. Ils constituent les stratégies que nous mettons en œuvre pour nous assurer la possession, ou l’accès privilégié à nos gratifications, à nos objets de plaisir, à tout ce qui nous permet - eau, nourriture, partenaire sexuel, etc. – de nous sentir au sens propre du terme, comblés.
L’agressivité n’échappe nullement à cette analyse. Elle n’est pas un comportement à part, née d’elle-même pour aboutir à elle-même. Pas plus que le reste de nos comportements, elle n’est gratuite. Elle aussi est une réponse aux situations conjoncturelles dans lesquelles nous nous trouvons, réponse le plus souvent mise en œuvre « faute de mieux ». Comportement qui n’est qu’une réponse, avant peut-être, mais nous le verrons plus tard, d’être un appel.
Dés lors, on comprend sans mal que l’agressivité de l’homme a bien peu de chance de puiser ses causes dans l’inné. Car les besoins que nous avons, qu’en tout cas nous nous sentons avoir, n’ont eux que très peu de lien avec l’inné. Reprenez pour vous en convaincre la pyramide de Maslow, et demandez-vous dans les besoins qu’il identifie lesquels peuvent être liés à l’inné. Le besoin de reconnaissance ? Le besoin d’accomplissement ? Ceux-là sont très évidemment des besoins appris, hérités de notre environnement culturel, de l’histoire humaine dans laquelle nous nous inscrivons, mais en aucun cas ils ne résultent de quelque innéité que ce soit.
Mais vous avez sans doute le sourcil levé en songeant que la base de la pyramide de Maslow mentionne avant le reste, les besoins naturel, manger, boire, etc. et que ceux-ci sont probablement peu liés à la culture puisqu’ils sont à l’évidence présent chez chaque être vivant, qu’il soit grec, australien, loup, amibe, ou fougère. Vous avez raison sur ce point, ces besoins là, et l’agressivité qui peut en résulter pour y répondre à quelque chose à voir avec l’inné.
Oui mais voilà, cette agressivité, d’une certaine façon, n’en est pas une, ou pour être plus précis, elle n’a rien à voir avec l’agressivité comportementale telle qu’on la comprend généralement, celle qu’une société se donne pour but de juguler.
Il s’agit ici de l’agressivité prédatrice, celle notamment, qui donne au lion son repas de midi, par la mise à mort de la gracile antilope. Cette agressivité, si nous reprenons la définition que j’ai donné précédemment, porte bien son nom : elle détruit l’objet sur lequel elle se porte, et en ceci son action constitue bel et bien une agression. Mais ce qui ici est fondamentalement différent de l’agressivité humaine sur laquelle notre étude se penche, c’est que cette agressivité ne s’accompagne en rien d’affectivité. C’est une agressivité exercée en quelque sorte en tout oubli de l’objet sur lequel elle se porte, et en réponse pure au besoin du lion de se sustenter.
Je me souviens à cet égard d’un reportage télévisé, dont j’ai d’ailleurs déjà dû parer ici je ne sais plus quand, où l’on voyait lions, zèbres, zèbres et gazelles boire autour de la même mare, sans qu’aucun ne semble s’émouvoir de la présence de l’autre. Bien sûr les gazelles et les zèbres restaient sur leurs gardes, prêts à bondir au cas ou leur prédateur aurait retrouvé l’appétit, mais tout de même la scène était marquante, et tout à fait significative de ce que je souhaitais ici relever : l’agressivité de prédation n’est pas accompagnée d’affectivité, et lorsque la lionne abat ses crocs sur la gazelle, ce n’est pas après celle-ci qu’elle en veut réellement, pas plus que la ménagère n’en veut au bœuf lorsqu’elle va quérir chez le boucher ses entrecôtes.
On remarquera d’ailleurs que dans la très grande majorité des cas, cette agressivité est interspécifique, c’est-à-dire qu’un prédateur l’exerce toujours envers un individu d’une autre espèce que la sienne. Il n’attaque pas ses semblables. Il n’y a que pour conquérir une femelle que des animaux peuvent exercer une agressivité intra-spécifique. Hormis ce cas particulier sur lequel je reviendrai, il n’y a que chez l’homme que l’on trouve un exercice aussi répandu d’agressivité intra-spécifique. Ceci est dû en particulier à la façon dont nous construisons nos sociétés, dont nous nous assemblons, à ce besoin que nous manifestons si souvent d’être les individus dominants du groupe, et à l’usage malheureusement encore bien trop inconscient et mensonger que nous faisons du langage. Mais nous verrons tout cela une prochaine fois.
16:55 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |
Facebook |
04/04/2007
L'agressivité - définition
19:30 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |
Facebook |
02/04/2007
Introduction à la notion d'agressivité
Après plusieurs billets sur les travaux de Laborit, certains abordant les rivages de ses analyses par le détour de sujets assez généraux, d’autres tâchant de décrypter de façon un peu plus précise le fondement de certains de nos comportements, il est temps d’en venir à l’une des questions centrales du travail de Laborit, à savoir la question de l’agressivité.
Pour bien traiter ce sujet, je compte écrire plusieurs billets, qui permettent notamment de faire le tri dans les différents types d’agressivité qui peuvent exister, et qui tentent de proposer de façon claire les explications de Laborit quant aux causes fondamentales de l’agressivité, et notamment de l’agressivité sociale, qui est à n’en pas douter un sujet majeur sans cesse débattu sans grande pertinence, ce qui explique très probablement le sur-place que nous faisons dans ce domaine.
Mais avant de traiter la question de l’agressivité, et parce que pendant longtemps je n’ai plus rien écrit sur Laborit, je voudrais revenir rapidement sur quelques points majeurs qu’il me semble indispensable de garder à l’esprit et de bien intégrer si l’on veut comprendre la suite.
Il y a deux grandes idées qui soutiennent le corpus des travaux de Laborit, et notamment ses analyses sociologiques, dérivées de ses travaux en neurobiologie. La première, c’est que l’être n’a pas d’autre raison d’être que d’être. Tout entier, nous sommes programmer pour notre survie et le maintien de notre être. Cette proposition n’a pas de visée ontologique toutefois, et il ne faut pas la comprendre autrement que dans le sens d’une programmation biologique de notre vivant pour trouver les ressources, internes ou externes, lui permettant de subsister, et de se faire plaisir en établissant les stratégies nécessaires au réenforcement, c’est-à-dire à la répétition d’action gratifiantes. En cela, je ne pense pas que Laborit se trouve réellement en opposition avec Lévinas lorsque ce dernier indique, mais j’espère ne pas trahir sa pensée ici, que la raison d’être de l’homme ne peut se réduire à être, mais qu’il doit plus tendre vers un être avec, vers un être en relation avec l’autre.
La deuxième idée majeure de Laborit, et peut-être la plus riche, est la notion de niveaux d’organisation. Laborit montre en effet que le défaut des différentes disciplines scientifiques est notamment leur spécialisation et, si l’on me passe l’expression, leur manque d’œcuménisme. Chacune s’applique à décrire le fonctionnement de l’objet auquel leur analyse a été assignée, et mises ensemble elles finissent ainsi par décrire un squelette certes complet, mais désarticulé, sans lien clair entre ses parties.
La notion de niveaux d’organisation rétabli ce lien. Laborit montre, notamment par le biais de la cybernétique, en décrivant le fonctionnement d’un système autorégulé et d’un servomécanisme, comment un niveau d’organisation peut dépendre d’un autre qui l’englobe, ou qu’il englobe, comment la cellule qui remplit sa tâche en maintenant sa polarité autour de sa membrane, travaille également à maintenir intacte la faculté de l’organe à réaliser ce pour quoi il est fait, et au final participe de la conservation de l’organisme et de cet objectif que j’ai rappelé plus tôt : être, et assurer son plaisir par des actions gratifiantes.
Ces notions étant rappelées, elles vont nous permettre de comprendre d’emblée que l’agressivité ne peut pas être autre chose qu’une des nombreuses stratégies mises en œuvre par l’individu pour conquérir ou maintenir son homéostasie. Qu’en bref donc, il n’existe pas d’agressivité gratuite. L’agressivité n’est pas une fin en soi mais un outil dont nous usons pour répondre à un besoin, besoin auquel nous ne savons pas répondre autrement, soit faute de moyens externes réels, soit en raison de notre ignorance quant-à la façon d’utiliser ce que nous avons d’autre à disposition.
Partant, on comprend aisément qu’il n’y a pas de réponse satisfaisante à l’agressivité s’il n’y a pas d’analyse de ses causes, et de réponse pour réduire ces dernières. Attaquer l’agressivité de front, sans attaquer ses causes, revient à passer la serpillère chez soi quand l’eau coule, en oubliant de fermer les robinets. Ca peut durer longtemps.
Pour bien appréhender la question de l’agressivité, il me semble bon de rappeler avec Laborit quels sont les différents visages que celle-ci peut prendre, afin de distinguer avec précision s’il est d’abord nécessaire de répondre à toutes ces formes d’agressivité, et surtout comment répondre à chacune, en prenant en compte leurs spécificités propres.
Je n’entame pas toute cette analyse ici, ce sera pour les billets suivants. Tout juste vais-je indiquer, en guise d’introduction à ces prochains billets, quels sont les différents types d’agressivité relevés par Laborit : l’agressivité prédatrice tout d’abord, celle du lion qui pourchasse sa proie par exemple, l’agressivité compétitive, sans doute la forme principale d’agressivité existant chez les hommes, l’agressivité défensive, qui d’un point de vue social se rapproche parfois si près de l’agressivité compétitive qu’elle s’y fond, et enfin l’agressivité d’angoisse. Cette typologie est utilisée par Laborit dans La colombe assassinée, uniquement dans une approche éthologiste, mais je la conserve concernant l’homme car sa clarté me semble particulièrement utile pour comprendre d’où vient notre propre agressivité. Je tâcherai d’indiquer convenablement quelles sont les limites de l’analogie à laquelle je me prête ici afin de ne pas vous embarquer dans une analyse trompeuse.
11:55 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |
29/03/2007
La légende des comportements: l'éloge de la fuite
 Mobilisé que j’étais sur ma série sur le libre arbitre, j’ai un peu délaissé celle sur les travaux de Laborit, alors qu’il me reste quelques billets importants à écrire sur le sujet. Aujourd’hui, poursuivant ma synthèse sur les réponses comportementales apportées à une agression, celle-ci étant comprise dans un sens large (agressions physiques, mais également agressions corporelles telles que la faim, la soif, etc. i.e tout ce qui attaque l’équilibre de l’organisme), je vous propose d’aborder la question de la fuite.
Mobilisé que j’étais sur ma série sur le libre arbitre, j’ai un peu délaissé celle sur les travaux de Laborit, alors qu’il me reste quelques billets importants à écrire sur le sujet. Aujourd’hui, poursuivant ma synthèse sur les réponses comportementales apportées à une agression, celle-ci étant comprise dans un sens large (agressions physiques, mais également agressions corporelles telles que la faim, la soif, etc. i.e tout ce qui attaque l’équilibre de l’organisme), je vous propose d’aborder la question de la fuite.
Mais avant cela, faisons un petit rappel sur les principaux types de comportement mis en jeu dans une situation d’agression. Laborit indique qu’il en existe trois : l’agression (la contre attaque pourrait-on dire), la fuite, et l’inhibition de l’action.
L’agression, la lutte, qui est ici une agression défensive, c’est-à-dire mise en jeu en réponse à une autre, est la réponse par laquelle l’individu tente de faire disparaître la cause de l’agression qu’elle subit. D’une certaine façon, si cette réponse obtient le résultat voulu, elle est la réponse la plus efficace (à court terme au moins, car il peut exister des représailles) à l’agression subie.
L’inhibition de l’action, par laquelle l’individu empêché de lutter ou de fuir, se met en situation d’attente en tension, espérant l’arrêt de l’agression qui s’exerce contre lui. J’ai développé dans un billet précédent de cette série, toutes les conséquences qui peuvent exister à l’inhibition de l’action, et quelles interprétations sociétales peuvent être faites de ce type de réponse comportementale. Dans nos sociétés marchandes, nous n’avons pas fini de devoir faire face aux conséquences de l’inhibition de l’action à laquelle trop de gens sont contraints.
Et donc la fuite, dont Laborit a développé toute la description dans un de ses livres les plus lus : L’éloge de la fuite. La fuite est le comportement d’évitement par lequel nous l’individu va se soustraire à la cause de l’agression qu’il subit. C’est une réponse en quelque sorte « facile », car elle évite d’avoir à se mettre en jeu en choisissant plutôt de lutter, et elle a des conséquences bien moins néfastes pour la santé que l’inhibition de l’action.
La fuite toutefois n’est pas forcément aisée à bien cerner, car elle a de multiples facettes. C’est la course à pied ventre à terre devant un agresseur physique, mais c’est aussi la fuite onirique face à une réalité insupportable, ou l’exercice de simples divertissements le soir pour oublier les soucis du boulot. Tous ces comportements relèvent en gros de la même opération de fuite, d’évasion si l’on veut utiliser un terme plus métaphorique, qui revient à soustraire l’individu, corporellement ou spirituellement, à la situation qui s’oppose à la satisfaction de ses désirs et qui génère un déséquilibre.
Je voudrais donner quelques exemples simples, pour mieux cerner les enjeux de la fuite. Le premier concerne « l’onirisme » comportemental, par lequel l’individu refuse la dureté de la réalité dans laquelle il est plongé, et trouve un terrain spirituel plus positif, quitte à ce que celui-ci soit totalement imaginaire. On comprend bien sûr aisément que ce type de fuite peut renfermer un piège redoutable pour celui qui devra bien un jour ou l’autre affronter ses difficultés pour les résoudre, s’il ne veut pas se trouver un jour à un point de non retour.
Mais allumons un petit contre-feu toutefois sur ce point, pour remettre un peu en perspective cette idée. Une étude réalisée il y a quelques années par un groupe de chercheurs a montré qu’un échantillon d’individus qui refoulaient leurs problèmes présentait en réalité un équilibre organique et même un bonheur plus grand qu’un autre groupe d’individus qui choisissaient eux d’affronter bille en tête le même type de difficulté. D’autres études ont également montré que le nombre de cancers est plus faible que la moyenne chez les fous (beaucoup plus faible même si ma mémoire est bonne), ce qui là aussi est dû à l’évasion qu’ils offrent à leur cerveaux.
Deuxième exemple que je voudrais donner : celui des hobbies. Pour une grande part de la population au travail, les hobbies constituent une fuite nécessaire face au rythme temporel aliénant dans lequel ils sont plongés : le célèbre métro-boulot-dodo (ou tout rythme similaire). Ces hobbies présentent un avantage important : ils permettent à la personne de se consacrer du temps, de se recentrer sur elle-même, de retrouver ainsi une cohérence interne avec ce qu’elle souhaite vivre et éprouver. Cela apporte donc la part d’équilibre que l’esprit réclame et dont il ne saurait se passer bien longtemps sans que l’individu n’en souffre réellement.
Alors évidemment, le problème qui subsiste lorsque l’on a dit tout cela, c’est que les gens n’ont pas tous le même accès aux loisirs. Par exemple tout le monde n’a pas Internet et la possibilité grâce à cet outil de bloguer irrégulièrement sur des sujets intéressants à titre personnel et qui les font sortir pour quelques heures du métier prétentieux et superficiel qu’ils exercent.
16:55 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
25/01/2007
La légende des comportements: l'inhibition de l'action
 Face à une agression, les modes de réactions que notre organisme peut mettre en œuvre sont de trois types : la lutte, c’est-à-dire l’agressivité défensive, par laquelle nous allons chercher faire disparaître la cause de l’agression que nous subissons, la fuite, par laquelle on cherche à éviter l’agression, et enfin l’inhibition de l’action (système inhibiteur de l’action ou SIA), que nous mettons en œuvre lorsque ni la lutte ni la fuite ne sont possibles. Précisons que le terme d’agression est ici compris dans un sens large : il s’agit de tout ce qui peut contribuer à augmenter l’entropie de notre organisme, c’est-à-dire à le détruire (faim, soif, risques de tout types).
Face à une agression, les modes de réactions que notre organisme peut mettre en œuvre sont de trois types : la lutte, c’est-à-dire l’agressivité défensive, par laquelle nous allons chercher faire disparaître la cause de l’agression que nous subissons, la fuite, par laquelle on cherche à éviter l’agression, et enfin l’inhibition de l’action (système inhibiteur de l’action ou SIA), que nous mettons en œuvre lorsque ni la lutte ni la fuite ne sont possibles. Précisons que le terme d’agression est ici compris dans un sens large : il s’agit de tout ce qui peut contribuer à augmenter l’entropie de notre organisme, c’est-à-dire à le détruire (faim, soif, risques de tout types).Le système inhibiteur de l’action, lorsqu’il est mis en œuvre, provoque une rétroaction en tendance, c’est-à-dire un cercle vicieux, qui ne peut être interrompu qu’en retrouvant les conditions d’un réenforcement, c’est-à-dire d’une action gratifiante (pour revoir le principe des rétroactions, je vous invite à relire ce billet). Mais s’il n’est pas interrompu, il peut conduire à de forts dysfonctionnements, allant jusqu’à la maladie grave, au cancer.
Notons, avant de détailler les conséquences biologiques de l’inhibition de l’action, que ce système n’a pas toutefois que du mauvais, puisque dans certains cas où la fuite est impossible, il vaut mieux ne pas entrer en conflit avec son agresseur, plutôt que de risquer sa vie en l’attaquant. C’est d’ailleurs une stratégie à laquelle de nombreux animaux ont recours pour se protéger de leurs prédateurs : ils restent statiques afin de ne pas attirer leur prédateur, et dans certains cas précis cette stratégie est celle qui sera privilégiée.
Mais lorsque le SIA ne peut être interrompu, et qu’il reste en œuvre pendant trop longtemps, il engendre des déséquilibres internes graves. En effet, le SIA libère des glucocorticoïdes, qui peuvent être très dangereuses pour l’organisme car elles s’attaquent au thymus qui est le siège de fabrication de nos défenses immunitaires. Celles-ci fragilisent donc l’organisme et le rende plus sensible à l’égard des affections qui le menacent.
De plus, les cellules non conformes qui seraient éliminées par un système défensif efficace, le seront beaucoup moins si celui-ci est affaiblit, ce qui crée ainsi un terrain favorable à l’émergence d’un cancer. Laborit montre que les causes des cancers sont multiples, et qu’un seul facteur ne suffit pas à les expliquer. Ces facteurs interviennent aux différents niveaux d’organisation de l’individu, le plus englobant étant celui de la niche environnementale dans laquelle il vit. En d’autres termes, si cette niche est source de mauvais stress et entraîne chez certains un recours fréquent à l’inhibition de l’action, ceux-ci seront des terrains plus faciles de développement de cancers.
Une expérience pratiquée sur des rats, rapportée également par Laborit, a démontré ce fait : chez les rats mis en situation d’inhibition de l’action, une souche tumorale injectée prend et se développe dans un grand nombre de cas. Alors que dans une population de rats en situation d’évitement ou de lutte possibles, la tumeur ne prend que dans un nombre restreint de cas.
Mais ce n’est pas fini. Les glucocorticoïdes que l’organisme produit en situation d’inhibition de l’action entraîne également une augmentation du volume sanguin, et simultanément, une diminution du calibre de tous les vaisseaux. La pression augmente donc, et avec elle le risque d’infarctus.
Et ce n’est toujours pas fini. Les glucocorticoïdes (c’est le mot du jour finalement, glucocorticoïdes, pas facile à ressortir en société, mais ça sonne bien je trouve) détruisent aussi les protéines. Or, lors du sommeil, l’organisme procède à une restructuration protéique neuronale. En inhibition de l’action, cette restructuration ne pourra pas avoir lieu aussi efficacement. Il s’ensuit un sommeil moins réparateur, des insomnies, une fatigue plus forte.
Elles (un mot devient tabou quand il est trop répété) interviennent aussi dans l’apparition d’ulcères à l’estomac, dans des maladies psychosomatiques, etc.
Bref, l’inhibition de l’action est une source de maladie très souvent mal identifiée, mais redoutable. Laborit avait coutume de dire, après plusieurs années d’expérience en médecine, qu’au lieu de soigner des ulcères et des cancers après qu’ils soient apparus, il voudrait parfois intervenir avant et « éloigner la belle-mère source de stress ».
Maintenant que nous savons quelles sont les conséquences de l’inhibition de l’action, nous pouvons identifier quelles sont les populations qu’elle touche le plus sûrement. Sans hésitation, il s’agit des populations dites modestes, de l’employé coincé entre un patron tyrannique et l’impossibilité de démissionner sous peine de tomber au chômage, de ceux dont le budget trop faible ne permet pas l’évasion mentale des divertissements, bref, il s’agit des dominés. A l’heure où j’écris ces lignes, je ne sais pas s’il existe une étude de répartition des cancers par catégorie sociologique. Mais je prends les paris que ceux-ci sont en pourcentage bien plus élevés chez ces gens-là que parmi les populations élevées. Je vérifierai dés que j’en aurai l’occasion et le temps, et j’indiquerai le résultat ici, probablement en edit de ce billet. Mais cela ne fait à mes yeux aucun doute.
22:45 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |
Facebook |
05/12/2006
La tristesse
 La tristesse fait partie des émotions simples. Elle se suffit à elle-même pour être décrite au contraire des émotions mixtes qui additionnent plusieurs émotions différentes entre elles. (je reprends ces terminologies d’émotions simples et mixtes directement du site de redpsy déjà indiqué hier dans mon billet sur la crise émotionnelle)
La tristesse fait partie des émotions simples. Elle se suffit à elle-même pour être décrite au contraire des émotions mixtes qui additionnent plusieurs émotions différentes entre elles. (je reprends ces terminologies d’émotions simples et mixtes directement du site de redpsy déjà indiqué hier dans mon billet sur la crise émotionnelle)Petit arrêt sur les émotions mixtes d’abord, car leur compréhension éclaircit déjà beaucoup de choses. Celles-ci comme leur nom l’indique bien, mélangent en même temps plusieurs émotions simples entres elles, les font cohabiter chez la personne dans une même unité de temps. Certaines de ces émotions simples étant la cause des autres, et d’autres parfois s’entrechoquant entre elles. On comprend aisément que ce mélange de plusieurs émotions simples est une source de confusion, qui peut être profonde dans certains cas.
D’ailleurs il est probable que dans de nombreux cas, et c’est bien indiqué chez redpsy, une ou plusieurs des émotions intervenant dans l’émotion mixte, soit présente précisément pour en camoufler une autre. Parce que nous avons peur de cette autre émotion, que la seule idée de la ressentir génère une appréhension forte qui nous pousse à tout faire pour l’éviter. Comme si cette émotion risquait de s’emparer de nous, de nous faire perdre le contrôle de nous même, et de nous entraîner dans un mécanisme de crise émotionnelle.
Mais éviter ses propres émotions n’est pas chose aisée. Je crois pour être franc que c’est même parfaitement impossible. Elles s’infiltrent quoi que nous tentions pour les repousser, et malgré tous nos efforts elles finissent par occuper un espace, quelque part dans notre cerveau. Dés lors, puisque nous ne pouvons les repousser tout à fait, nous cherchons à minimiser leur importance et leur impact. C’est ce mécanisme qui est à l’œuvre dans la construction de nombreuses émotions mixtes.
En ce qui concerne la tristesse, celle-ci sera souvent accompagnée de frustration, ou encore de colère. Dans ce dernier cas, bien souvent, elle ne visera pas véritablement la cause de notre tristesse mais plutôt un facteur perçu comme étant cette cause. Pour bien comprendre ce point, tentons d’abord d’identifier ce que peuvent être les sources de la tristesse.
En y réfléchissant un peu, nous serions tentés de lister des événements qui ont pu nous causer de la peine : la disparition d’un proche, une déception sentimentale, le désespoir face à une situation spécifique, etc. Je crois qu’on peut regrouper les causes de tristesse dans deux catégories principales : le manque affectif (probablement la cause la plus importante de la tristesse), et l’abandon (j’entends ici, sur des aspects plutôt matériels comme l’incapacité à se financer, la non reconnaissance dans son travail, etc.).
Or la colère, en s’additionnant à la tristesse, va chercher un coupable à notre manque affectif, ou à notre sentiment d’abandon. Puisqu’elle est présente pour camoufler la tristesse, elle détourne notre attention de l’objet sur lequel elle devrait se porter. C’est en cela qu’elle se porte sur un facteur de la cause de notre tristesse et non sur la cause elle-même.
Cela pose à mon avis deux problèmes. Le premier, évidemment, c’est que cela nous empêche de résoudre notre difficulté puisque la colère nous en détourne. Le fait de trouver un coupable à nos déboires et de reporter sur lui l’intensité de notre tristesse ne permet probablement pas souvent de traiter notre malaise. Le deuxième, qui est quasiment inclus dans le premier, mais je préfère séparer les deux pour être plus clair, c’est que cette colère nous empêche d’exprimer notre tristesse et donc de la gérer convenablement.
Car je crois que très souvent, il faut accepter ses propres émotions, si l’on veut parvenir à les gérer véritablement et même à les utiliser pour notre propre développement personnel. Les émotions sont quasiment exclusivement ce par quoi nous nous construisons. Nous ne le percevons souvent pas car la plupart du temps elles restent à des niveaux d’intensité assez faibles, mais nous sommes aujourd’hui le résultat de nos émotions d’hier, et ce sont elles qui guident notre comportement à tout moment (ce sont bien elles qui construisent nos représentations, ainsi que nos automatismes).
Je n’ignore pas que la tristesse est une émotion difficile à accepter. Que chez certaines personnes, l’intensité qu’elle risque d’avoir peut engendrer un vrai blocage comportemental, et que celui-ci n’est pas souhaitable. Mais je crois que si la personne a accepté à l’avance l’idée de recevoir son émotion telle qu’elle vient, elle va déjà être en mesure de ne pas la vivre d’une façon trop pathologique. Parce qu’en comprenant qu’elle doit accepter l’arrivée d l’émotion, elle comprend simultanément que cette émotion est un élément extérieur, qui arrive à elle, et qui n’est donc pas elle-même. Cette seule conscience de la non identité d’une émotion à soi, permet à mon avis de la remettre en perspective, et constitue le premier pas, sans doute le plus important, pour parvenir à gérer cette émotion.
Et dans ce cas encore plus que dans les autres, il est bon de s’entourer de proches, d’amis, de personnes à qui l’on tient et qui nous offrent cette affection ou cette attention dont nous pensons manquer. Le lien social, vraiment, c’est la clé d’énormément de nos soucis.
Je voudrais terminer ce billet par une dernière suggestion, qui me vient de mes propres expériences sur la question spécifique des cas de manque affectif du fait d’une rupture ou d’une déception sentimentale. Personnellement, je n’ai jamais nourri la moindre colère contre les filles que j’ai aimées et avec lesquelles je n’ai pas pu nouer les relations que j’espérais. Sans doute parce que je me méfie de la haine vers laquelle la colère fait parfois pencher, surtout dans une situation aussi forte émotionnellement.
Mais aussi, parce que, malgré les événements, je continuais à vouloir les aimer. Parce que je sais que je me donne plus de chances de me construire de façon positive en cultivant ce sentiment en moi plutôt qu’en nourrissant des ressentiments. Alors aujourd'hui, quand je repense à ces filles, j’ai toujours un sourire qui me vient, accompagné d’un sentiment apaisé, comme une forme de tendresse qu’elles m’auraient, malgré elles, léguée. Il m’arrive même souvent de les en remercier intérieurement, ou de m’adresser à elles lorsque je me lève le matin. Je ne veux pas perdre ça.
P.S: l'image en illustration est une création d'une certaine Laure (une homonyme de ma double, je ne pouvais donc pas choisir autre chose!)
19:20 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2006
La colère
 La colère est une émotion négative vécue vis-à-vis d’un facteur (une personne, un événement, etc.) qui engendre une insatisfaction. Elle peut prendre différentes formes, et a différents degré d’intensité (en gros de l’irritation à la fureur). Mais je ne compte pas me perdre dans ces détails, car ce qui m’intéresse dans ce billet, ce n’est pas vraiment le sentiment de colère lui-même, mais plutôt les différentes façons que nous avons de l’exprimer.
La colère est une émotion négative vécue vis-à-vis d’un facteur (une personne, un événement, etc.) qui engendre une insatisfaction. Elle peut prendre différentes formes, et a différents degré d’intensité (en gros de l’irritation à la fureur). Mais je ne compte pas me perdre dans ces détails, car ce qui m’intéresse dans ce billet, ce n’est pas vraiment le sentiment de colère lui-même, mais plutôt les différentes façons que nous avons de l’exprimer.
Bien souvent, la colère, la vraie (qui n’est donc pas qu’une petite irritation), se traduit par un emballement du langage et un comportement agressif. Je crois même qu’il ne doit pas y avoir grand monde qui croit que la colère puisse être autre chose qu’agressive. N’est-ce pas ? C’est bien votre opinion à vous aussi ? Vous avez cassé toute la vaisselle la dernière fois ? Mince. Parce que pourtant…
Il y a un bon usage que l’on peut faire de la colère, et je dirai même un usage bon (si si, cherchez bien, vous verrez que ce n’est pas pareil). C’est celui de l’expression d’une colère juste, mesurée à la taille de ce qu’elle doit être, posée en quelque sorte (le terme peut sembler contradictoire comme un mauvais slogan politique, et pourtant, il est tout à fait justifié).
C’est le cas en particulier de la colère exprimée face à une personne envers laquelle on nourrit un mécontentement justifié. Une colère d’emportement face à elle est un comportement qui pourrait paraître compréhensible, mais qui ne sera jamais réellement justifié, tout simplement parce qu’il reste parfaitement stérile. Dans l’emportement on ne remet pas les choses à leur juste place, mais on blesse. On contribue donc à détruire un peu plus la relation que l’autre a pu commencer à mettre en péril.
Alors que la bonne colère vise à rétablir l’équilibre que l’autre menace. En exprimant de façon juste son mécontentement, on se cadre soi-même vis-à-vis de l’autre, et on recadre l’autre en même temps. C’est ainsi qu’on peut aider à retrouver l’équilibre initial de la relation. Ce n’est pas une colère froide dont je parle, surtout pas puisque celle-ci prépare des lendemains furieux, mais d’une colère exprimée sur un ton qui ne s’emporte pas, qui ne trempe pas dans l’émotif, mais dans le maîtrisé.
Un petit exemple pour illustrer tout ça. Lors d’une réunion, lorsque votre auditoire se met à chahuter et à ne plus vous écouter, il est souvent inutile de poursuivre. Il vaut mieux s’arrêter un instant et observer attentivement votre auditoire. Cette attitude les troublera, et ils s’arrêteront d’eux-mêmes. Mais s’ils répètent le même comportement à plusieurs reprises, déséquilibrant ainsi la réunion et vous mettant en situation de porte-à-faux, je crois bon d’exprimer la colère que vous en nourrissez.
Posez-vous alors, et faites part de votre colère avec une voix forte et ferme, mais sans vous emballez, en restant posé. Vous pouvez même, pour vous aider à poser votre colère, entamer en disant : « Je suis en colère ! ». Non seulement vos chances sont grandes d’obtenir le silence et l’attention de l’assistance de cette façon, mais vous sortirez en plus de votre réunion en ayant gagné une véritable aura auprès de ces personnes. Parce qu’ils n’auront pas vu ça souvent.
18:09 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
La crise émotionnelle
 Vendredi dernier au bureau, une collègue s’est effondrée en revenant d’une réunion de lancement de mission qui s’était mal passée. Rien n’est apparu dans les deux premières heures qui ont suivi son retour, mais ensuite, à partir de la première larme, il fut impossible de tirer quoi que ce soit de sa part durant toute l’après-midi. Désemparée, débordée par sa propre émotion, elle ne parvenait pas à reprendre le dessus, et nous qui assistions à sa crise, nous nous sentions tout à fait incapables de l’aider.
Vendredi dernier au bureau, une collègue s’est effondrée en revenant d’une réunion de lancement de mission qui s’était mal passée. Rien n’est apparu dans les deux premières heures qui ont suivi son retour, mais ensuite, à partir de la première larme, il fut impossible de tirer quoi que ce soit de sa part durant toute l’après-midi. Désemparée, débordée par sa propre émotion, elle ne parvenait pas à reprendre le dessus, et nous qui assistions à sa crise, nous nous sentions tout à fait incapables de l’aider.La difficulté de la crise émotionnelle, c’est évidemment qu’elle se traduit par une perte de contrôle. La personne devient elle-même incapable de se maîtriser, et son entourage également n’a souvent pas de réponse à apporter à la crise vécue. C’est d’ailleurs cette impuissance de tous qui fonde la crise, puisqu’elle met chaque intervenant (on comprend en fait qu’il faudrait plutôt utiliser le terme de spectateur) en situation d’inhibition de l’action, et qu’alors aucun ne se sent en mesure d’agir pour modifier la situation.
Cette impuissance renforce donc la détresse émotionnelle de la personne, puisqu’elle ajoute à son malheur le sentiment de ne pouvoir en sortir. Elle entre alors dans un véritable cercle vicieux, qui est le mode sur lequel la crise s’alimente elle-même. Je ne connais pas de remède simple à une crise émotionnelle. Et je serais bien surpris qu’il en existe. Mais on peut toutefois avancer une ou deux idées.
La première c’est que l’essentiel que peuvent apporter les personnes qui assistent éventuellement à la crise, c’est simplement d’être là. Etre là, c’est-à-dire offrir une vraie présence, témoigner de l’appui qu’elles offrent à l’autre. Mais cette présence, ne doit probablement pas se faire sur un mode pathologique (la personne qui pleure avec vous parce que vraiment c’est trop dur), mais plus sur un mode d’accompagnement. D’ailleurs, et je l’ai déjà noté à de nombreuses reprises dans mes premiers billets sur la gestion du stress dans ce blog, cette présence passe bien plus par un comportement, un regard stable et attentif à la fois, un corps serein mais mobilisé, etc., que par des mots, qui trop souvent enferment la douleur dans une interprétation trop subjective pour être juste.
La deuxième c’est que c’est souvent aussi la personne qui est en crise qui est la plus à même à s’aider elle-même. Mais là, toute la difficulté c’est que pour sortir de sa crise, il est nécessaire qu’elle parvienne à s’en détacher, à prendre du recul vis-à-vis de sa situation. Or la crise, par définition, se caractérise par l’absence de recul et, comme on l’a déjà indiqué, par l’entraînement dans un cercle vicieux qui alimente celle-ci.
Quelques idées toutefois peuvent être mises à profit. La première, c’est qu’il me semble tout à fait erroné de chercher à supprimer les émotions en cause. C’est comme en gestion du stress. Il ne s’agit pas de supprimer ces éléments, mais de les gérer, c’est-à-dire de savoir les intégrer en soi d’une façon saine et non destructive. Mais prétendre détruire ses propres émotions, c’est à mon avis une bêtise. D’ailleurs à bien y réfléchir, je ne crois pas que cela soit possible, et les gens qui prétendent y parvenir, ne font probablement que les maquiller. Est-il besoin d’expliquer que ce n’est pas ainsi qu’elles parviendront à retrouver leur équilibre ?
Ensuite, et là je vais être très pragmatique, il faut travailler sur les affects corporels de la crise, notamment sur la respiration. Le simple fait de parvenir à reprendre son souffle convenablement et à le poser lentement peut suffire à sortir de l’engrenage. On peut aussi travailler sur les muscles pour les détendre. La seule détente des muscles du visage est une source d’apaisement importante : surtout le front (penser à le rendre lisse, sans rides), et les joues (notamment en desserrant la mâchoire).
Enfin, le fait d’avoir déjà engagé une démarche de travail sur soi, de réflexion sur ses priorités, de connaissance de ses moyens et de ce qui ne dépend pas de soi, tout ceci peut être mis à profit (notez au passage que vous n’avez nullement besoin de moi, ni de quelque gourou que ce soit pour mener cette démarche, il vous suffit de vous intéresser à vos propres comportements pour cela). Souvenez-vous notamment de la petite phrase « que penserai-je de tout ceci dans un an ? Cela aura-t-il la même importance qu’aujourd’hui ? »
Et maintenant, passons à une forme répandue de crise : la colère.
P.S: et j'ajoute une petite référence, le guide des émotions de redpsy. Vraiment pas mal.
17:15 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |
Facebook |
20/11/2006
Brève légende des comportements
Je l’avais promis il y a longtemps, il est temps de vous le proposer. Petit lexique de biologie comportementale, afin de mieux appréhender les questions que l’on a déjà abordé, et que nous continuerons d’aborder dans de prochains billets, au sujet de Laborit. Ce lexique se veut assez concis, tout en fournissant les grands traits qu’il faut comprendre clairement pour poursuivre cette étude.
Niveau d’organisation : la biologie se construit par niveaux d’organisation. La matière vivante se construit d’abord à partir des briques élémentaires que sont les quarks, puis les électrons, neutrons, protons, puis les atomes. On trouve ensuite les molécules, qui assemblées d’une certaine façon produisent telle ou telle cellule. Ces cellules organisées entre elles vont constituer différents organes, qui à leur tour vont constituer un corps, une chose vivante, végétale, animale ou humaine.
A chaque niveau d’organisation, les éléments qui agissent travaillent à la fois pour leur propre conservation et pour celle de l’ensemble plus grand dans lequel ils sont intégrés. En bref, chaque élément participe par son activité à la conservation de la structure dans laquelle il est intégré. Par exemple, la cellule met en œuvre un certain nombre de mécanismes, notamment pour maintenir la polarité de sa membrane, garante de sa survie, et elle concoure ainsi simultanément à la conservation stable de l’ensemble dans lequel elle est englobée : l’organe. Ce mécanisme est un mécanisme dicté par la nature biologique des choses.
Au niveau humain, il n’est pas déraisonnable de considérer, et c’est en particulier vrai dans les sociétés modernes dites civilisées, que les hommes sont tous des constituants d’un niveau d’organisation supérieur : la société qu’ils ont créée. Ainsi, leur activité est orientée vers leur propre conservation (sur tous les plans), ainsi que vers la conservation de la société. Déjà de nombreuses questions sont soulevées sur ce dernier point : quel est le degré de conscience de l’homme de sa participation à un niveau d’organisation supérieur ? En conséquence quel attention peut-on espérer qu’il y porte et dans quelle mesure va-t-il savoir réguler son activité pour effectivement répondre à cette nécessité de maintenir la structure dans laquelle il est intégré (c’est le problème de l’écologie, c’est-à-dire de la gestion des moyens, naturels ou fabriqués, qui nous sont donnés pour répondre à nos besoins) ? Quelle est la véritable dimension de cette structure supérieure ? Est-ce le quartier dans lequel on habite ? Est-ce la région ? Est-ce le pays ? Est-ce le monde ? Quels moyens l’homme peut-il mettre en œuvre pour participer à la conservation de cet ensemble ? Doit-il être conformiste ? Révolté ? Je m’arrête là.
Système régulé : un effecteur à pour fonction de produire un certain effet, c’est-à-dire de faire atteindre une certaine valeur à l’élément sur lequel il agit. Cet effecteur est fonction de facteurs qui agissent sur lui et déterminent son activité. Dans un système régulé, un tel système comprendra en plus une rétroaction venant de l’effet produit, et qui va agir sur les facteurs de l’effecteur pour modifier leur action. Un schéma aidera à mieux comprendre tout cela.
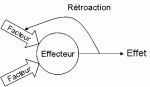
Si la rétroaction agit en sens inverse des facteurs, on a alors un système régulé en constance. Cela signifie que l’effet de ce système va constamment varier autour d’une valeur moyenne, jamais atteinte de façon stable. Cela existe de nos jours dans nos cuisines. Lorsque le système atteint et commence à dépasser une certaine température, il s’éteint. En se refroidissant il va retomber sous la température recherchée, ce qui va réenclencher sa mise en route, et ainsi de suite. En revanche, si la rétroaction agit dans le même sens que celui des facteurs, on a alors un système en tendance. Le système recherche alors une valeur maximale de l’effet.
Servomécanisme : c’est une commande extérieure qui vient influer sur l’activité d’un système régulé. Cette commande intervient au niveau de la boucle de rétroaction du système régulé pour en modifier la valeur. Au niveau physiologique, c’est la commande qui agit sur un niveau d’organisation, et qui vient du niveau d’organisation supérieur. Au niveau humain, on pourrait considérer qu’un bon exemple de servomécanisme est celui des lois. Celles-ci en effet, viennent agir sur la régulation que l’individu apporte lui-même à son comportement social, de façon extérieure à lui-même (il y aurait en fait beaucoup à dire sur ce caractère extérieur, mais je suis obligé de caricaturer pour rester clair). Il en va de même de l’état de la nature qui nous entoure, lorsque celui-ci finit par contraindre notre comportement, par une forme de pression de nécessité. On comprend donc que le servomécanisme est le processus qui réalise la liaison fonctionnelle entre les différents niveaux d’organisation biologiques.
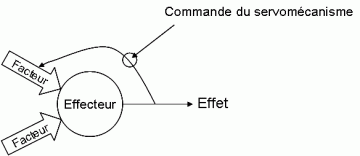
Note : les premières pages de L’homme et la ville abordent de façon précise et claire le sujet des systèmes régulés et des servomécanismes.
Empreinte : dans les premières années de sa vie, un enfant, de même d’ailleurs que tout autre être vivant muni d’un cerveau, doit construire en premier lieu une chose : lui-même. Pour cela, il va engrammer dans son cerveau toutes les informations qu’il recevra, pour constituer ainsi une première mémoire, qui influencera par la suite ses comportements. On appelle cette mémoire, l’empreinte. Son rôle est très important car sa marque est indélébile. Elle ne s’efface pas. C’est la raison pour laquelle les premières années sont décisives dans la construction individuelle des hommes. J’ai déjà développé quelques notions sur ce sujet.
Notre cerveau est composé de trois structures principales
Cerveau reptilien : c’est le système nerveux primitif, qui existe également chez les animaux dont le cerveau est le moins développé, comme par exemple les reptiles. Ce système nerveux a pour fonction de répondre aux stimuli transmis par l’organisme, aux informations internes de celui-ci donc, en rapport avec son environnement. Si par exemple notre dernier repas date de quelques heures, l’organisme va produire les signaux internes d’un déséquilibre naissant. Le cerveau reptilien va répondre à ces signaux en déclenchant un comportement de recherche de nourriture. Lorsque la faim sera assouvie, on verra alors le retour d’un comportement de satiété. Le cerveau reptilien est donc celui qui commande les comportements de réponse à la faim, la soif, le sommeil, ainsi que le rut. Son objectif est donc de maintenir la structure de l’organisme en répondant aux vitaux de celui-ci. Notons pour terminer que la mémoire de ce système nerveux est une mémoire à court terme, qui n’excède pas quelques heures (et non, le souvenir du plaisir que vous avez pris la semaine dernière en buvant votre vin ne relève pas du cerveau reptilien, mais du système limbique : le cerveau reptilien n’engramme que les instincts qui vous permettent de répondre à vos besoins fondamentaux, pas les émotions que vous ressentez lorsque ceux-ci sont satisfaits).
Système limbique : c’est le cerveau des mammifères (on l’appelle d’ailleurs aussi cerveau mammalien), celui de la mémoire à long terme et de l’affectivité. Le système limbique, en effet, est celui qui enregistre les informations qui arrivent à notre organisme lorsqu’il vit une expérience (en fait, nous somme constamment en train d’en vivre). Il agit notamment en mémorisant le caractère agréable ou désagréable des expériences que nous vivons, ce qui va par la suite permettre, parce que nous les avons mémorisés, de répéter les expériences agréables (ou gratifiantes), et d’éviter les expériences désagréables, ces deux comportements ayant pour but, eux aussi, de contribuer au maintien de l’équilibre biologique et de la structure de l’organisme. Pour n’en donner qu’un petit exemple, c’est parce qu’il est doté de ce système limbique que le chien de Pavlov peut saliver lorsqu’on fait sonner la cloche qui a annoncé tant de fois auparavant la venue de son repas.
Cortex (ou néocortex) : c’est le cerveau associatif. Le cerveau de l’imagination, qui est capable de créer des combinaisons neuves à partir des briques d’informations fournies par le système limbique. C’est essentiellement ce cerveau qui différencie l’homme du règne animal. Son activité recouvre entre autre l’utilisation du langage. On a déjà vu sur ce blog, qu’un des pièges du langage est que son utilisation se fait sans qu’on n’ait plus la conscience de l’activité des deux premiers cerveaux évoqués ici, le cerveau reptilien et le système limbique. Inconscient de la part primitive de sa biologie et de l’influence de ses émotions sur son comportement, l’homme se comporte désormais comme si toute son activité n’était dirigée que par son cerveau le plus noble, son cortex. Malheureusement l’utilisation de ce cortex reste minoritaire chez l’homme, bien qu’il faudrait souhaiter qu’il en soi autrement.
Les trois réponses comportementales à une agression. Petit préambule rapide sur ce point. On entend ici par agression tout événement extérieur menaçant la structure de l’individu et agissant vers sa destruction. Dans cette perspective, la faim, par exemple, est une agression, puisqu’elle génère un déséquilibre intérieur qui, s’il n’est pas résolu, peut mener à terme à la mort.
L’action : c’est le premier mode de réponse à une agression, et le plus efficace s’il aboutit au résultat qu’il s’est fixé. L’action vise à supprimer la source de l’agression, afin d’annihiler son action nocive sur notre organisme. Dans l’exemple de la faim, c’est le fait de préparer à manger ou d’aller au restaurant. Dans le cas d’une agression physique, ce peut être le fait de répliquer et de tenter ainsi d’annihiler le potentiel d’attaque de l’agresseur (soit en lui mettant la pâtée, soit en le mettant en fuite, voire en lui opposant une réaction de transfert de référentiel).
La fuite : la fuite est sans doute le mode de réaction qui a les formes les plus variés. On peut soit prendre ses jambes à son cou pour fuir devant Terminator, soit se comporter en évitement des problèmes survenant, un comportement extrêmement répandu notamment en milieu urbain, soit fuir dans l’onirisme, soit tomber en psychose, soit…. Notons concernant la psychose que de nombreuses études comparatives ont montré de façon tout à fait convaincante que les psychotiques ont un caractère souvent plus calme et « heureux » que les gens normaux, et en particulier que leur taux de stress est largement inférieur à celui des autres. Un dernier point, la fuite peut prendre une forme plus douce, notamment dans l’exercice de hobbys, qui permettent à l’esprit une forme d’évasion sans que celle-ci relève d’une quelconque pathologie.
L’inhibition de l’action : l’inhibition de l’action intervient lorsque ni l’action ni la fuite ne peuvent être utilisés. C’est un peu la réaction du hérisson qui se met en boule et ne bouge plus en attendant que l’orage passe. L’inhibition de l’action engendre dans le cerveau la production de certaines substances qui l’attaquent, et qui touchent également l’organisme. C’est pour cela qu’elle est des causes les plus importantes des maladies. L’inhibition de l’action par exemple, c’est ce que connais l’ouvrier coincé par un supérieur tyrannique, mais qui ne peut pas quitter son travail à cause d’un marché du travail trop dur, ni rentrer dans le lard de son bourreau, de risque d’être licencié. Des données médicales globales montrent d’ailleurs que c’est dans cette population que l’on trouve le plus grand nombre d’ulcères ou d’autres maladies dues au stress.
L'agressivité : j’en donne ici la définition donnée par Laborit, à titre d’information théorique pour compléter ce lexique, sachant toutefois qu’elle n’est pas utilisable très facilement. Laborit définit l’agressivité comme la quantité d’énergie nécessaire pour augmenter l’entropie d’une structure (notamment d’une structure vivante).
P.S: j'inscrit ce billet en lien juste après la biographie que j'avais faite de Laborit. Pour redonner un peu de structure à cette série qui en manque beaucoup.
19:05 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook |
Facebook |
10/11/2006
Du mariage homosexuel au conformisme de soumission
 Comme promis la semaine dernière je poursuis ma petite réflexion issue du billet du Swissroll sur le mariage des homosexuels. J’avais indiqué dans mon premier billet qu’il s’agissait notamment pour eux de rétablir une forme d’équilibre social perdu par l’interdit qui leur était fait d’accéder à ce qui reste aujourd’hui une forme standard d’organisation des relations d’un couple dans nos sociétés modernes.
Comme promis la semaine dernière je poursuis ma petite réflexion issue du billet du Swissroll sur le mariage des homosexuels. J’avais indiqué dans mon premier billet qu’il s’agissait notamment pour eux de rétablir une forme d’équilibre social perdu par l’interdit qui leur était fait d’accéder à ce qui reste aujourd’hui une forme standard d’organisation des relations d’un couple dans nos sociétés modernes.
Ce standard conserve une valeur de « normalité » forte, même s’il faut bien reconnaître que l’évolution industrielle et la pression grandissante de la concentration urbaine, aggravant notre tendance individualiste(*), remettent de plus en plus en cause cette valeur qu’on lui attribue. Mais il la conserve tout de même, et c’est dans cette mesure que l’interdiction de son accession peut être ressentie comme une forme de violence chez ceux qu’on en écarte: puisqu’on m’interdit d’avoir accès à la normalité, on fait de moi un anormal, on me stigmatise, et de façon discriminatoire puisqu’on m’écarte à partir d’un élément indépendant de ma volonté.
Petite incise le temps de prendre un peu de recul. Vous comprenez bien que cette analyse n’a rien de spécifique au cas des homosexuels. Elle est tout à fait généralisable, et c’est à mon avis tout son intérêt. Les mécanismes de rejet ont tous la même source, et les ressentiments qu’en éprouvent les personnes rejetés, ainsi que les fondements de leur comportement réactif à cette situation sont très similaires. On comprend aisément qu’il n’existe aucune bonne raison pour qu’il en soit autrement. Le billet du Swissroll n’est donc pour moi qu’un prétexte pour aborder un sujet qui me semble très important et que je vais maintenant essayé de développer plus avant.
Si vous avez lu les commentaires faits chez François et Guillaume sous leur billet, vous aurez vu que l’un deux affirme que le mariage gay ne s’inscrit dans le fond que dans un mouvement de mimétisme social, un mimétisme que l’on désigne couramment sous le terme de conformisme. Ce commentaire, bien qu’un peu rugueux, voit finalement assez juste. Car l’observation la plus intéressante que l’on peut faire sur le sujet du mariage homosexuel d’un point de vue comportemental est qu’en réalité les homosexuels sont bien comme les autres, comme la grande majorité des autres, ils ont besoin de conformisme.
On parle très souvent du conformisme, et bien souvent on en dit un peu tout et n’importe quoi. Le plus amusant, ou dramatique, c’est selon l’humeur, ce sont les comportements et les discours de plus en plus répandus sur l’anti-conformisme, qui ne font en réalité que créer un nouveau conformisme, quand ils ne restent pas ridiculement dans celui qu’ils dénoncent. On en voit une excellente illustration avec les pseudos rebelles dont la télévision est friande.
Ces apprentis provocateurs dont le rôle est de gesticuler et d’égratigner là où ça chatouille, mais surtout pas de cogner là où ça fait mal. Ceux-là remplissent un rôle important car tout en préservant la structure même de la société, puisque fondamentalement ils ne la remettent pas en cause, ils effectuent le minimum de catharsis nécessaire pour qu’on puisse se sentir différent et s’auto-attribuer une plus grande hauteur de vue que les autres, puisque nous, on a rit à leurs plaisanteries, on sait bien ce qu’il en retourne de tout ça, on est des leurs.
Pour bien comprendre la question du conformisme, je crois qu’il faut d’abord comprendre qu’il n’y a pas un mais des conformismes. J’en vois d’ores et déjà deux principaux, et qu’il convient d’analyser séparément, même s’ils ont des points communs : le conformisme que je qualifierais d’agression, celui dont l’utilité est de conserver la structure sociale dans son état et d’écarter les sources de remises en questions ; et le conformisme de soumission, celui qui permet à ceux exclus de la normalité et/ou qui sont parmi les dominés de répondre au conformisme d’agression et, là aussi, de conserver la structure du groupe.
Le conformisme d’agression est celui qui sert à la classe dominante à conserver sa situation de domination. C’est celui par lequel elle renforce, par la répétition, les règles sociales qu’elle a elle-même établies, les rendant petit à petit de moins en moins contestables. Le nec plus ultra est atteint lorsque celles-ci sont tellement ancrées dans les mœurs que plus personne n’en parle et qu’elles ne font plus partie que du magma inconscient qui oriente notre activité de tous les jours. Ces règles sont alors à ranger parmi les automatismes acquis que l’on retrouvera chez tous les individus d’un même groupe.
Sans aller jusqu’à prétendre qu’il s’agit là d’un automatisme acquis dont le fonctionnement et les sources sont parfaitement inconscient, je crois tout de même qu’on peut trouver un exemple assez juste de ce conformisme d’agression avec le mythe de la réussite sociale. Je comprends que le terme de mythe puisse paraître exagéré à certains, voire qu’il me fasse passer pour un dangereux communiste. Mais il me semble relativement juste car il y a autour de la notion de réussite sociale pas mal d’éléments qui me semblent proches d’un mythe : il est entouré de toute une imagerie populaire, on raconte fréquemment entre nous les histoires de tel ou tel individu « qui a réussi » et qui nous fait arborer un grand sourire ravi, comme on pouvait parler des aventures des Dieux auparavant, etc.
Mais surtout, ce mythe est remarquablement partagé. Autant par les dominants qui continuent de s’inspirer et de citer ces « grands hommes » dont on devrait prendre modèle, que par les dominés qui peuvent en s’en référant, s’attribuer, dans un savant jeu de miroir que j’ai plusieurs fois dénoncé sur ce blog, le mérite de ceux qu’ils louent (puisqu’ils les louent, c’est qu’ils ont les mêmes valeurs, et donc fondamentalement, du moins pensent-ils et espèrent-ils que leurs interlocuteurs pensent, le même mérite moral). A ceux-là également, ce mythe de la réussite sociale sert à rêver. Pourquoi, si cette fonction n’existait pas, les émissions de télé-réalité auraient-elles un tel retentissement ?
Ce mythe on le retrouve partout, à l’école, par exemple à travers le standard bourgeois qui veut qu’un bon parcours passe nécessairement par une prépa et une grande école, au travail où un bon employé est celui qui grimpe les échelons de la hiérarchie, et même dans le cadre privé. Partout on se voit arborer les signes extérieurs de cette réussite : les costumes sérieux de ces messieurs, la toilette élégante de ces dames, la belle maison du voisin, notre voiture, etc. Tous ces éléments font partie de cette forme de communication non verbale par laquelle nous envoyons un message à nos semblables sur le niveau social que nous nous attribuons et que nous voulons les voir reconnaître afin qu’ils nous respectent.
Ces temps-ci par exemple je remarque qu’avec les gens de mon âge nous sommes nombreux à nous vanter de notre achat immobilier. « Et tu as vu la taille de ma chambre, et la vue qu’on a depuis mon salon ? » Le must étant pour ceux qui ont pu acheter une maison, dont on parle avec un respect et un sourire en coin qui signifie « alors t’as vu, y’en a qui sont doués hein ? ».
Qu’on ne se trompe pas sur l’opinion que j’ai sur ce sujet. Je n’émets pas réellement de jugement de valeur sur la justesse de ce mythe de la réussite sociale. Je pense d’ailleurs qu’il a contribué pour une part certainement importante au développement de nos sociétés modernes et à un mieux-être général. Je subodore, il est vrai, qu’érigé en absolu, il présente un risque, et qu’il est probablement bon de savoir le regarder avec un certain recul, pour au moins se laisser la possibilité de trouver d’autres solutions. Mais je ne dis pas qu’il doit nécessairement être jeté à la poubelle. Je n’ai tout simplement pas aujourd’hui les outils de réflexion qui me permette de vraiment bien le juger, et ne souhaite donc pas m’y aventurer. Je ne fais donc ici que remarquer son existence et l’étendue de sa dissémination parmi les populations dites civilisées.
Passons désormais au conformisme de soumission, qui est en fait le véritable point d’aboutissement que j’avais envisagé à la lecture du billet du Swissroll. Celui-ci est à mon avis particulièrement intéressant car il défait un préjugé facile et apprend à observer les choses avec précision. Ce conformisme est celui des populations soumises (c’est pour cela que je lui donne cet épithète, quelle surprise n’est-ce pas), celui des dominés. Il est intéressant car il présente un paradoxe qui n’est en réalité qu’apparent.
En effet, on aurait facilement tendance à estimer que le dominé ne se plie pas de bonne grâce aux règles établies par les dominants, et qu’à la moindre occasion qui lui sera donnée de s’en affranchir, il s’empressera de le faire. Le raisonnement est cohérent certes. Mais il est aussi dénué de réflexion. Car les dominés, au contraire, ont souvent, eux aussi, intérêt à agir de façon conformiste, par mimétisme avec le reste du groupe, quand bien même celui-ci les opprime.
Pour bien comprendre pourquoi, il faut à nouveau faire un peu de biologie comportementale avec Laborit. En effet, les dominés d’un groupe social donnés, tout dominés, exploités et aliénés qu’ils peuvent être par ce groupe, ne dépendent pas moins de lui que les autres. On retrouve ici la notion de niveaux d’organisation si chère à Laborit. Revenons rapidement dessus.
Un organisme, animal ou humain, est composé en différents niveaux d’organisation biologiques : la molécule, puis la cellule, puis l’organe fonctionnel, puis l’organisme tout entier. Chacun de ces éléments travaille chaque jour à sa propre conservation. Mais en tant qu’il participe au fonctionnement des niveaux d’organisation supérieurs, il travaille également à la conservation de ces niveaux d’organisation, et ceux-là travaillent également à la conservation de leurs constituants, les niveaux d’organisation inférieurs. C’est ainsi que la molécule, si elle n’agit pas pour que la cellule puisse se perpétuer ne remplira pas convenablement sa fonction, et mourra en même temps que la cellule, et identiquement à chaque niveau.
Laborit passe des niveaux d’organisation biologiques à la sociologie en expliquant qu’il en va pour ces derniers de mêmes que pour notre fonctionnement biologique. Autrement dit, à partir du moment où l’homme s’est organisé avec les autres pour former un groupe social, il a constitué un niveau d’organisation qui englobe celui de sa seule personne, et qui conditionne sa survie autant que lui-même participe à la survie du groupe. Or le conformisme est un facteur de conservation de la structure du groupe, ou en tout cas il est perçu comme tel (être conservateur, d’un point de vue politique, dans le fond, ce n’est rien d’autre que ceci, vouloir conserver la structure du groupe intacte).
Le dominé a donc un intérêt direct à la conservation du groupe, car celui-ci lui assure sa propre survie. Sans le groupe, il disparaît, et il lui est donc nécessaire de participer, au même titre que les autres à sa perpétuation. Un dominé aura ainsi intérêt à combattre avec le groupe pour conserver la structure du groupe, alors même que c’est cette structure qui est la source de son aliénation. Il serait d’ailleurs intéressant pour compléter cette analyse de trouver la répartition de l’électorat conservateur par niveau social. Je suis pour ma part assez convaincu qu’il est en grande partie constitué de gens de faible niveau social, mais je n’ai pas vraiment de chiffres pour le confirmer.
Arrivé à ce point j’en ai à peu près terminé avec l’objet de cette petite recherche. Je voudrais juste indiquer ici qu’il me semble important lorsqu’on aborde un sujet de société, d’essayer de ne pas s’arrêter aux analyses superficielles qu’on entend si couramment et qui ne font en réalité que traiter que des apparences, des stigmates des comportements, en utilisant presque toujours un vocabulaire qui les fait passer pour de véritables réflexions, alors qu’elles n’explorent jamais vraiment le fond des choses. Il faut savoir s’extraire de la facilité, même si ce n’est pas forcément plaisant (quoique moi je prends vraiment mon pied sur ces sujets, mais ce n’est là qu’une affaire de goût).
Une piste maintenant, pour poursuivre plus avant. J’ai indiqué dans les derniers paragraphes que le conformisme était un facteur de conservation de la structure d’un groupe. Mais si celui-ci n’est pas challengé par d’autres formes de réponses aux besoins sociaux, et si aucune révolution, même petite, n’apparaissait jamais dans l’organisation d’une société, il y a fort à parier que cette société finirait dans le déclin. Les exemples de l’histoire à ce sujet sont nombreux. On observe donc, qu’à long terme, les mouvements de destruction du conformisme deviennent à leur tour des facteurs de conservation du groupe, en lui permettant de dépasser ses schémas et d’en inventer de nouveaux, par un processus imaginatif qui dans le fond, est le véritable propre de l’homme.
* : il faudra que je revienne plus tard sur ce point. Mais ce sera pour un autre billet.
11:20 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |



