29/03/2007
La légende des comportements: l'éloge de la fuite
 Mobilisé que j’étais sur ma série sur le libre arbitre, j’ai un peu délaissé celle sur les travaux de Laborit, alors qu’il me reste quelques billets importants à écrire sur le sujet. Aujourd’hui, poursuivant ma synthèse sur les réponses comportementales apportées à une agression, celle-ci étant comprise dans un sens large (agressions physiques, mais également agressions corporelles telles que la faim, la soif, etc. i.e tout ce qui attaque l’équilibre de l’organisme), je vous propose d’aborder la question de la fuite.
Mobilisé que j’étais sur ma série sur le libre arbitre, j’ai un peu délaissé celle sur les travaux de Laborit, alors qu’il me reste quelques billets importants à écrire sur le sujet. Aujourd’hui, poursuivant ma synthèse sur les réponses comportementales apportées à une agression, celle-ci étant comprise dans un sens large (agressions physiques, mais également agressions corporelles telles que la faim, la soif, etc. i.e tout ce qui attaque l’équilibre de l’organisme), je vous propose d’aborder la question de la fuite.
Mais avant cela, faisons un petit rappel sur les principaux types de comportement mis en jeu dans une situation d’agression. Laborit indique qu’il en existe trois : l’agression (la contre attaque pourrait-on dire), la fuite, et l’inhibition de l’action.
L’agression, la lutte, qui est ici une agression défensive, c’est-à-dire mise en jeu en réponse à une autre, est la réponse par laquelle l’individu tente de faire disparaître la cause de l’agression qu’elle subit. D’une certaine façon, si cette réponse obtient le résultat voulu, elle est la réponse la plus efficace (à court terme au moins, car il peut exister des représailles) à l’agression subie.
L’inhibition de l’action, par laquelle l’individu empêché de lutter ou de fuir, se met en situation d’attente en tension, espérant l’arrêt de l’agression qui s’exerce contre lui. J’ai développé dans un billet précédent de cette série, toutes les conséquences qui peuvent exister à l’inhibition de l’action, et quelles interprétations sociétales peuvent être faites de ce type de réponse comportementale. Dans nos sociétés marchandes, nous n’avons pas fini de devoir faire face aux conséquences de l’inhibition de l’action à laquelle trop de gens sont contraints.
Et donc la fuite, dont Laborit a développé toute la description dans un de ses livres les plus lus : L’éloge de la fuite. La fuite est le comportement d’évitement par lequel nous l’individu va se soustraire à la cause de l’agression qu’il subit. C’est une réponse en quelque sorte « facile », car elle évite d’avoir à se mettre en jeu en choisissant plutôt de lutter, et elle a des conséquences bien moins néfastes pour la santé que l’inhibition de l’action.
La fuite toutefois n’est pas forcément aisée à bien cerner, car elle a de multiples facettes. C’est la course à pied ventre à terre devant un agresseur physique, mais c’est aussi la fuite onirique face à une réalité insupportable, ou l’exercice de simples divertissements le soir pour oublier les soucis du boulot. Tous ces comportements relèvent en gros de la même opération de fuite, d’évasion si l’on veut utiliser un terme plus métaphorique, qui revient à soustraire l’individu, corporellement ou spirituellement, à la situation qui s’oppose à la satisfaction de ses désirs et qui génère un déséquilibre.
Je voudrais donner quelques exemples simples, pour mieux cerner les enjeux de la fuite. Le premier concerne « l’onirisme » comportemental, par lequel l’individu refuse la dureté de la réalité dans laquelle il est plongé, et trouve un terrain spirituel plus positif, quitte à ce que celui-ci soit totalement imaginaire. On comprend bien sûr aisément que ce type de fuite peut renfermer un piège redoutable pour celui qui devra bien un jour ou l’autre affronter ses difficultés pour les résoudre, s’il ne veut pas se trouver un jour à un point de non retour.
Mais allumons un petit contre-feu toutefois sur ce point, pour remettre un peu en perspective cette idée. Une étude réalisée il y a quelques années par un groupe de chercheurs a montré qu’un échantillon d’individus qui refoulaient leurs problèmes présentait en réalité un équilibre organique et même un bonheur plus grand qu’un autre groupe d’individus qui choisissaient eux d’affronter bille en tête le même type de difficulté. D’autres études ont également montré que le nombre de cancers est plus faible que la moyenne chez les fous (beaucoup plus faible même si ma mémoire est bonne), ce qui là aussi est dû à l’évasion qu’ils offrent à leur cerveaux.
Deuxième exemple que je voudrais donner : celui des hobbies. Pour une grande part de la population au travail, les hobbies constituent une fuite nécessaire face au rythme temporel aliénant dans lequel ils sont plongés : le célèbre métro-boulot-dodo (ou tout rythme similaire). Ces hobbies présentent un avantage important : ils permettent à la personne de se consacrer du temps, de se recentrer sur elle-même, de retrouver ainsi une cohérence interne avec ce qu’elle souhaite vivre et éprouver. Cela apporte donc la part d’équilibre que l’esprit réclame et dont il ne saurait se passer bien longtemps sans que l’individu n’en souffre réellement.
Alors évidemment, le problème qui subsiste lorsque l’on a dit tout cela, c’est que les gens n’ont pas tous le même accès aux loisirs. Par exemple tout le monde n’a pas Internet et la possibilité grâce à cet outil de bloguer irrégulièrement sur des sujets intéressants à titre personnel et qui les font sortir pour quelques heures du métier prétentieux et superficiel qu’ils exercent.
16:55 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
28/03/2007
L'adoption par les couples homosexuels
En commentaire d’une de ses longues brèves, Koz a indiqué quels étaient ses arguments contre l’adoption par des couples homosexuels. En bref, enfin j’espère ne pas trahir sa pensée en écrivant cela, Koz considère qu’il en va de l’équilibre de l’enfant, qui a besoin d’un père autant que d’une mère pour bien se construire, et qu’il n’est pas normal d’exposer dés son plus jeune âge aux risques de quolibets de ses camarades s’il devait avoir deux papas ou deux mamans.
Je dois dire que cette opinion était encore la mienne il ya quelques années, et que je faisais alors exactement la même démonstration que lui pour défendre mon propos. Dans un environnement social où la place de la famille est encore forte, on serait plutôt surpris que les gens pensent autrement. Mais mon opinion a changé, sans doute pas radicalement car je ne me sens pas farouchement opposé à une argumentation comme celle de koz, mais tout de même, je crois qu’elle est erronée.
J’ai changé d’opinion le jour où j’ai discuté de ce sujet avec un de mes cousins qui m’a dit en même temps qu’il était homosexuel. Il a avancé quelques arguments, et un en particulier qui disait que trop souvent, les parents élevaient leurs enfants comme « leur chose », avec donc une forte notion de possessivité vis-à-vis de leur progéniture. Biais qui selon lui était moins susceptible d’intervenir dans le cadre d’une adoption, et en particulier chez un couple homosexuel puisque ceux-ci du fait de leur situation risquaient moins que les autres de reproduire le schéma classique d’un couple hétérosexuel. En s’appropriant moins « leur » enfant que les autres, peut-être laissent-ils celui-ci plus libre de devenir ce qu’il veut. Et évidemment, le fait que ses parents soient homosexuels ne peut en aucun cas faire douter de l’amour qu’il pourra recevoir de ceux-ci.
Mais au–delà de ces quelques arguments, ce que j’ai plus ou moins senti ce jour là c’est qu’il y avait quelque chose d’étrange à envisager le risque que faisait éventuellement courir des parents homosexuels à leur enfant adoptif. Manquer d’un père ou d’une mère est une fragilité ? Affronter les sarcasmes de ses camarades est douloureux ? Ce n’est sans doute pas faux. Mais au risque de paraître provocateur j’ai un peu envie de répondre : et alors ?
Oui et alors ? Qui s’imagine aujourd’hui que les enfants qui grandissent n’ont pas d’épreuves à affronter, d’humiliation à subir et desquelles se relever, de doutes auxquels faire face ? Quels parents songent sérieusement maîtriser le chemin de vie de leurs enfants au point de les préserver de quelques vraies désillusions et de certaines douleurs profondes ? J’en vois une au moins qu’ils prendront tous un jour en pleine poire et dont peut-être on sous-estime l’impact dans la construction personnelle des individus : la déception amoureuse.
Bien sûr on rétorquera sans doute que si tout cela est vrai, il n’y a pas de raison d’en rajouter pour autant. Et que lorsque l’on peut éviter quelques désagréments supplémentaires aux enfants, il est presque coupable de ne pas le faire Mais il me semble que le fond de cette idée vient d’une vision comptable de la vie qui n’a pas beaucoup de sens. On ne peut pas envisager l’éducation d’un enfant en calculant le nombre de moments positifs et le nombre de moments négatifs qui se dresseront sur son parcours personnel. Et on aurait tout à fait tort je crois d’envisager l’éducation offerte par un couple homosexuel comme créant un handicap de base, comme un handicap physique peut l’être.
L’éducation est un processus très complexe, fait d’automatismes culturels reproduis par les parents plus ou moins consciemment, d’apprentissages que ces derniers font pour une part non négligeable en même temps qu’ils les enseignent à leurs enfants, de circonstances et d’événements extérieurs sur lesquels ils n’ont pas d’influence, d’un nombre incalculable de micro-événements qui par touche successives construisent un personnage particulier, qu’un jour les parents, s’ils regardent leurs rejetons avec clairvoyance, s’apercevront qu’ils ne peuvent pas voir complètement, qui garde en lui une part insaisissable, même à eux, même alors qu’il est le premier à hériter de ce qu’ils sont (au fait, je crois que c’est ça aimer : reconnaître et accepter la part fuyante de l’autre).
Ce processus peut tout à fait être mené de façon positive par des parents homosexuels. Peut-être auront-ils quelques difficultés de plus que les autres à affronter, à commencer par ce regard négatif qu’une certaine population continue de porter sur eux. Mais ils n’auront pas moins de faculté que les hétérosexuels pour gérer ces difficultés. C’est de maturité comportementale dont il est vraiment question ici : si celle-ci est forte, des parents homosexuels sauront faire grandir leur enfant sainement, et si elle est faible, et bien ils ne sauront pas, mais il en ira de même pour des parents hétérosexuels.
Enfin cette question ne doit à mon avis pas être présentée comme une vraie question de société. Ou plus exactement, je ne pense pas qu’ouvrir l’adoption à des couples homosexuels puisse avoir un impact sociétal réel. C’est une décision qui changera la vie de certains individus, mais pas le visage de la société dans son ensemble. Simplement parce qu’ils ne seraient sans doute pas si nombreux à y avoir recours (qu’on songe simplement au nombre d’enfant adoptés par rapport au nombre d’enfants naturels, je n’ai pas les chiffres, mais je serais surpris que ce ratio soit très élevé).
09:09 Publié dans Un peu d'actualité et de politique | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |
Facebook |
26/03/2007
La veste d'Eric Besson
Petit billet court aujourd’hui, pour répondre à la requête formulée par Verel la semaine dernière suite à la nouvelle salve lancée par Besson contre son ancien camp dans son récent livre repris pour partie dans un article du Monde. Verel semble se demander comment la position de Besson peut être désormais aussi fortement anti-Ségolène alors qu’il était encore il n’y a pas si longtemps l’un des bons ouvriers du PS. La question mérite sans doute d’être posée, et je vais tenter d’y apporter quelques éclairages.
J’émets toutefois une réserve immédiate sur les pistes que je pourrai ouvrir : je ne connais pas le personnage Besson, je subodore que nous ignorons une grande part de ce qui a pu se dire en coulisse du PS avant son éviction de la campagne de Ségolène Royal, et je ne prétends donc nullement que mon explication puisse être prise au pied de la lettre. En fait, ce billet est plus un prétexte pour illustrer à travers l’exemple de Besson quelques idées que j’ai déjà développées ici. Où l’on verra que probablement, le comportement d’Eric Besson n’a en fait rien de très extraordinaire.
D’abord, pour bien comprendre le comportement de l’ex secrétaire national à l’économie du PS après son éviction, il faut comprendre son comportement pendant qu’il était au PS. Je l’ai dit tout récemment, ce que nous appelons par commodité, et non sans quelques trémolos dans la voix et un certain lyrisme, nos convictions, sont en réalité souvent constituées, avec une apparence plus ou moins cohérente selon la maîtrise du langage que nous avons, par un ensemble hétéroclite d’intérêts bien compris, tout à fait personnels et égocentrés (c’est-à-dire qui ne visent rien d’autre que l’intérêt de notre personne, qui visent donc à notre conservation propre, biais naturel auquel nous ne saurions échapper).
Pour réaliser cela, nous avons recours de façon régulière, à de petits dénis courants, de menus rejets de certaines valeurs qu’hier encore nous déclarions importantes à nos yeux, mais dont la mise en œuvre sans entrave nous semble entraîner plus de dommages que d’avantages. Nous optons alors naturellement pour ce qui nous avantage le plus, dans le cas de Besson pour l’appartenance à un parti politique qui est proche de l’idée qu’il se fait de la politique, ou en tout cas le moins éloigné (il faut l’espérer tout de même), et nous acceptons de mettre sous l’éteignoir certaines revendications qu’en d’autres circonstances nous aurions volontiers mises en avant.
Besson, dans son entretien avec Claude Askolovitch, semble faire grand cas des sacrifices intellectuels qu’il a dû concédés dans son travail au parti socialiste. Qu’il se console toutefois, tous ses anciens camarades sont certainement dans la même situation, et il ne peut qu’en aller de même de l’autre côté de l’échiquier politique. Le fond de ce comportement là, c’est tout simplement que ces gens perçoivent que le gain qu’ils font ainsi est plus grand que la perte y attachée. Ils savent bien que s’ils avaient tout le pouvoir pour eux ils procéderaient autrement, mais tant qu’ils ne l’ont pas, ils acceptent de se plier aux règles établies pour bénéficier des avantages que leur donne le groupe qui répond à ces règles. Ce n’est rien d’autre que du conformisme de soumission, dont on s’aperçoit à cette occasion qu’il peut trouver application dans tous les types de population.
Besson donc, a jonglé pendant plusieurs années avec ses propres valeurs et avec les exigences de son parti, il a manipulé ses propres convictions, a adapté son langage pour le faire correspondre à celui du groupe, afin de maintenir la cohérence de celui-ci, cette cohérence ayant été pendant tout ce temps la garantie personnelle dont il avait besoin pour progresser et s’assurer un avenir correspondant à son ambition (sans que je ne mette sous ce terme l’idée d »ambition « a tout prix »).
La rupture, qui pour l’individu se situe en amont de sa manifestation observable par le grand public, étant par essence une affaire intime, qui se déroule uniquement en lui-même, cette rupture donc a fait tomber d’un coup toutes ces exigences de conservation du groupe. Tous les compromis acceptés jusqu’alors n’ayant plus de contrepartie et n’offrant plus aucun avantage en retour, n’ont plus de raison d’être, et ils deviennent même, en s’associant à une expérience douloureuse (une rupture de ce type n’étant jamais facile, cette difficulté étant précisément le nœud gordien du déni), des complices au mal être ressenti. Ils doivent donc être abattus afin que l’individu retrouve pleinement l’équilibre psychologique que la rupture à rompu.
D’ailleurs, il faut parier ici que si la rupture n’était pas complète, le rejet qui s’ensuit ne serait pas aussi radical. Il faudrait à Besson conserver un moyen de revenir dans le jeu, de se réintroduire dans le groupe qu’il a quitté et qui lui offrait ses gratifications. Il me semble probable que sa réaction est aussi absolue que la rupture est définitive. Un intérêt personnel très fort dans un retour au bercail pourrait contrarier cette prédiction, mais celle-ci ne me semble vraiment pas absurde. On peut même peut-être penser que c’est parce que la rupture est déjà totale que l’opinion de Besson atteint une telle extrémité de rejet du projet de Ségolène Royal, alors que je ne vois guère de possibilité qu’il ne soit pas sur quelques points en accord avec ce qu’il a soutenu il fut un temps.
Besson fait mine du contraire, mais j'y vois le signe de la bête blessée, qui a besoin de retrouver une position d’apparence digne pour lui-même, de s’extraire de l’humiliation subie, et qui pour cela dresse un tableau aussi brutal de ses nouveaux adversaires que ceux-ci ont pu l’être avec lui. Cela n’empêche d’ailleurs nullement que ses convictions entrent bel et bien en jeu dans ce rejet, et qu’elles en constituent une part importante. Je ne cherche pas ici à dénier à Besson quelque raison dans son attitude, ni a contredire la profondeur de ses valeurs, mais je ne crois pas que celles-ci soient suffisantes à expliquer la radicalité extrême dont il témoigne désormais. Il est entré dans le rapport de force, et pour que celui-ci ne soit pas trop inégal, alors qu’il est seul contre tous, il a besoin de mettre autre chose dans son discours que des éléments raisonnés et mesurés. Il faut des émotions fortes, de l’agressivité, de la culpabilisation, une critique sur tous les niveaux possibles. Vous fonctionner très différemment vous quand on vous donne la possibilité de vous exprimer après avoir été agressés verbalement ?
11:56 Publié dans Un peu d'actualité et de politique | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |
22/03/2007
Le piki-blog relayé sur Naturavox
 Vous trouverez aujourd'hui en ligne sur Naturavox, un article ancien de ce blog, qui figurait dans ma série sur les travaux de Laborit: c'est ici. Ceux qui l'ont déjà lu pourront le redécouvrir s'ils le souhaitent, les autres pourront le découvrir tout court.
Vous trouverez aujourd'hui en ligne sur Naturavox, un article ancien de ce blog, qui figurait dans ma série sur les travaux de Laborit: c'est ici. Ceux qui l'ont déjà lu pourront le redécouvrir s'ils le souhaitent, les autres pourront le découvrir tout court.
Par ailleurs, les gens de Naturavox m'ont invité à devenir rédacteur sur leur site, ce que j'ai accepté. J'y proposerai peut-être bientôt certains autres textes anciens qui me semblent proches de celui qu'ils ont souhaité publier aujourd'hui, et quelques nouveaux billets que j'ai en tête.
Ce site est encore jeune, n'a peut-être pas encore tout à fait trouver son public, mais je suis tout de même très content de pouvoir y participer un peu, et d'y cotoyer certains rédacteurs qui me semblent d'excellente qualité. Et ceci d'autant plus que les sujets abordés me semblent à la fois porter moins à la polémique que ce qui se développe le plus en ce moment dans la blogosphère, et avoir un intérêt plus important, parce que ne se limitant pas à des échéances court terme, tant du point de vue individuel que du point de vue collectif.
C'est chic non? :o)
19:14 Publié dans Un peu du nombril des blogs | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
20/03/2007
Déterminismes et responsabilité
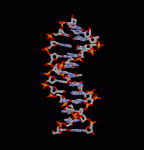 J’en termine avec ma série sur le libre arbitre, en espérant que cette parenthèse que j’ai ouverte n’aura pas été totalement vaine, malgré les quelques doutes que j’ai moi-même à ce sujet.
J’en termine avec ma série sur le libre arbitre, en espérant que cette parenthèse que j’ai ouverte n’aura pas été totalement vaine, malgré les quelques doutes que j’ai moi-même à ce sujet.
D’une certaine façon, je m’aperçois que j’ai peut-être un peu tourné autour du pot, en passant par tous ces billets pour dire une chose finalement assez simple : que cela nous plaise ou non, que cela corresponde à l’image que nous souhaiterions nous faire de notre identité ou pas, nous ne sommes que des individus biologiques. Nous sommes faits de briques, les mêmes que celles qui servent à construire le reste du vivant, mais agencées autrement, sans doute de façon plus complexe que le reste. Mais on a beau retourner cela dans tous les sens, je ne vois pas ce que nous pourrions être d’autre que des individus biologiques.
Prétendre autre chose n’est à mon avis rien d’autre que faire l’aveu de croyances irrationnelles, paranormales en quelque sorte, que celles-ci viennent d’une religion ou pas. C’est croire en l’existence de l’âme, cette impalpable substance ontologique que jamais personne ne palpa ni ne palpera (piki, mâtin, quelle poésie). Et pour ce qui me concerne j’avoue n’avoir encore jamais vu de petit nuage rosé s’élever au dessus d’une tombe.
Or cette biologie répond à des règles, elle est faite de mécanismes. S’exprimant dans une structure donnée, le corps, dont elle a pour objectif d’assurer la survie, cette biologie ne fait rien d’autre que répondre aux ordres qu’elle se donne à elle-même. Et d’assurer la survie de l’organisme. C’est sa raison d’être.
Cet ordonnancement biologique peut bien être d’une complexité insaisissable, car formé de multiples niveau d’organisation au sein même de l’organisme, répondant à plusieurs ordres simultanément, couplant des données internes et externes, jonglant avec l’image du passé qu’à formé notre mémoire, et les données immédiates du présent, tous ces stimuli sensoriels et émotionnels, et composer sur ces bases des réponses comportementales imprévisibles, cela ne change rien au fait que cette complexité reste biologique, et rien d’autre.
Or la notion de libre arbitre veut, par définition, qu’il soit possible à l’homme de se déterminer lui-même indépendamment de tout biais externe à la volonté pure, que ces biais soient externes (l’environnement et ses stimuli), ou interne (nos expériences passées, nos souvenirs, nos goûts, etc.). Qu’il soit possible de vouloir vouloir, c’est-à-dire d’autodéterminer sa propre volonté, sans qu’aucun motif ne vienne influencer celle-ci, et que celle-ci n’emprunte donc aucun élément empirique pour se fixer. Ce qui paraît tout à fait illusoire.
Mon doute concernant le libre arbitre s’est bien sûr raidi en grande partie à la lecture de Laborit. En lisant un biologiste, et de surcroit un neurobiologiste, il était difficile de ne pas être influencé par cette vision démystifiée de notre nature, mais qui peut-être, rentre dans une évaluation trop mécanique des choses (i.e. l’homme pris comme une machine). Mais c’est le point où j’en suis aujourd’hui.
Ce doute d’ailleurs a été renforcé en comprenant comment la notion du libre arbitre était née, il y a plusieurs siècles, en relation directe avec le besoin des théologiens et des philosophes de l’époque de justifier la position religieuse dominante, et de maintenir ainsi une image de Dieu qui préserve la structure sociale, et les schémas hiérarchiques de domination dont ils bénéficiaient eux-mêmes. L’idée de Dieu apporte beaucoup aux croyants d’un point de vue personnel, et pour cela je dois dire que je les envie presque. Mais socialement, elle ne remplit pas d’autre rôle, depuis qu’elle a été créée, que celui d’établir des hiérarchies (de valeur et donc, simultanément, de pouvoir), dans le domaine de l’irrationnel, celui du rationnel étant déjà naturellement affecté par ce mode de comportement. L’homme se boucle de tous les côtés.
La difficulté majeure à résoudre dés lors que l’on a rejeté le libre arbitre dans les limbes des illusions, est celle de la responsabilité. En effet, si nous sommes privés de libre arbitre et que nous répondons entièrement à des déterminismes biologiques, comment faire pour établir des jugements de valeurs sur nos comportements, pour donner un contenu quelconque au bien et au mal, au juste et à l’injuste, à toutes ces notions qui remplissent pourtant nos lois, et qui fondent donc l’organisation de nos sociétés ? Sans libre arbitre, songe-t-on, il n’y a plus de mérite, plus d’échelle d’évaluation des hommes, plus de morale non plus. Juger un homme pour ses déterminismes, c’est juger la nature toute entière, c’est juger le monde tel qu’il existe. Pourquoi faire porter ce fardeau à un seul homme ?
Alors qu’en fait non.
Raisonner de cette façon, en liant directement le libre arbitre, son absence, à la notion de responsabilité, c’est avoir une bien curieuse notion de l’existence, et une vision probablement faussée de ce qu’est l’identité. On procède en effet là comme si ces déterminismes existaient en nous comme des intrus, comme des autres que nous, comme des éléments extérieurs que nous ne saurions qu’observer en spectateurs. Comme si nous étions passifs devant leurs influences et leurs actions en nous. Dans le fond, nous avons probablement ce réflexe d’imaginer notre identité, notre moi, comme une substance magique, et même si insaisissable que nous-mêmes ne savons pas la saisir et l’embrasser.
Mais pour quelles raisons voudrions-nous que ces déterminismes, que cette biologie qui nous compose, ne soit pas nous-mêmes ? Par quel étrange détour de la pensée parvenons-nous à nous imaginer autrement que comme l’ensemble qui regroupe et unifie ces éléments ? Pourquoi ne voulons-nous pas comprendre que ces déterminismes sont ce moi, cette identité qui est la nôtre ? Sans doute voudrait-on, là encore, avoir le loisir de nous percevoir comme de plus grands mages que ce que cette vision permet d’entrevoir. Mais c’est là aussi une illusion.
Et ces déterminismes qui nous habitent, ne nous rendent en aucun cas passifs, ils ne remettent pas le moins du monde en cause notre capacité à agir, et que ce soit bien nous qui agissions, et nul autre être fantomatique en nous-mêmes. Lorsque nous agissons, peu importe que cela soit de façon déterminée, nous agissons. Point. Nous ne sommes pas des robots dont les membres sont tirés par des fils invisibles tenus par un autre moi fantasmé, mais nous les tirons nous-mêmes ces fils.
D’autre part, je voudrais profiter de ce sujet pour revenir sur un point qui me tient à cœur, que j’avais déjà indiqué il y a longtemps : il me semble important de savoir identifier, et évaluer séparément, être, faire, et avoir. Concernant l’avoir, le sujet ne m’intéresse pas beaucoup ici, et je ne m’y arrête donc pas. En revanche, je trouve important de rappeler qu’on ne peut pas assimiler l’être au faire. Que l’identité d’un homme, ne peut être réduite à ses actions, et que partant, on ne peut jamais le juger lui, mais seulement ses actes.
Or la responsabilité est liée au faire, et non à l’être. On ne rend jamais de compte de soi, mais seulement de ce que l’on fait. Et dans un tribunal, les sanctions qui condamnent un individu ne sont pas prononcées contre l’individu lui-même, mais contre ses actes. Ce n’est pas la nature de l’homme que l’on peut y remettre en cause, mais seulement la nature de ce qu’il a fait. Peu importe donc que nous soyons ceci ou cela, déterminé ou non. Notre responsabilité à rendre compte de nos actes ne s’en trouve aucunement amoindrie. Comprenez que sur ce point, je ne me situe pas exactement dans un cadre légal, et je n’entends pas dire quelles conclusions la justice devrait éventuellement tirer des analyses faites par les uns et les autres sur la question du libre arbitre. Je ne cherche pas à remettre en cause les principes existant qui atténue la peine lorsqu’un individu est déclaré non responsable de ses actes du fait de ses désordres psychologiques. Le fond de mon idée est que même dans cette situation, c’est bien cet individu que l’on recommande aux institutions de soins adéquates, et pas son enveloppe déterministe, et encore moins son âme.
Il y aurait sans doute encore beaucoup à dire sur cette question, et notamment sur ce dernier point des conséquences à tirer de cette analyse d’un point de vue juridique. Je m’en tiendrai toutefois là. Vous pouvez bien sûr aborder ces points en commentaires si vous le souhaitez.
14:30 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (10) | ![]() Facebook |
Facebook |
15/03/2007
Bayrou, Ségo, Sarko, et le perroquet
Il y a quelques jours, voter à gauche a produit un article assez rigolo au sujet des stratégies de vote pouvant être choisies par les électeurs. Cela fait en effet déjà quelques temps que certains électeurs naturels de la gauche envisagent plutôt de voter Bayrou que Royal au premier tour, parce que les sondages récents indiquent que le béarnais aurait plus de chance que la poitevine à remporter la palme au second tour.
Mais hop, les stratégies de ce type n'ayant aucune limite, il se pourrait que dans un savant jeu de billard à trois bandes, les électeurs naturels de Sarkozy votent plutôt Ségo que Nico au premier tour, afin d’être sûr que le second l'emporte face à la première. Evidemment on voit mal pourquoi s'arrêter en si bon chemin, et partis comme ça, pourquoi ne pas imaginer que, sachant que Bayrou gagnerait au second tour (toujours selon quelques récents sondages), ainsi que sarkozy (pour la même raison), les ségolistes appellent à voter en masse pour Marie-Georges ou Olivier, en espérant regrouper dans le même logique tous ceux qui souhaitent faire barrage à Sarkozy, et l’emporter au second tour face à un adversaire sans grande envergure ?
Ou comme le dirait notre défunt Louis, on pourrait aussi faire démissionner la vieille, demander au roi d'épouser le perroquet, le faire ensuite cocu par un moineau, le roi divorce, on épouse le perroquet, et nous voilà reine! Qu'est-ce que vous en pensez? (bon la citation est approximative, ok, mais l'esprit est proche, non?)
Donc bref, tout ça pour dire que les charmantes "pensées profondes" des stratèges en ci et ça pour nous expliquer pourquoi il faut toujours viser d’abord la bande pour espérer toucher la boule, moi je vous avoue, au risque de paraître naïf, que je n'en suis pas fan. Et qu'accessoirement, j'ose penser que si de tels procédés sont nécessaires, c'est qu'on a comme un problème avec notre système politique.
Ca me fait penser aux stratégies, assez similaires, qui étaient avancées parfois par les tenants du oui au referendum constitutionnel de 2005 (mince, le sujet à ne pas aborder), où l'on expliquait que si on votait non, alors on allait avoir Nice, et que comme Nice c'était pire, et bien il ne fallait pas voter non. Evidemment, je ne nie pas que ce raisonnement est cohérent, mais là où il me dérange profondément, c'est que procéder de cette façon c’est témoigner du problème d'offre que l'échéance propose, et faire simultanément mine d'ignorer ce problème.
Aujourd'hui, le vote Bayrou me semble assez similaire: il cristallise autour de lui une part importante de mécontent des deux grands partis, qui trouvent en Bayrou un choix qu'ils jugent suffisamment nouveau pour constituer une sorte de rébellion, et en même temps qui offre l'avantage de n'avoir pas le goût de souffre du vote Le Pen. Il montre donc, qu'il existe un vrai problème d'offre tant du côté de l'UMP que du côté du PS.
Et pour ma part, j’ai beau comprendre que la politique ne soit pas le domaine des idéaux tout roses, j’ai vraiment du mal à accepter que dans une démocratie, enfin, même si celle-ci reste terriblement jeune et immature, on reproche aux uns et aux autres de voter simplement en fonction de leurs envies (je n’écris pas conviction à cause de mon billet précédent, mais j’ai été tenté). Il faut tout de même bien le comprendre, une bonne fois pour toute : si le problème de l’offre politique « standard » est tel qu’il doit pousser les uns et les autres à réfléchir de façon aussi stratégique et alambiqué, c’est que nous ne sommes vraiment pas dans une démocratie adulte et sereine, mais qu’on en n’a qu’un ersatz.
Ou pour présenter les choses autrement, si Bayrou n’avait pas été propulsé troisième homme par les sondages, que ce rôle fut échu, une fois de plus, à Le Pen, qu’alors la question du vote utile fut sur toutes les lèvres, et que la réponse apportée fut d’effectivement « voter utile », et bien cela aurait déjà constitué une défaite pour les démocrates.
Qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur ma position, je ne sais pas du tout si je vais voter pour Bayrou au premier tour, ou pour un autre. Mais cessons de mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête de personnes qui ne font rien d’autres par leur vote que leur devoir de simples citoyens, et qui ont le droit de préférer tel candidat à tel autre, et de le faire savoir par leur bulletin. Ne pas respecter cela, c’est faire bien peu de cas de l’expression de ces personnes, et ce n’est donc pas précisément se montrer démocrate.
23:07 Publié dans Un peu d'actualité et de politique | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook |
Facebook |
13/03/2007
Nos dénis courants
 Deuxième petit billet inspiré par ce qu’a écrit Matthieu récemment, cette fois-ci sur ce que j’appellerais nos dénis courants. Je ne vais pas à cette occasion revenir en détail sur la notion de déni, puisque j’ai déjà abordé cette question au détour d’un billet ancien. Pour faire court simplement, le déni est une réponse comportementale que l’on utilise lorsque la vérité est trop dure à reconnaître et qu’elle implique un déséquilibre intérieur trop fort. Pour ne donner qu’un seul exemple on peut évoquer la personne alcoolique, qui culpabilisant à l’extrême de son attitude, jure qu’elle n’a jamais bu, même lorsqu’on la prend sur le fait. La reconnaissance de la réalité de son attitude étant une douleur trop forte, la personne est amenée à nier jusqu’à l’évidence la plus crue, et cela dans des proportions qui peuvent étonner.
Deuxième petit billet inspiré par ce qu’a écrit Matthieu récemment, cette fois-ci sur ce que j’appellerais nos dénis courants. Je ne vais pas à cette occasion revenir en détail sur la notion de déni, puisque j’ai déjà abordé cette question au détour d’un billet ancien. Pour faire court simplement, le déni est une réponse comportementale que l’on utilise lorsque la vérité est trop dure à reconnaître et qu’elle implique un déséquilibre intérieur trop fort. Pour ne donner qu’un seul exemple on peut évoquer la personne alcoolique, qui culpabilisant à l’extrême de son attitude, jure qu’elle n’a jamais bu, même lorsqu’on la prend sur le fait. La reconnaissance de la réalité de son attitude étant une douleur trop forte, la personne est amenée à nier jusqu’à l’évidence la plus crue, et cela dans des proportions qui peuvent étonner.
Revenons-en à la question de Matthieu dans son billet sur l’attachement de certains à la religion. Matthieu indiquait dans son billet qu’une amie à lui, de formation scientifique et ayant la tête parfaitement sur les épaules, lui avait un jour indiqué que selon elle la théorie créationniste était tout à fait crédible. On comprend que cela puisse surprendre. Je ne compte pas répondre précisément sur ce qui peut amener cette personne à cette croyance, mais plutôt esquissé une petite piste de compréhension.
Celle-ci tient en quelques mots : nos comportements sont bourrés de petits dénis, de paradoxes si vous préférez, de contradictions. Celles-ci sont parfois évidentes vues de l’extérieur, c’est le cas de l’exemple de l’amie de Matthieu il me semble, mais le plus souvent, ils restent plutôt bien camouflés. Tentons quelques exemples pour illustrer cela :
Le plus simple de tous est celui de notre attitude en voiture, lorsque nous conduisons. Lorsque nous conduisons vite, nous râlons contre les lambins qui nous freinent ou empêchent certaines de nos manœuvres par leurs hésitations (peut-être cherchent-ils leur chemin). Mais lorsque nous conduisons lentement, nous nous mettons souvent à ironiser sur ceux qui filent à vive allure, raillant les deux minutes en plus qu’ils auront gagnées devant leur télé, ou pestant contre leur klaxon alors que nous n’avons pris que 2 secondes pour trouver le point de rendez-vous que l’on cherchait. Et dans les ceux cas, nous terminons par un ferme et définitif : « vraiment, les gens ne savent pas conduire ! ».
Il ne va de même pour un grand nombre de comportements liés à l’urbanisme, où l’on se retrouve en prise directe avec une foule. Par exemple, pris dans le flot des fans qui s’arrachent les tickets au dernier concert de leur idole, tous jouent des coudes, en pestant contre leurs voisins qui les imitent, alors qu’ils se porteraient probablement mieux en se tenant calmement, et je parie même que les probabilités de chacun d’acquérir le précieux sésame ne s’en trouverait guère changées.
Le fond de cette illustration, c’est un peu celui que j’indiquais récemment ici. Essayez de porter votre attention sur vos comportements quotidiens, et de détecter vos petits dénis courants, vos paradoxes internes. Avec une démarche un peu honnête, vous devriez en trouver rapidement plusieurs.
Mais comment dans le fond peut-on expliquer cela ? Comment se fait-il que parfois même les cerveaux les mieux composés (vous dirais-je à quel célèbre blogueur je pense à l’instant même ?), qui savent argumenter brillamment pour expliquer leurs attitudes et leurs choix tombent eux aussi, et finalement autant que les autres, dans ces travers invisibles ? L’affaire est à mon avis toute simple à résoudre : fondamentalement, nos comportements ne sont pas issus de nos convictions, mais de nos intérêts et des moyens que nous avons découverts au fil de nos expériences pour les satisfaire. Ce n’est qu’à posteriori que nous avons construit notre schéma intellectuel de justification de nos penchants, de nos biais, et que nous avons appelé tout ce magma nos convictions.
Vous en doutez ? Combien êtes-vous à déclarer à vos proches que votre métier ne vous passionne pas, que dans le fond vous savez bien que tout cela ne sert à rien, qu’il faudrait rompre avec ce système aliénant. Et combien, une fois au travail, à répondre oui avec le sourire à votre patron que vous vilipendiez la veille, à justifier tel ou tel choix de la direction, histoire de vous montrer « corporate » comme on dit ? Dans mon métier, je le vois tous les jours, je peux vous l’assurer. Et je ne suis même pas le dernier à pratiquer tout cela. Car sinon, ce ne serait tout simplement pas tenable. La divergence entre ces belles opinions affichées et le vécu auquel nous pensons devoir nous soumettre est telle que psychologiquement, nous avons besoin de ces petits dénis pour conserver notre équilibre intérieur. C’est toute l’essence du déni.
Pour répondre à Matthieu donc, mais c’est utilisable aussi par les autres, si vous vous trouvez à nouveau devant ce type de paradoxe, ne vous demandez pas quelles sont les convictions de la personne que vous avez en face de vous et qui manifeste ces contradictions, mais cherchez plutôt quelles expériences personnelles peuvent expliquer cette orientation intime. Vous y trouverez probablement pas mal de pistes.
23:58 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook |
Facebook |
La vie nous joue toujours des tours
Quelques souvenirs anciens,
Réveillent parfois l'enfant qui sommeille.
Ils profitent de chaque faille,
Et s'infiltrent en garnements.
Ils agrippent nos sourires.
Nos soupirs aussi.
On rejoue les grimaces gosses
On refait les yeux étourdis.
On rappelle les détails, et tout le cirque autour.
On rit plus doucement.
Les années qu'on ne prévoyait pas sont passées.
Cet enfant ressurgi, qu'il est dur de le laisser partir à nouveau.
J'ai retrouvé en fin de semaine dernière, tout à fait par hasard, tous les épisodes d'un dessin animé que je regardais en rentrant d'un travail de nuit que j'avais trouvé lorsque j'étais encore étudiant. Je regardais ce dessin animé chaque matin, juste avant de m'endormir. J'avais passé cette année là un de mes meilleurs été.
Depuis vendredi, je baigne à nouveau dans la chaude torpeur où me laissaient à l'époque ces images. Je me retrouve un peu plus rêveur que d'habitude, un peu plus absent. Et j'adore ça.
00:55 Publié dans Un peu de poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
08/03/2007
Le monstre, c'est l'inconnu
 Je lance deux billets pour rebondir sur le billet de Matthieu dans lequel il s’interroge sur le sens de la religion chez les croyants, et pour répondre, en partie, à sa perplexité devant certaines croyances qu’il juge étonnant de trouver chez des scientifiques pur jus. Le premier, celui que vous êtes en train de lire, sur la question de l’inconnu, le deuxième, sur ce que j’appellerai pour faire simple, nos dénis courants.
Je lance deux billets pour rebondir sur le billet de Matthieu dans lequel il s’interroge sur le sens de la religion chez les croyants, et pour répondre, en partie, à sa perplexité devant certaines croyances qu’il juge étonnant de trouver chez des scientifiques pur jus. Le premier, celui que vous êtes en train de lire, sur la question de l’inconnu, le deuxième, sur ce que j’appellerai pour faire simple, nos dénis courants.
L’inconnu d’abord. Matthieu reprend dans ses premières pistes d’explication de la construction de la croyance, le principe de raisonnement cause/effet que nous utilisons tous de façon très naturelle. Celui-ci signifie simplement que lorsque nous constatons un événement, un effet donc, notre réflexe est toujours d’en rechercher la cause, de la rattacher à une chaîne causale qui permet d’expliquer et de comprendre sa survenance dans l’espace et dans le temps. C’est une coïncidence amusante pour moi de relire cette idée chez Matthieu, car j’ai lu exactement la même dans l’Essai sur le libre arbitre de Schopenhauer. Il rappelait lui aussi, à de toutes autres fins démonstratives, je le précise, l’existence de ce principe causal si ancré en nous que nous lui faisons toujours appel pour comprendre ce que nous vivons.
Ce principe de recherche du couple cause/effet, me semble pouvoir s’expliquer, du moins en partie, très simplement par le seul fait de l’existence du temps. C’est la notion de temps qui nous fait rattacher les événements entre eux, qui nous fait les associer, leur donner une unité, une cohérence. Si on y réfléchit bien, c’est quasiment tautologique.
Ce qui est plus intéressant en revanche, c’est de s’interroger sur le besoin d’expliquer, de comprendre, de chercher la cause à l’effet. On pourrait lancer un beau marronnier en répétant que c’est là le signe que l’homme est un animal curieux, avide de compréhension du monde, que dés qu’il a commencé à établir des stratégies d’utilisation d’outils pour assurer sa subsistance il est devenu un scientifique, que cette avidité de connaissance lui est intrinsèque, etc.
Mais le point qui m’intéresse ici surtout, c’est notre réaction vis-à-vis de l’inconnu. Pour synthétiser mon idée, l’inconnu pour nous, c’est le monstre. Ce qui nous est non compréhensible, non explicable, non saisissable par une image dans notre esprit (toujours liée à ce que nos sens physique sentent ou ont un jour ressenti) nous apparaît inquiétant, suspect, dangereux. L’inconnu nous laisse dans l’instabilité, sans repère, sans orientation sur la façon d’agir face à lui.
Deux exemples pour illustrer mon propos. D’abord, celui de la xénophobie. Je l’avais indiqué dans ma série sur le sujet du racisme et de l’antisémitisme, il y a donc pas mal de temps désormais, un paradoxe apparent que l’on rencontre dans les études sur le racisme est que l’on trouve souvent les populations les plus xénophobes parmi celles qui n’ont jamais rencontré le moindre étranger sur leur sol. C’est le cas en France dans certaines campagnes, où l’inquiétude manifestée vis-à-vis de l’immigration est étonnant élevée pour des régions qui ne sont guère touchées par ce phénomène.
Deuxième exemple, celui du monstre que nous avons dans notre placard ou sous notre lit lorsque nous sommes petits. On a tort de penser que les enfants ont peur du noir, ou en tout cas c’est là une vision trop superficielle de ce qui se joue dans leurs esprits imaginatifs lorsqu’ils s’en vont se coucher. Le noir ne fait pas peur parce qu’il est noir, mais parce qu’en masquant les choses aux yeux des enfants, il rend l’espace qui les entoure mystérieux et inconnu, alors même que la seconde avant d’éteindre la lumière ils pouvaient encore en voir tous les contours. C’est cet inconnu qui les fait imaginer un monstre soudain surgit sous leur lit.
D’une certaine façon donc, on peut admettre que c’est peut-être la peur de l’inconnu, plus que le goût de la découverte, qui fonde l’intérêt de l’homme pour la science et pour la recherche. Cela ne signifiant nullement pour autant que cette quête est mauvaise ou déplacée.
Demain, si je ne suis pas mort en rentrant du boulot, j'écrirai le billet suivant sur les dénis courants.
00:23 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
06/03/2007
Le libre arbitre et la question du caractère chez Schopenhauer
 Je reviens donc comme prévu sur la question de la connaissance, par un biais assez différent de celui abordé plus tôt aujourd’hui, puisque je vais revenir un peu sur l’Essai sur le libre arbitre de Schopenhauer.
Je reviens donc comme prévu sur la question de la connaissance, par un biais assez différent de celui abordé plus tôt aujourd’hui, puisque je vais revenir un peu sur l’Essai sur le libre arbitre de Schopenhauer.
Dans son livre, Schopenhauer revient notamment sur un élément clé de sa démonstration contre le libre arbitre : celui du caractère. Son idée en effet, est que nos comportements résultent à la fois de notre caractère, sorte de noyau identitaire par lequel on pourrait définir notre être, et des circonstances, dans lesquelles ce caractère qui est le nôtre nous fait mettre en œuvre telle ou telle réponse comportementale aux situations que nous vivons.
Schopenhauer, adversaire de cette illusion qu’est le libre arbitre, avance dans son argumentation qui me semble toutefois étrange, sinon erroné : celui que ce caractère que nous avons, ce noyau, est chez chacun de nous parfaitement immuable, et qu’en conséquence, mis en face des mêmes situations, nous ne pourrions guère agir d’une façon différente entre une période et une autre. Il écrit ainsi :
« Le caractère de l’homme est invariable. Il reste le même pendant toute la durée de sa vie. Sous l’enveloppe changeante des années, des circonstances où il se trouve, même de ses connaissances et de ses opinions, demeure, comme l’écrevisse sous son écaille, l’homme identique et individuel, absolument immuable et toujours le même. » Pour Schopenhauer donc, l’idée qu’un homme peut réellement évoluer, et se changer lui-même, n’est qu’une illusion. Il laisse toutefois, après ce paragraphe, la porte un peu ouverte pour que quelques détails en nous puissent se mouvoir, mais si jamais nous parvenons, dit-il, à modifier une fois notre comportement, ce n’est que pour replonger bien vite dans ce que nous sommes fondamentalement et qui jamais n’a réellement bougé.
La seule chose que nous puissions réellement changer en nous, ce n’est dans le fond pas notre caractère, mais seulement notre connaissance. C’est-à-dire qu’il nous est possible d’apprendre à utiliser de meilleurs moyens, plus efficaces, de parvenir à nos fins, mais que cet apprentissage ne change rien à notre caractère qui nous fait toujours vouloir la même chose, peu importe que nous ayons appris une nouvelle manière de l’obtenir.
On peut tenter un exemple simple pour illustrer ce point : celui des divers moyens de motivation dont on peut être amené à user pour influencer une personne à agir conformément à nos souhaits. Les plus célèbres sont la carotte et le bâton n’est-ce pas ? Traditionnellement nous serions assez portés, après avoir vu une personne user de menace, puis promettre telle ou telle gratification en remerciement de l’action souhaitée, à estimer que celle-ci s’est donc bien adoucie, et qu’en ceci, elle a changé. Alors que son fond reste parfaitement identique, puisque l’objet de sa quête n’a varié en rien, et que si ses moyens pour y parvenir nous sont moins odieux, elle n’en est peut-être pas moins prête à tout, mais sous une nouvelle forme, pour obtenir son gain.
Ainsi donc, la connaissance modifiée des choses, est un facteur susceptible de nous faire changer de comportement. Pour ma part, je crois même, comme je le disais ce matin, que c’est elle qui est fondamentalement en cause dans notre façon de réagir à telle ou telle situation.
Mais ce redressement qui a lieu ne concerne, selon Schopenhauer, que notre connaissance. Notre caractère ne s’en trouve lui aucunement modifié, et il reste invariablement identique.
Je trouve cet argument de Schopenhauer assez étrange. Sa démonstration d’ailleurs m’apparaît assez embrouillée, lorsqu’il s’embarque dans l’explication de certaines de nos croyances populaires, comme celle d’un mal rattaché pour toujours à un homme, lorsqu’une seule fois il a commis un méfait : « voleur un jour, voleur toujours », rappelle-t-il, ou encore lorsqu’il indique que trahis par un proche nous disons toujours que celui-ci nous a abusé, plutôt qu’il a changé.
Schopenhauer me semble ériger ici un simple biais subjectif en principe universel. Et ceci sur une seule base : celle que notre caractère n’est en réalité que ce noyau ontologique qui nous définit, et qui jamais ne saurait changer.
Ce que je ne vois vraiment pas dans cette démonstration qu’il fait, c’est d’où sort ce moi mystérieux et immuable qui, selon lui, nous définirait. A part à l’expliquer par la magie ou le paranormal, je ne vois aucune façon d’en rendre compte. Et on ne saurait en aucun cas dire que ce caractère évoqué par Schopenhauer est constitué par notre capital génétique puisque celui-ci n’est qu’un potentiel, lors qu’un caractère renferme en lui la notion d’une chose qui a déjà émergé, qui s’est réalisée.
Schopenhauer ignore en fait totalement le rôle joué par la mémoire dans la constitution de ce que nous sommes. Il s’égare à mon avis dans une vision formatée de l’être, qui voudrait que l’homme soit constitué d’un noyau individuel incorruptible qui constituerait son identité propre et à nul autre pareil. Quand notre « personnalité » n’est en réalité issue que des expériences qui parcourent notre vie, des émotions que nous leur rattachons, et des moyens comportementaux que notre éducation aura mis à notre portée pour atteindre nos objectifs. Il n’y a en nous aucun noyau, aucun caractère primordial qui persisterait en nous et ferait de nous des rocs immuables et répétant inlassablement les mêmes choses dans les mêmes situations. Nous sommes avant tout autre chose des cerveaux qui sentent, ressentent, et travaillent ces matières premières que sont les sensations et les sentiments pour les transformer en actions (la pensée étant à mon sens un mode d’action). Des éponges si vous préférez, plus ou moins absorbantes d’un individu à l’autre.
D’une certaine façon, on doit d’ailleurs considérer alors que nous n’avons pas réellement de caractère. Ce terme ne nous sert en fait qu’à enfermer les autres dans la compréhension que nous cherchons à nous faire d’eux. Et à ce qu’ils s’enferment eux-mêmes dans la représentation qu’ils se font de l’image que les autres se font d’eux (ce n’est pas dit très simplement, mais je ne vois pas comment faire mieux). Le caractère est lui aussi un terme par lequel nous simplifions et réduisons les autres aux limites qui sont les nôtres de les comprendre.
J’en termine donc sur cette question de la connaissancen en espérant ne pas avoir être trop confus et nébuleux. Il me reste le dernier billet de cette série sur le libre arbitre à écrire, par lequel, je tenterai en effet de sauver la notion de responsabilité, en dépit du sort que je me serai acharné à faire au libre arbitre. Pour cela, nous devrons, comme certains l’ont pressenti, passer par la question de l’identité. Et rappeler un fondement de gestion du stress : la différence irréductible qui existe entre être, faire et avoir.
P.S: il y a une sorte de petite plaisanterie dans ce billet. Un peu à trois bandes, donc sans doute plutôt ratée. Je me demande tout de même si l'un de vous la verra.
00:25 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |
Facebook |



