20/03/2007
Déterminismes et responsabilité
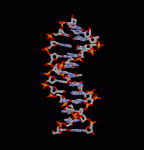 J’en termine avec ma série sur le libre arbitre, en espérant que cette parenthèse que j’ai ouverte n’aura pas été totalement vaine, malgré les quelques doutes que j’ai moi-même à ce sujet.
J’en termine avec ma série sur le libre arbitre, en espérant que cette parenthèse que j’ai ouverte n’aura pas été totalement vaine, malgré les quelques doutes que j’ai moi-même à ce sujet.
D’une certaine façon, je m’aperçois que j’ai peut-être un peu tourné autour du pot, en passant par tous ces billets pour dire une chose finalement assez simple : que cela nous plaise ou non, que cela corresponde à l’image que nous souhaiterions nous faire de notre identité ou pas, nous ne sommes que des individus biologiques. Nous sommes faits de briques, les mêmes que celles qui servent à construire le reste du vivant, mais agencées autrement, sans doute de façon plus complexe que le reste. Mais on a beau retourner cela dans tous les sens, je ne vois pas ce que nous pourrions être d’autre que des individus biologiques.
Prétendre autre chose n’est à mon avis rien d’autre que faire l’aveu de croyances irrationnelles, paranormales en quelque sorte, que celles-ci viennent d’une religion ou pas. C’est croire en l’existence de l’âme, cette impalpable substance ontologique que jamais personne ne palpa ni ne palpera (piki, mâtin, quelle poésie). Et pour ce qui me concerne j’avoue n’avoir encore jamais vu de petit nuage rosé s’élever au dessus d’une tombe.
Or cette biologie répond à des règles, elle est faite de mécanismes. S’exprimant dans une structure donnée, le corps, dont elle a pour objectif d’assurer la survie, cette biologie ne fait rien d’autre que répondre aux ordres qu’elle se donne à elle-même. Et d’assurer la survie de l’organisme. C’est sa raison d’être.
Cet ordonnancement biologique peut bien être d’une complexité insaisissable, car formé de multiples niveau d’organisation au sein même de l’organisme, répondant à plusieurs ordres simultanément, couplant des données internes et externes, jonglant avec l’image du passé qu’à formé notre mémoire, et les données immédiates du présent, tous ces stimuli sensoriels et émotionnels, et composer sur ces bases des réponses comportementales imprévisibles, cela ne change rien au fait que cette complexité reste biologique, et rien d’autre.
Or la notion de libre arbitre veut, par définition, qu’il soit possible à l’homme de se déterminer lui-même indépendamment de tout biais externe à la volonté pure, que ces biais soient externes (l’environnement et ses stimuli), ou interne (nos expériences passées, nos souvenirs, nos goûts, etc.). Qu’il soit possible de vouloir vouloir, c’est-à-dire d’autodéterminer sa propre volonté, sans qu’aucun motif ne vienne influencer celle-ci, et que celle-ci n’emprunte donc aucun élément empirique pour se fixer. Ce qui paraît tout à fait illusoire.
Mon doute concernant le libre arbitre s’est bien sûr raidi en grande partie à la lecture de Laborit. En lisant un biologiste, et de surcroit un neurobiologiste, il était difficile de ne pas être influencé par cette vision démystifiée de notre nature, mais qui peut-être, rentre dans une évaluation trop mécanique des choses (i.e. l’homme pris comme une machine). Mais c’est le point où j’en suis aujourd’hui.
Ce doute d’ailleurs a été renforcé en comprenant comment la notion du libre arbitre était née, il y a plusieurs siècles, en relation directe avec le besoin des théologiens et des philosophes de l’époque de justifier la position religieuse dominante, et de maintenir ainsi une image de Dieu qui préserve la structure sociale, et les schémas hiérarchiques de domination dont ils bénéficiaient eux-mêmes. L’idée de Dieu apporte beaucoup aux croyants d’un point de vue personnel, et pour cela je dois dire que je les envie presque. Mais socialement, elle ne remplit pas d’autre rôle, depuis qu’elle a été créée, que celui d’établir des hiérarchies (de valeur et donc, simultanément, de pouvoir), dans le domaine de l’irrationnel, celui du rationnel étant déjà naturellement affecté par ce mode de comportement. L’homme se boucle de tous les côtés.
La difficulté majeure à résoudre dés lors que l’on a rejeté le libre arbitre dans les limbes des illusions, est celle de la responsabilité. En effet, si nous sommes privés de libre arbitre et que nous répondons entièrement à des déterminismes biologiques, comment faire pour établir des jugements de valeurs sur nos comportements, pour donner un contenu quelconque au bien et au mal, au juste et à l’injuste, à toutes ces notions qui remplissent pourtant nos lois, et qui fondent donc l’organisation de nos sociétés ? Sans libre arbitre, songe-t-on, il n’y a plus de mérite, plus d’échelle d’évaluation des hommes, plus de morale non plus. Juger un homme pour ses déterminismes, c’est juger la nature toute entière, c’est juger le monde tel qu’il existe. Pourquoi faire porter ce fardeau à un seul homme ?
Alors qu’en fait non.
Raisonner de cette façon, en liant directement le libre arbitre, son absence, à la notion de responsabilité, c’est avoir une bien curieuse notion de l’existence, et une vision probablement faussée de ce qu’est l’identité. On procède en effet là comme si ces déterminismes existaient en nous comme des intrus, comme des autres que nous, comme des éléments extérieurs que nous ne saurions qu’observer en spectateurs. Comme si nous étions passifs devant leurs influences et leurs actions en nous. Dans le fond, nous avons probablement ce réflexe d’imaginer notre identité, notre moi, comme une substance magique, et même si insaisissable que nous-mêmes ne savons pas la saisir et l’embrasser.
Mais pour quelles raisons voudrions-nous que ces déterminismes, que cette biologie qui nous compose, ne soit pas nous-mêmes ? Par quel étrange détour de la pensée parvenons-nous à nous imaginer autrement que comme l’ensemble qui regroupe et unifie ces éléments ? Pourquoi ne voulons-nous pas comprendre que ces déterminismes sont ce moi, cette identité qui est la nôtre ? Sans doute voudrait-on, là encore, avoir le loisir de nous percevoir comme de plus grands mages que ce que cette vision permet d’entrevoir. Mais c’est là aussi une illusion.
Et ces déterminismes qui nous habitent, ne nous rendent en aucun cas passifs, ils ne remettent pas le moins du monde en cause notre capacité à agir, et que ce soit bien nous qui agissions, et nul autre être fantomatique en nous-mêmes. Lorsque nous agissons, peu importe que cela soit de façon déterminée, nous agissons. Point. Nous ne sommes pas des robots dont les membres sont tirés par des fils invisibles tenus par un autre moi fantasmé, mais nous les tirons nous-mêmes ces fils.
D’autre part, je voudrais profiter de ce sujet pour revenir sur un point qui me tient à cœur, que j’avais déjà indiqué il y a longtemps : il me semble important de savoir identifier, et évaluer séparément, être, faire, et avoir. Concernant l’avoir, le sujet ne m’intéresse pas beaucoup ici, et je ne m’y arrête donc pas. En revanche, je trouve important de rappeler qu’on ne peut pas assimiler l’être au faire. Que l’identité d’un homme, ne peut être réduite à ses actions, et que partant, on ne peut jamais le juger lui, mais seulement ses actes.
Or la responsabilité est liée au faire, et non à l’être. On ne rend jamais de compte de soi, mais seulement de ce que l’on fait. Et dans un tribunal, les sanctions qui condamnent un individu ne sont pas prononcées contre l’individu lui-même, mais contre ses actes. Ce n’est pas la nature de l’homme que l’on peut y remettre en cause, mais seulement la nature de ce qu’il a fait. Peu importe donc que nous soyons ceci ou cela, déterminé ou non. Notre responsabilité à rendre compte de nos actes ne s’en trouve aucunement amoindrie. Comprenez que sur ce point, je ne me situe pas exactement dans un cadre légal, et je n’entends pas dire quelles conclusions la justice devrait éventuellement tirer des analyses faites par les uns et les autres sur la question du libre arbitre. Je ne cherche pas à remettre en cause les principes existant qui atténue la peine lorsqu’un individu est déclaré non responsable de ses actes du fait de ses désordres psychologiques. Le fond de mon idée est que même dans cette situation, c’est bien cet individu que l’on recommande aux institutions de soins adéquates, et pas son enveloppe déterministe, et encore moins son âme.
Il y aurait sans doute encore beaucoup à dire sur cette question, et notamment sur ce dernier point des conséquences à tirer de cette analyse d’un point de vue juridique. Je m’en tiendrai toutefois là. Vous pouvez bien sûr aborder ces points en commentaires si vous le souhaitez.
14:30 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (10) | ![]() Facebook |
Facebook |
13/03/2007
Nos dénis courants
 Deuxième petit billet inspiré par ce qu’a écrit Matthieu récemment, cette fois-ci sur ce que j’appellerais nos dénis courants. Je ne vais pas à cette occasion revenir en détail sur la notion de déni, puisque j’ai déjà abordé cette question au détour d’un billet ancien. Pour faire court simplement, le déni est une réponse comportementale que l’on utilise lorsque la vérité est trop dure à reconnaître et qu’elle implique un déséquilibre intérieur trop fort. Pour ne donner qu’un seul exemple on peut évoquer la personne alcoolique, qui culpabilisant à l’extrême de son attitude, jure qu’elle n’a jamais bu, même lorsqu’on la prend sur le fait. La reconnaissance de la réalité de son attitude étant une douleur trop forte, la personne est amenée à nier jusqu’à l’évidence la plus crue, et cela dans des proportions qui peuvent étonner.
Deuxième petit billet inspiré par ce qu’a écrit Matthieu récemment, cette fois-ci sur ce que j’appellerais nos dénis courants. Je ne vais pas à cette occasion revenir en détail sur la notion de déni, puisque j’ai déjà abordé cette question au détour d’un billet ancien. Pour faire court simplement, le déni est une réponse comportementale que l’on utilise lorsque la vérité est trop dure à reconnaître et qu’elle implique un déséquilibre intérieur trop fort. Pour ne donner qu’un seul exemple on peut évoquer la personne alcoolique, qui culpabilisant à l’extrême de son attitude, jure qu’elle n’a jamais bu, même lorsqu’on la prend sur le fait. La reconnaissance de la réalité de son attitude étant une douleur trop forte, la personne est amenée à nier jusqu’à l’évidence la plus crue, et cela dans des proportions qui peuvent étonner.
Revenons-en à la question de Matthieu dans son billet sur l’attachement de certains à la religion. Matthieu indiquait dans son billet qu’une amie à lui, de formation scientifique et ayant la tête parfaitement sur les épaules, lui avait un jour indiqué que selon elle la théorie créationniste était tout à fait crédible. On comprend que cela puisse surprendre. Je ne compte pas répondre précisément sur ce qui peut amener cette personne à cette croyance, mais plutôt esquissé une petite piste de compréhension.
Celle-ci tient en quelques mots : nos comportements sont bourrés de petits dénis, de paradoxes si vous préférez, de contradictions. Celles-ci sont parfois évidentes vues de l’extérieur, c’est le cas de l’exemple de l’amie de Matthieu il me semble, mais le plus souvent, ils restent plutôt bien camouflés. Tentons quelques exemples pour illustrer cela :
Le plus simple de tous est celui de notre attitude en voiture, lorsque nous conduisons. Lorsque nous conduisons vite, nous râlons contre les lambins qui nous freinent ou empêchent certaines de nos manœuvres par leurs hésitations (peut-être cherchent-ils leur chemin). Mais lorsque nous conduisons lentement, nous nous mettons souvent à ironiser sur ceux qui filent à vive allure, raillant les deux minutes en plus qu’ils auront gagnées devant leur télé, ou pestant contre leur klaxon alors que nous n’avons pris que 2 secondes pour trouver le point de rendez-vous que l’on cherchait. Et dans les ceux cas, nous terminons par un ferme et définitif : « vraiment, les gens ne savent pas conduire ! ».
Il ne va de même pour un grand nombre de comportements liés à l’urbanisme, où l’on se retrouve en prise directe avec une foule. Par exemple, pris dans le flot des fans qui s’arrachent les tickets au dernier concert de leur idole, tous jouent des coudes, en pestant contre leurs voisins qui les imitent, alors qu’ils se porteraient probablement mieux en se tenant calmement, et je parie même que les probabilités de chacun d’acquérir le précieux sésame ne s’en trouverait guère changées.
Le fond de cette illustration, c’est un peu celui que j’indiquais récemment ici. Essayez de porter votre attention sur vos comportements quotidiens, et de détecter vos petits dénis courants, vos paradoxes internes. Avec une démarche un peu honnête, vous devriez en trouver rapidement plusieurs.
Mais comment dans le fond peut-on expliquer cela ? Comment se fait-il que parfois même les cerveaux les mieux composés (vous dirais-je à quel célèbre blogueur je pense à l’instant même ?), qui savent argumenter brillamment pour expliquer leurs attitudes et leurs choix tombent eux aussi, et finalement autant que les autres, dans ces travers invisibles ? L’affaire est à mon avis toute simple à résoudre : fondamentalement, nos comportements ne sont pas issus de nos convictions, mais de nos intérêts et des moyens que nous avons découverts au fil de nos expériences pour les satisfaire. Ce n’est qu’à posteriori que nous avons construit notre schéma intellectuel de justification de nos penchants, de nos biais, et que nous avons appelé tout ce magma nos convictions.
Vous en doutez ? Combien êtes-vous à déclarer à vos proches que votre métier ne vous passionne pas, que dans le fond vous savez bien que tout cela ne sert à rien, qu’il faudrait rompre avec ce système aliénant. Et combien, une fois au travail, à répondre oui avec le sourire à votre patron que vous vilipendiez la veille, à justifier tel ou tel choix de la direction, histoire de vous montrer « corporate » comme on dit ? Dans mon métier, je le vois tous les jours, je peux vous l’assurer. Et je ne suis même pas le dernier à pratiquer tout cela. Car sinon, ce ne serait tout simplement pas tenable. La divergence entre ces belles opinions affichées et le vécu auquel nous pensons devoir nous soumettre est telle que psychologiquement, nous avons besoin de ces petits dénis pour conserver notre équilibre intérieur. C’est toute l’essence du déni.
Pour répondre à Matthieu donc, mais c’est utilisable aussi par les autres, si vous vous trouvez à nouveau devant ce type de paradoxe, ne vous demandez pas quelles sont les convictions de la personne que vous avez en face de vous et qui manifeste ces contradictions, mais cherchez plutôt quelles expériences personnelles peuvent expliquer cette orientation intime. Vous y trouverez probablement pas mal de pistes.
23:58 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook |
Facebook |
08/03/2007
Le monstre, c'est l'inconnu
 Je lance deux billets pour rebondir sur le billet de Matthieu dans lequel il s’interroge sur le sens de la religion chez les croyants, et pour répondre, en partie, à sa perplexité devant certaines croyances qu’il juge étonnant de trouver chez des scientifiques pur jus. Le premier, celui que vous êtes en train de lire, sur la question de l’inconnu, le deuxième, sur ce que j’appellerai pour faire simple, nos dénis courants.
Je lance deux billets pour rebondir sur le billet de Matthieu dans lequel il s’interroge sur le sens de la religion chez les croyants, et pour répondre, en partie, à sa perplexité devant certaines croyances qu’il juge étonnant de trouver chez des scientifiques pur jus. Le premier, celui que vous êtes en train de lire, sur la question de l’inconnu, le deuxième, sur ce que j’appellerai pour faire simple, nos dénis courants.
L’inconnu d’abord. Matthieu reprend dans ses premières pistes d’explication de la construction de la croyance, le principe de raisonnement cause/effet que nous utilisons tous de façon très naturelle. Celui-ci signifie simplement que lorsque nous constatons un événement, un effet donc, notre réflexe est toujours d’en rechercher la cause, de la rattacher à une chaîne causale qui permet d’expliquer et de comprendre sa survenance dans l’espace et dans le temps. C’est une coïncidence amusante pour moi de relire cette idée chez Matthieu, car j’ai lu exactement la même dans l’Essai sur le libre arbitre de Schopenhauer. Il rappelait lui aussi, à de toutes autres fins démonstratives, je le précise, l’existence de ce principe causal si ancré en nous que nous lui faisons toujours appel pour comprendre ce que nous vivons.
Ce principe de recherche du couple cause/effet, me semble pouvoir s’expliquer, du moins en partie, très simplement par le seul fait de l’existence du temps. C’est la notion de temps qui nous fait rattacher les événements entre eux, qui nous fait les associer, leur donner une unité, une cohérence. Si on y réfléchit bien, c’est quasiment tautologique.
Ce qui est plus intéressant en revanche, c’est de s’interroger sur le besoin d’expliquer, de comprendre, de chercher la cause à l’effet. On pourrait lancer un beau marronnier en répétant que c’est là le signe que l’homme est un animal curieux, avide de compréhension du monde, que dés qu’il a commencé à établir des stratégies d’utilisation d’outils pour assurer sa subsistance il est devenu un scientifique, que cette avidité de connaissance lui est intrinsèque, etc.
Mais le point qui m’intéresse ici surtout, c’est notre réaction vis-à-vis de l’inconnu. Pour synthétiser mon idée, l’inconnu pour nous, c’est le monstre. Ce qui nous est non compréhensible, non explicable, non saisissable par une image dans notre esprit (toujours liée à ce que nos sens physique sentent ou ont un jour ressenti) nous apparaît inquiétant, suspect, dangereux. L’inconnu nous laisse dans l’instabilité, sans repère, sans orientation sur la façon d’agir face à lui.
Deux exemples pour illustrer mon propos. D’abord, celui de la xénophobie. Je l’avais indiqué dans ma série sur le sujet du racisme et de l’antisémitisme, il y a donc pas mal de temps désormais, un paradoxe apparent que l’on rencontre dans les études sur le racisme est que l’on trouve souvent les populations les plus xénophobes parmi celles qui n’ont jamais rencontré le moindre étranger sur leur sol. C’est le cas en France dans certaines campagnes, où l’inquiétude manifestée vis-à-vis de l’immigration est étonnant élevée pour des régions qui ne sont guère touchées par ce phénomène.
Deuxième exemple, celui du monstre que nous avons dans notre placard ou sous notre lit lorsque nous sommes petits. On a tort de penser que les enfants ont peur du noir, ou en tout cas c’est là une vision trop superficielle de ce qui se joue dans leurs esprits imaginatifs lorsqu’ils s’en vont se coucher. Le noir ne fait pas peur parce qu’il est noir, mais parce qu’en masquant les choses aux yeux des enfants, il rend l’espace qui les entoure mystérieux et inconnu, alors même que la seconde avant d’éteindre la lumière ils pouvaient encore en voir tous les contours. C’est cet inconnu qui les fait imaginer un monstre soudain surgit sous leur lit.
D’une certaine façon donc, on peut admettre que c’est peut-être la peur de l’inconnu, plus que le goût de la découverte, qui fonde l’intérêt de l’homme pour la science et pour la recherche. Cela ne signifiant nullement pour autant que cette quête est mauvaise ou déplacée.
Demain, si je ne suis pas mort en rentrant du boulot, j'écrirai le billet suivant sur les dénis courants.
00:23 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
06/03/2007
Le libre arbitre et la question du caractère chez Schopenhauer
 Je reviens donc comme prévu sur la question de la connaissance, par un biais assez différent de celui abordé plus tôt aujourd’hui, puisque je vais revenir un peu sur l’Essai sur le libre arbitre de Schopenhauer.
Je reviens donc comme prévu sur la question de la connaissance, par un biais assez différent de celui abordé plus tôt aujourd’hui, puisque je vais revenir un peu sur l’Essai sur le libre arbitre de Schopenhauer.
Dans son livre, Schopenhauer revient notamment sur un élément clé de sa démonstration contre le libre arbitre : celui du caractère. Son idée en effet, est que nos comportements résultent à la fois de notre caractère, sorte de noyau identitaire par lequel on pourrait définir notre être, et des circonstances, dans lesquelles ce caractère qui est le nôtre nous fait mettre en œuvre telle ou telle réponse comportementale aux situations que nous vivons.
Schopenhauer, adversaire de cette illusion qu’est le libre arbitre, avance dans son argumentation qui me semble toutefois étrange, sinon erroné : celui que ce caractère que nous avons, ce noyau, est chez chacun de nous parfaitement immuable, et qu’en conséquence, mis en face des mêmes situations, nous ne pourrions guère agir d’une façon différente entre une période et une autre. Il écrit ainsi :
« Le caractère de l’homme est invariable. Il reste le même pendant toute la durée de sa vie. Sous l’enveloppe changeante des années, des circonstances où il se trouve, même de ses connaissances et de ses opinions, demeure, comme l’écrevisse sous son écaille, l’homme identique et individuel, absolument immuable et toujours le même. » Pour Schopenhauer donc, l’idée qu’un homme peut réellement évoluer, et se changer lui-même, n’est qu’une illusion. Il laisse toutefois, après ce paragraphe, la porte un peu ouverte pour que quelques détails en nous puissent se mouvoir, mais si jamais nous parvenons, dit-il, à modifier une fois notre comportement, ce n’est que pour replonger bien vite dans ce que nous sommes fondamentalement et qui jamais n’a réellement bougé.
La seule chose que nous puissions réellement changer en nous, ce n’est dans le fond pas notre caractère, mais seulement notre connaissance. C’est-à-dire qu’il nous est possible d’apprendre à utiliser de meilleurs moyens, plus efficaces, de parvenir à nos fins, mais que cet apprentissage ne change rien à notre caractère qui nous fait toujours vouloir la même chose, peu importe que nous ayons appris une nouvelle manière de l’obtenir.
On peut tenter un exemple simple pour illustrer ce point : celui des divers moyens de motivation dont on peut être amené à user pour influencer une personne à agir conformément à nos souhaits. Les plus célèbres sont la carotte et le bâton n’est-ce pas ? Traditionnellement nous serions assez portés, après avoir vu une personne user de menace, puis promettre telle ou telle gratification en remerciement de l’action souhaitée, à estimer que celle-ci s’est donc bien adoucie, et qu’en ceci, elle a changé. Alors que son fond reste parfaitement identique, puisque l’objet de sa quête n’a varié en rien, et que si ses moyens pour y parvenir nous sont moins odieux, elle n’en est peut-être pas moins prête à tout, mais sous une nouvelle forme, pour obtenir son gain.
Ainsi donc, la connaissance modifiée des choses, est un facteur susceptible de nous faire changer de comportement. Pour ma part, je crois même, comme je le disais ce matin, que c’est elle qui est fondamentalement en cause dans notre façon de réagir à telle ou telle situation.
Mais ce redressement qui a lieu ne concerne, selon Schopenhauer, que notre connaissance. Notre caractère ne s’en trouve lui aucunement modifié, et il reste invariablement identique.
Je trouve cet argument de Schopenhauer assez étrange. Sa démonstration d’ailleurs m’apparaît assez embrouillée, lorsqu’il s’embarque dans l’explication de certaines de nos croyances populaires, comme celle d’un mal rattaché pour toujours à un homme, lorsqu’une seule fois il a commis un méfait : « voleur un jour, voleur toujours », rappelle-t-il, ou encore lorsqu’il indique que trahis par un proche nous disons toujours que celui-ci nous a abusé, plutôt qu’il a changé.
Schopenhauer me semble ériger ici un simple biais subjectif en principe universel. Et ceci sur une seule base : celle que notre caractère n’est en réalité que ce noyau ontologique qui nous définit, et qui jamais ne saurait changer.
Ce que je ne vois vraiment pas dans cette démonstration qu’il fait, c’est d’où sort ce moi mystérieux et immuable qui, selon lui, nous définirait. A part à l’expliquer par la magie ou le paranormal, je ne vois aucune façon d’en rendre compte. Et on ne saurait en aucun cas dire que ce caractère évoqué par Schopenhauer est constitué par notre capital génétique puisque celui-ci n’est qu’un potentiel, lors qu’un caractère renferme en lui la notion d’une chose qui a déjà émergé, qui s’est réalisée.
Schopenhauer ignore en fait totalement le rôle joué par la mémoire dans la constitution de ce que nous sommes. Il s’égare à mon avis dans une vision formatée de l’être, qui voudrait que l’homme soit constitué d’un noyau individuel incorruptible qui constituerait son identité propre et à nul autre pareil. Quand notre « personnalité » n’est en réalité issue que des expériences qui parcourent notre vie, des émotions que nous leur rattachons, et des moyens comportementaux que notre éducation aura mis à notre portée pour atteindre nos objectifs. Il n’y a en nous aucun noyau, aucun caractère primordial qui persisterait en nous et ferait de nous des rocs immuables et répétant inlassablement les mêmes choses dans les mêmes situations. Nous sommes avant tout autre chose des cerveaux qui sentent, ressentent, et travaillent ces matières premières que sont les sensations et les sentiments pour les transformer en actions (la pensée étant à mon sens un mode d’action). Des éponges si vous préférez, plus ou moins absorbantes d’un individu à l’autre.
D’une certaine façon, on doit d’ailleurs considérer alors que nous n’avons pas réellement de caractère. Ce terme ne nous sert en fait qu’à enfermer les autres dans la compréhension que nous cherchons à nous faire d’eux. Et à ce qu’ils s’enferment eux-mêmes dans la représentation qu’ils se font de l’image que les autres se font d’eux (ce n’est pas dit très simplement, mais je ne vois pas comment faire mieux). Le caractère est lui aussi un terme par lequel nous simplifions et réduisons les autres aux limites qui sont les nôtres de les comprendre.
J’en termine donc sur cette question de la connaissancen en espérant ne pas avoir être trop confus et nébuleux. Il me reste le dernier billet de cette série sur le libre arbitre à écrire, par lequel, je tenterai en effet de sauver la notion de responsabilité, en dépit du sort que je me serai acharné à faire au libre arbitre. Pour cela, nous devrons, comme certains l’ont pressenti, passer par la question de l’identité. Et rappeler un fondement de gestion du stress : la différence irréductible qui existe entre être, faire et avoir.
P.S: il y a une sorte de petite plaisanterie dans ce billet. Un peu à trois bandes, donc sans doute plutôt ratée. Je me demande tout de même si l'un de vous la verra.
00:25 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |
Facebook |
05/03/2007
Le libre arbitre et l'ignorance
 Le 5ème billet prévu dans ma série sur le libre arbitre doit aborder la question de la connaissance. Pour être franc, ayant maintenant un peu de recul sur ce que j’ai produit sur le sujet du libre arbitre, je ne suis pas sûr que ce que je voulais dire sur ce point spécifique de la connaissance soit franchement déterminant et mérite plus qu’un court détour. Mais je vais tout de même me tenir au programme que je me suis fixé, et vous entretenir durant quelques courts paragraphes de cette question.
Le 5ème billet prévu dans ma série sur le libre arbitre doit aborder la question de la connaissance. Pour être franc, ayant maintenant un peu de recul sur ce que j’ai produit sur le sujet du libre arbitre, je ne suis pas sûr que ce que je voulais dire sur ce point spécifique de la connaissance soit franchement déterminant et mérite plus qu’un court détour. Mais je vais tout de même me tenir au programme que je me suis fixé, et vous entretenir durant quelques courts paragraphes de cette question.
Mon idée sur ce point est que nos actions sont souvent bien plus le reflet de notre ignorance que de notre volonté. Dit autrement, si nous en savions plus sur les événements dans lesquels nous nous trouvons, sur les causes qui les provoquent, sur celles qui peuvent conduire aux effets que nous souhaitons, et bien nous agirions souvent d’une façon toute autre que celle que nous mettons en œuvre.
Dit encore d’une autre façon, il me semble que si l’on y réfléchit bien, en supposant que chaque homme ait une connaissance parfaite en toute chose, je ne vois pas de raison pour que ceux-ci, plongés dans des situations identiques, agissent de façons différentes. Car je prends pour acquis que fondamentalement nous aspirons tous à la même chose : le bonheur. Si donc, nous avions tous acquis une connaissance parfaite des moyens d’y parvenir, des comportements qui y donnent accès, je ne vois pas de bonne raison qui pourrait expliquer la si grande diversité de nos comportements d’un individu à l’autre.
On m’objectera probablement que cette vision des choses ignore totalement la notion de caractère. Et que Jean n’ayant pas le même caractère que Sophie, il est incorrect de prétendre que, tous deux placés dans une situation identique, agiraient de la même façon. Car notre comportement est bien la résultante de la façon dont nous (en fonction de notre caractère) interprétons et interagissons avec notre environnement. Et que leurs causes ne peuvent donc être réduites aux influences des circonstances, ce que mon paragraphe précédent pourrait laisser croire.
Mais même sur ce point, mon idée me semble valide. Car une connaissance parfaite des choses, par définition, ne peut être qu’une. C’est-à-dire qu’il ne peut en exister plusieurs. C’est l’essence de la notion de perfection que d’interdire la diversité. Puisque tout écart, tout changement vis-à-vis de cette perfection, quand bien même celle-ci ne serait qu’une hypothèse d’école, ne peut qu’être une dégradation, une corruption de cette perfection. Ou alors c’est que l’élément dont on s’est écarté n’était pas la perfection.
La diversité de nos caractères n’indique donc que leur imperfection. Ce qui signifie in fine, qu’ayant une connaissance parfaite des choses, on doit probablement supposer que nos caractères eux-mêmes seraient identiques, bien qu’on les perçoit toujours comme étant en nous comme des noyaux identitaires intouchables. D’ailleurs pour enfoncer le clou, nos caractères ne sont en réalité que la résultante de notre éducation, de ce que notre environnement à mis en nous. Or ces éducations, si elles étaient imprégnées d’une connaissance parfaite de ce qui vaut le mieux pour nous, n’auraient pas de raison d’être différentes. Et partant, elles formeraient probablement en nous les mêmes caractères.
Qu’on ne se trompe pas sur mon compte toutefois. Cette analyse n’est bien évidemment qu’un cas d’école, qu’un point de vue théorique pour montrer en quoi notre ignorance entre en jeu dans nos comportements. Je ne cherche ici qu’à montrer en quelque sorte que c’est plus la question de la connaissance que celle de la volonté, qui permet d’expliquer et de rendre compte de nos actions. Rien d’autre. Et en aucun cas je ne prétends qu’il serait souhaitable que nous ayons tous une connaissance parfaite des choses, et que nous ayons tous les mêmes comportements dans une situation donnée. Tout d’abord je ne crois pas une seconde qu’une connaissance parfaite de toute chose, et même d’une seule, soit un jour possible à quiconque, et l’éventualité que nous nous mettions à tous agir de la même façon dans des situations identiques ne m’enthousiasme guère.
Je vais revenir rapidement sur cette question de la connaissance, en refaisant un petit tour par l’ouvrage de Schopenhauer que j’ai indiqué dans mon billet précédent, en partant d’un angle très différent, qui critique une des positions qu’il tient dans son livre.
11:05 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook |
Facebook |
01/03/2007
L'âne de Buridan et le dilemme du choix
 Ce qu’il y a de terrible avec les séries, c’est qu’on les lance guilleret, en songeant à tout ce qu’on pourra y écrire d’intéressant et d’indispensable à la vie des gens, mais qu’une fois qu’elles sont entamées, on n’en voit pas la fin. C’est un peu le cas actuellement de ma série sur le libre arbitre, qui devait pourtant initialement être « courte ». D’aucun penseront sans doute que c’est le signe que je suis à court d’argument. Mais en fait, durant les précédentes semaines j’ai surtout été à court de temps, et, je dois bien l’avouer, à court d’envie d’écrire sur ce blog.
Ce qu’il y a de terrible avec les séries, c’est qu’on les lance guilleret, en songeant à tout ce qu’on pourra y écrire d’intéressant et d’indispensable à la vie des gens, mais qu’une fois qu’elles sont entamées, on n’en voit pas la fin. C’est un peu le cas actuellement de ma série sur le libre arbitre, qui devait pourtant initialement être « courte ». D’aucun penseront sans doute que c’est le signe que je suis à court d’argument. Mais en fait, durant les précédentes semaines j’ai surtout été à court de temps, et, je dois bien l’avouer, à court d’envie d’écrire sur ce blog.
Mais mes lectures me relancent un peu sur le sujet, et j’en profite donc.
Aujourd’hui, le point que je voudrais donc aborder est celui du choix. La thèse centrale des tenants de l’existence du libre arbitre est que dans le fond, nous sommes capables d’exercer notre volonté librement, ce qui est selon eux prouvé par notre aptitude à effectuer des choix aléatoire, dénués de liens d’intérêt. On résume cela par une formule simple : la liberté d’indifférence, à savoir la faculté de rester indifférent à tout motif censé influencer nos actes, et de n’effectuer nos choix que mus par une volonté purement libre.
Cela présuppose donc la possibilité d’exercer notre volonté sans que celle-ci ne dépende de rien. Comme si elle était en quelque sorte sa propre cause. Un billet n’est pas très approprié pour rentrer dans tous les détails de cette question, mais il me semble relativement clair que cette supposition d’une volonté cause d’elle-même est pour le moins douteuse.
Dans le fond, l’argument qui fonde cette idée est que dans toute situation nous sommes aptes à choisir de multiples voies, différentes les unes des autres, et ce seul fait montre bien que nous sommes libre de nos actions. Lorsque le soir je quitte le travail, je peux très bien rentrer directement chez moi, ou partir me promener, ou aller boire un verre avec des amis, ou même encore partir pour l’aéroport et un faire voyage impromptu, entamer une traversée de la France à pied, ou en faisant des roulades tout le long du trajet. Bref, tout cela, je le peux.
Mais on voit bien, et j’ai pris exprès des exemples improbables pour que l’on s’en aperçoive clairement, qu’il y a là un petit problème dans l’usage que nous faisons de ce mot : pouvoir. Car le fait qu’un scenario entre dans le champ des possibilités qui me sont ouvertes à un instant t ne dit absolument rien sur la capacité qu’à ma volonté à s’extraire des motifs extérieurs qui m’influencent lorsque j’établis mes choix. Autrement dit, oui, je peux faire tout cela, mais pourtant, dans la très grande majorité des cas, je vais « choisir » de rentrer directement chez moi car je suis fourbu.
Et là encore, le fait que je ne sois parfois pas capable de distinguer clairement quels sont les motifs qui interviennent dans l’influence de ma volonté ne dit rien non plus quant-à l’indépendance de celle-ci vis-à-vis de ces motifs.
Schopenhauer a écrit un petit livre très instructif sur cette question, l'Essai sur le libre arbitre, d’où je tire la conclusion qui me paraît la meilleure quand à cette question du choix : dans une situation donnée, le choix que nous faisons est le strict reflet de l’importance des motifs qui interviennent en nous. Le plus fort l’emportant globalement sur les autres (mais lisez le reste, là c’est vraiment très, très partiel comme compte-rendu).
La question à résoudre est donc plutôt de comprendre d’où proviennent nos choix. De quoi sont-ils le fruit ?
Pour répondre à cette question, et comme je me l’étais proposé en introduction de cette série, je propose de séparer l’analyse en deux cas distincts : les choix portant sur des alternatives sans importance, et celui portant sur des alternatives importantes.
Le premier cas est le moins clair puisque c’est celui où l’on ne saura pas identifier les motifs de nos actions. Mais dans le fond la réponse n’est pas très complexe pour autant et elle est même quasiment déjà contenue dans la première phrase du ce paragraphe : c’est l’inconscient qui intervient principalement à ce niveau. Sinon, nous saurions identifier ces motifs qui interviennent. Ce sont donc nos mécanismes inconscients, nos habitudes comportementales ancrées en nous, qui font que nous allons par exemple démarrer la journée en posant le pied droit plutôt que le gauche. D’ailleurs, j’ai déjà remarqué sur ces pages que si nous parvenions à prendre un peu de recul sur ce moment d’absence que nous avons presque tous au lever, nous nous apercevrions que nous posons toujours le même pied en premier par terre.
Le deuxième cas n’est pas très compliqué à résoudre non plus. Lorsque les alternatives nous paraissent d’importances différentes, il est bien évident que c’est l’alternative la plus lourde de conséquence, que ce soit en plaisir ou en déplaisir, qui est prise en compte en priorité. En fait le seul vrai cas qui pose problème est celui du type du dilemme de l’âne de Buridan.
La petite histoire de ce dilemme est que l’âne de Buridan, se trouvant à égale distance d’un picotin d’avoine et d’une écuelle d’eau, attribuant la même valeur à l’un et à l’autre, ne sait vers lequel se diriger en premier. Et ainsi perdu dans les méandres d’une alternative insoluble, il finit par mourir entre les deux, en n’ayant pas pu esquisser le moindre pas. La thèse du libre arbitre dit ici que l’homme se distingue en ceci de l’âne du Buridan qu’il est lui bien capable d’effectuer un choix, au hasard entre le picotin et l’écuelle, ce qui va lui permettre au final de goûter aux deux et dons de ne pas mourir.
Mais il y a deux erreurs dans ce raisonnement. La première c’est qu’un cas où deux alternatives seraient de très exacte importance à nos yeux ne restera jamais qu’un cas d’école, qu’une expérience théorique, et que la réalité ne nous proposera jamais rien de tel. Si nous estimons à tel ou tel moment que c’est le cas, c’est là encore uniquement le signe que nous sommes aveugles quant-à l’impact des motifs qui nous influencent. Le seul fait que deux choses soient différentes suffit pour que leurs caractères nous soient eux aussi différents. Peut-être n’est-ce pas toujours très marqué, mais cette différence suffit à rendre inopérante l’analyse par l’âne de Buridan.
La deuxième erreur que l’on commet ici est que l’on transforme une anecdote pour l’esprit en expérience réelle, en supposant qu’il existe bien un âne incapable de déterminer un mode d’action lui permettant d’accéder à la fois au picotin et à son eau. En fait, on évoque trompe le cours du raisonnement en positionnant une conclusion (l’âne de sait pas choisir) en hypothèse. Et comme par enchantement, on conclut par l’idée même qui nous a servi de point de départ. Quelle surprise. On voit bien là dans quels pièges nous sommes parfois susceptibles de nous emmener nous-mêmes si nous ne prenons garde à l’usage que nous faisons des mots. L’anecdote de l’âne de Buridan, donc, n’est dans le fond qu’une imposture, une manipulation de l’esprit (mais probablement une manipulation sincère, car faite en toute inconscience de ce qu’elle est).
Pour conclure, je dirai en quelques mots que ce qui guide nos actions, c’est, comme le disait Schopenhauer dans le petit livre indiqué plus haut, la combinaison des motifs extérieurs qui existent au moment où nous avons à choisir (l’espace dans lequel nous nous trouvons, le temps, etc.), et de nos motifs intérieurs (notre éducation, nos habitudes, nos goûts, etc.). Mais à aucun moment notre volonté ne peut agir en étant dégagée de ces motifs. Il n’est donc pas interdit de se demander s’il s’agit bien là d’une volonté. En quelque sorte, il ne pourrait y avoir de volonté que celle qui consisterait à vouloir vouloir.
Je ne m’aventure pas plus loin sur cette question, bien que je sois conscient que ce billet porte sans doute plus de questions que de réponses. Je renvoie toutefois encore au petit bouquin de Schopenhauer qui est à la fois clair et bien écrit. Il y a toutefois un point sur lequel je ne suis pas d’accord avec lui. Celui qui veut que nos motifs intérieurs, nos déterminismes propres, ne changent jamais et ne peuvent produire, à toute époque, que les mêmes résultats. Cela me semble ignorer complètement le rôle de l’apprentissage et de la mémoire dans notre construction personnelle. J’y reviendrai peut-être plus tard.
00:40 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (11) | ![]() Facebook |
Facebook |
26/02/2007
Deux idées sur l'accompagnement
Cela permet d’abord de rester dans une relation d’égal à égal avec la personne accompagnée, ce qui est un des points qui me semblent les plus importants. J’avais indiqué dans mon étude sur ces questions qu’en effet la relation de dépendance, entre ce que j’appelais alors aidant et aidé, faisait prendre un double risque : celui d’humilier la personne aidée, et donc de prendre le risque qu’elle refuse cette aide qui l’abaisse, et également qu’en créant une dépendance trop forte on la privait de ces propres armes, de la maîtrise de son propre chemin qu’il lui faudra pourtant bien retrouver un jour si l’on entend que l’aide qu’on lui a apportée soit réellement efficace. Car au bout du compte ce sera bien à elle, dans la plus grande mesure possible, de reprendre les rennes.
La notion d’accompagnement donc, permet d’appréhender ces relations d’une façon probablement plus sereine pour les personnes y intervenant, plus riches aussi, car elle par de l’idée d’un échange entre les personnes.
Je voudrais aujourd’hui proposer deux idées qui me sont venues au sujet de l’accompagnement, et sur la façon dont il me semble possible de le mettre en place : d’abord ce que j’appelle l’exemplarité comportementale, puis une notion qui me tient de plus en plus à cœur, et sur laquelle je prévois d’ici quelques temps de revenir de façon approfondie sur ce site : la proximité humaine.
L’exemplarité comportementale est je crois une notion clé dans certaines démarches de psychothérapie. Elle signifie que le « patient » peut être plus secouru par le comportement du thérapeute que par ses mots. J’ai déjà dis une ou deux fois quelles peuvent être les limites des conseils adressés à une personne qui va mal. Les « tu verras ça ira mieux, « les « si j’étais toi », tout cela est parfois non seulement inefficace, mais pire, contre productif dans la démarche que l’on entend avoir. Parce que l’on tente souvent, naturellement, par nos conseils d’enfermer l’autre dans la compréhension que nous avons de lui, ce qui non seulement l’humilie, mais le laisse surtout encore un peu plus seul, puisqu’encore un peu moins écouté, un peu moins compris.
En revanche, il est possible d’apporter beaucoup par son comportement. En vivant sa propre sérénité, on peut l’offrir en même temps à ceux qui nous entourent. On joue pleinement ici sur le jeu de miroir qui existe dans toute relation interpersonnelle, sur le mimétisme que nous avons tous appris depuis notre plus jeune âge. C’est désormais sans doute un poncif, mais ce mimétisme existe bel et bien. Il est en grande partie le reflet de notre besoin de reconnaissance et d’appartenance à un groupe. Et ainsi, en laissant s’exprimer notre paix intérieure, il nous est possible de l’insuffler un peu mieux à ceux que nous souhaitons soutenir. C’est une méthode qui me semble particulièrement faire ses preuves en psychothérapie car dans ce domaine le langage non verbal, corporel en particulier, joue un rôle primordial.
C’est cela pour moi l’exemplarité comportementale. Inviter librement l’autre dans un cadre serein et apaisé, en le créant soi-même par son attitude. Le terme est peut-être un peu mauvais d’ailleurs car la notion d’exemplarité peut faire croire à la prétention d’être un modèle, de se hisser au-dessus des autres pour distribuer la bonne parole. C’est tout le contraire.
La deuxième idée donc, c’est la proximité, celle exactement dont parlait Levinas dans le reportage que j’ai commenté ici il y a quelques mois. Cette proximité qui n’est surtout pas une façon de phagocyter et parasiter l’espace intime de l’autre, cette bulle qui nous entoure, qui est plus ou moins grande chez les uns et les autres, et qui constitue les limites de notre espace vital, de notre intimité, qui dessine les contours de notre pudeur. Surtout pas une tentative de s’imposer donc, mais simplement l’expression d’une attention, d’une écoute sincère, d’une présence pour dire à l’autre que s’il le veut, il n’est pas seul.
C’est, pour reprendre les termes de Lévinas, donner la paix sans foutre la paix. En étant là, vraiment là, et pas simplement en docteur paternaliste qui s’oublie dans ses propres conseils. Et en laissant aussi l’autre être là, prendre la place qu’il souhaite, en l’aidant peut-être à l’agrandir un peu.
Cette proximité, on le comprend aisément, n’est pas qu’un outil thérapeutique. Elle est aussi à mon avis l’objectif que doit se donner une société si elle veut être unie, et ne pas se résumer à un pacte de non agression et à la régulation des échanges marchants. J’espère y revenir bientôt.
00:32 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
13/02/2007
Avant d'aller dormir, comptons les moutons
"[…] L’homme de troupeau se donne aujourd’hui en Europe l’air d’être la seule espèce d’homme autorisée : il glorifie les qualités qui le rendent doux, traitable et utile au troupeau, comme les seules vertus réellement humaines : telles que la sociabilité, la bienveillance, les égards, l’application, la modération, la modestie, l’indulgence, la pitié. Mais dans les cas où l’on ne croit pas pouvoir se passer des chefs, des moutons conducteurs, on fait aujourd’hui essais sur essais pour remplacer les maîtres par la juxtaposition de plusieurs hommes de troupeau intelligents, c’est, par exemple, l’origine de toutes les constitutions représentatives. Quel bien-être, quelle délivrance d’un joug insupportable malgré tout, devient, pour ces Européens, bêtes de troupeau, la venue d’un maître absolu."
Nietzsche, Par delà le bien et le mal
Le troupeau bêlant vers son surfeur d’argent, son sauveur ultime, celui qu’il veut le voir l’asservir comme dans un rêve. Comme le champion de ses valeurs qui ne sont plus que des gants sans main.
22:50 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
01/02/2007
Critique du mérite
 Après avoir vu, de façon sans doute un peu courte, les questions qui pouvaient à mon avis être soulevées du point de vue de la morale quant à l’existence ou l’inexistence du libre arbitre, j’en viens maintenant à la question du mérite. J’espère que vous m’en excuserez, mais sur ce point, je ne compte pas vraiment vous ménager. Sans toutefois dépasser les bornes du respect, que je considère toujours comme une condition nécessaire du débat.
Après avoir vu, de façon sans doute un peu courte, les questions qui pouvaient à mon avis être soulevées du point de vue de la morale quant à l’existence ou l’inexistence du libre arbitre, j’en viens maintenant à la question du mérite. J’espère que vous m’en excuserez, mais sur ce point, je ne compte pas vraiment vous ménager. Sans toutefois dépasser les bornes du respect, que je considère toujours comme une condition nécessaire du débat.
Mais je sais qu’à priori, mon lectorat est plutôt fait de personnes qui me ressemble un peu, ou du moins qui sont issues d’un milieu social assez proche, et que je qualifierais de petit bourgeois. Et que c’est ce milieu là, parce qu’il s’est forgé, par la force de plus grandes connaissances que beaucoup d’autres, des convictions également plus fortes, qui est le plus réticent à se remettre en cause sur ce type de sujet. Et parce que personnellement, j’ai toujours été ulcéré de voir autour de moi ceux-ci se féliciter de la qualité de leurs choix de vie, quand ils n’en étaient que des héritiers bienheureux, et à quel point ils pouvaient être aveugles quant-à l’influence qu’exerçait leur milieu de vie sur leur propre « réussite ».
La question du mérite dans le fond, se pose un peu comme celle de la morale. Si j’admets désormais que le libre arbitre est une notion largement faussée, et dans le fond une vraie supercherie, un simple outil de plus visant à valoriser nos actes (le rôle du libre arbitre était différent à sa création : il servait alors à maintenir l’idée d’un Dieu parfait, alors même qu’il avait créé des êtres imparfaits, ces imperfections n’étant donc que le reflet du libre arbitre dont il leur avait fait « cadeau ». Ainsi Dieu était dégagé de la responsabilité de nos méfaits, et sa superbe pouvait rester intacte), si j’admets donc que le libre arbitre n’existe pas, comment pourrais-je attribuer la moindre valeur, et donc le moindre mérite à nos actes ?
Comment peut-on estimer que telle ou telle action, telle ou telle position « philosophique », tel ou tel choix recouvre un quelconque mérite (morale, intellectuel, tout ce que vous voulez) si je suppose que nous n’agissons que sous la direction de nos déterminismes ? Quel méritent ces déterminismes pourraient-ils bien avoir ? Nos envies de maintenir notre équilibre intérieur, de nous sustenter, de copuler, de nous gratifier et, pour cela, de devenir des dominants, tout ceci qui constitue, la très grande majorité de nos comportements, n’est pas guidé par autre chose que par nos déterminismes. Tant par nos déterminismes biologiques (notre capital génétique pour faire court), que par nos déterminismes culturels, environnementaux, sociaux, familiaux (qui en fait, sont à mon avis les plus importants), ce que j’ai appelé il y a quelque temps, nos automatismes acquis, c’est-à-dire appris. Prétendre le contraire sur ce sujet n’est pas autre chose que faire l’aveu de son aveuglement sur soi.
Pour qu’il en soit autrement, il faudrait que nos comportements inconscients, qui interviennent dans tous les domaines de notre quotidien, soient moins nombreux, il faudrait que nos automatismes soient moins profondément ancrés, que nous soyons donc en quelque sorte moins éduqués, il faudrait que nous fassions travailler plus souvent notre lobe orbito-frontal, celui où nous pouvons former des associations entre les choses que nous avons apprises et en imaginer de nouvelles. Mais nous en sommes loin. En passant, j’insiste sur le vice caché que contient l’éducation, celle faite de « bons » repères, de culture bourgeoise, bref d’automatismes.
C’est bien parce que celle-ci est, plus que d’autres, faite de ces repères et automatismes qu’elle crée des individus moins aptes à s’extraire du cadre de pensée dans lequel ils ont grandi. Vous me rétorquerez sur ce point que ce sont pourtant, eux, les bourgeois, qui historiquement sont à l’origine des révolutions émancipatrices, et que ce sont eux qui se font les premiers chantres des valeurs de respect et de tolérance. Et que vous qui me lisez en êtes d’ailleurs un bon exemple.
Personnellement je suis loin d’en être aussi sûr. D’abord parce que ces grandes déclarations de valeurs, de respect, etc. ne sont trop souvent rien d’autre que des déclarations. J’entends fréquemment autour de moi ce type de personne se lancer dans des grandes tirades humanistes, rappelant, le front plissé et les sourcils sévères, le combat qui doit être le nôtre contre le racisme, et quel exemple constitue pour eux tel ou tel prix Nobel de la paix. Mais vient un jour un moment d’inattention, de relâche où le langage ne se fait pas aussi ciselé que dans ses dîners en bonne société. Et la bête sort, l’air de rien, à la fraîche. Les grandes phrases ne sont plus là pour la camoufler, et souvent, la personne ne s’aperçoit même pas de ce que révèlent ses propos.
Les pauvres gens sont peu susceptibles de ce type de comportement faussé. Pour une raison toute simple : la faible maîtrise du langage qu’ils ont ne leur permet pas de l’utiliser aussi bien que les bourgeois pour camoufler leurs actes. Ce point me paraît important, car il explique en partie l’usage plus important que les pauvres font de la violence. Les bourgeois en quelque sorte n’ont pas besoin de la violence. Le langage leur permet de s’assurer l’accès aux gratifications qu’ils recherchent, en maintenant les hiérarchies en place et en préservant leur statut de dominants. Pourquoi agresser qui que ce soit dans ces conditions ? En revanche, les pauvres ne disposent pas de cet outil, et pour y palier, ils ne trouvent que le langage de la violence. Je reviendrai probablement sur ce point une fois prochaine.
Mais surtout, ce qui fonde l’essentiel de mes doutes sur la profondeur de ces valeurs bourgeoises, et j'en ai d'ailleurs déjà fait part ici, c’est que nous oublions vraiment trop à quel point nous sommes le fruit de notre environnement familial et culturel. Et que nous avons bien trop tendance à ériger en vertus personnelles ce qui n’est que du mimétisme social. Je l’ai déjà dis il y a quelques temps, il faut nous imaginer ayant grandi dans des quartiers pauvres, dans des pays en guerre, et tenter, si tant est que nous en soyons capables, d’appréhender la capacité que nous aurions eu dans de telles conditions à faire germer ces vertus dont nous nous attribuons le mérite aujourd’hui. Je n’en donne pas cher.
Mais pourtant, on ne peut pas dire que cette humilité vis-à-vis du peu qui nous revient dans notre propre construction et dans notre grandeur d’âme, soit véritablement ce qui nous étouffe. Il n’est qu’à constater l’importance donnée au mythe de la réussite sociale dans les pays développés, au mantra inculqué à nos enfants dés le plus jeune âge visant à les faire grimper le long de l’échelle sociale, à utiliser pour cela à plein les automatismes culturels acquis et à brider l’usage de notre cerveau imaginatif, et à tous les mérites que nous rattachons à ces succès que nous avons, alors qu’on peut quasiment dire qu’ils sont uniquement programmés par notre milieu.
Je les ai vu pendant trois ans ces jeunes dans le vent qui s’auréolaient de leur succès aux concours des grandes écoles, qui se félicitaient d’en être arrivé là, à la force du poignet comme on dit. Aucun évidemment pour dire combien le portefeuille de papa était en cause dans cette réussite. Ni pour donner à sa condition sociale son vrai nom : la chance. Mais il est où le mérite dans la rencontre du spermatozoïde mâle d’un cadre et de l’ovule d’une femme de bonne famille ? Il est où le mérite dans la phase d’empreinte, pendant laquelle notre milieu favorisé engramme dans notre cerveau, sans que nous y soyons pour rien, les bases qui ont fait de nous des gens curieux, « intelligents » et bien « adaptés » ? Il est où le mérite dans l’acquisition dissimulée de tous nos automatismes culturels ?
Le mérite n’existe que dans nos cerveaux, par lesquels nous cherchons en permanence à nous attribuer une certaine valeur individuelle, différente de celle des autres, cette différence étant la condition nécessaire pour nous donner la possibilité de leur être supérieurs. Toute l’essence de la fumeuse (avec un u, pas un a) méritocratie qui sévit dans les entreprises qui se veulent les plus dynamiques est là.
08:40 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (15) | ![]() Facebook |
Facebook |
27/01/2007
Le lien social - encore
"Il est avant tout utile aux hommes de nouer des relations entre eux, de se forger ces liens qui les rendent plus aptes à constituer tous ensemble un seul tout, et de faire sans restriction ce qui contribue à affermir les amitiés."
Spinoza, l’Ethique, de la servitude humaine, chapitre 12
Le lien social je vous dis, le lien social.
18:05 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |



