24/01/2007
Morale et libre arbitre
La principale gêne qui atteint les tenants du libre arbitre, est à mon avis la question de la morale. En effet, on comprend rapidement que si l’existence du libre arbitre est remise en cause, cela pose un problème majeur concernant la moralité que nous pouvons rattacher à nos actes. Car comment juger que nous agissons de façon morale ou pas, si nos comportements, et nos « choix » ne sont en réalité que le reflet de nos déterminismes ? Sur quoi pouvons-nous nous reposer pour attribuer une valeur à nos actions si aucun libre arbitre ni aucune liberté n’intervient dans l’exécution de celles-ci ?
La fiche wikipedia que j’avais indiquée en lien lors de mon billet d’introduction de cette série mentionne deux approches importantes autour de cette question de la morale : celle de Saint Augustin, et celle de Saint Thomas d’Aquin.
Saint Augustin se place bien sûr dans une perspective résolument religieuse et croyante. La question du libre arbitre, sous ses mots, relève celle du destin imposé par le divin. S’il n’y a pas de libre arbitre, c’est que notre vie est toute entière déterminée par le dessein de Dieu. Mais Saint Augustin, donc, croit en l’existence du libre arbitre, comme explication de la possibilité de nos péchés (ce qui permet de ne pas en faire porter le poids sur Dieu), et lui rattache également une idée positive, celle que sans libre arbitre, sans liberté d’agir par nous-mêmes, nous n’aurions pas non plus accès à la dignité morale.
Saint Thomas d’Aquin, lui, prend le problème dans l’autre sens. Il serait impossible que nous soyons tenus pour moralement responsables de nos actes si nous n’étions pas doués de liberté d’agir. Or, cette responsabilité nous échoit bien. Comme cité sur wikipedia, Saint Thomas D’Aquin écrit :
"L’homme possède le libre arbitre ; ou alors les conseils, les exhortations, les préceptes, les interdictions, les récompenses et les châtiments seraient vains." (Somme théologique)
Un second argument est rapporté, qui part de la distinction de l’homme et de l’animal, le second n’agissant que selon la force de ses instincts, c’est-à-dire par ses déterminismes biologiques, lors que l’homme peut lui agir par l’usage de la raison, et donc opérer des choix, se déterminer lui-même, ce qui est le propre de la liberté.
Je crois qu’on rejoint ici un point qui tenait à cœur à Matthieu dans son héroïque défense du libre arbitre, seul contre trois. Si l’homme n’agit que par la somme de ces déterminismes, qu’est-ce qui le différencie d’un animal purement instinctif et mécanique ? Qu’est-ce qui le différencie d’un robot ? L’homme n’est pas un robot, la diversité de comportement dont il est capable semble en être une preuve éclatante (quoique les chercheurs en IA critiqueraient certainement la vanité de cette position). S’il n’est pas un robot, c’est bien qu’il doit, d’une façon ou d’une autre, pouvoir agir de façon libre, et donc faire appel au libre arbitre.
Sur ce point, je rejoins évidemment Matthieu. Mais probablement pas de la façon qu’il imagine. Pour moi, au stade de réflexion où j’en suis, et il reste des marches à gravir (sur de tels sujets le contraire serait inquiétant), la principale différence que je vois entre nous et un robot, c’est la notion de nécessité de persistance de la structure. Si on coupe le courant qui alimente un ordinateur, celui n’en est pas pour autant fichu et à mettre à la casse. Pour retrouver son contenu, il suffit de le remettre en route. Les êtres vivants ne fonctionnent pas de cette façon, et c’est ce qui les différenciera toujours des machines : ils ont besoin d’assurer la continuité de leurs fonctions, et si un jour le courant est coupé, il l’est à jamais. Dans cette mesure, la mémoire des ordinateurs ne pourra jamais non plus fonctionner comme la nôtre. Notre mémoire intègre la notion de continuité, ce dont les ordinateurs n’ont pas besoin. En gros, nous faisons des films, quand ils ne réalisent que des photos.
Mais pourtant, ce n’est pas parce que nous ne sommes pas des robots, en tout cas de cette sorte, que nous pouvons déduire l’existence de notre libre arbitre. Ces deux points n’ont pas de lien logique entre eux
Sur ces points, de notions morales, et de comportements instinctifs, j’ai dis en introduction à cette série, que je ne répondrai pas immédiatement dans ce billet. Les réponses viendront un peu plus tard, dans les prochains billets. Où l’on verra notamment le piège que recouvre le terme de morale, et pourquoi l’argument de l’instinct est insuffisant pour répondre à la question du libre arbitre.
Quel suspens hein.
10:50 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (10) | ![]() Facebook |
Facebook |
18/01/2007
Libre arbitre: une définition
Suite à la demande, fort justifiée de Matthieu, je livre enfin ma définition du libre arbitre.
C'est la faculté d'exercer une volonté libre, c'est-à-dire dégagée de tout déterminisme (sociaux, génétiques,etc.).
P.S: post le plus court de la vie de ce blog. Low bloging encore cette semaine, j'en suis navré. D'autant que si je bloguais ma vie professionnelle, on rigolerait bien ensemble.
09:20 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (10) | ![]() Facebook |
Facebook |
15/01/2007
Court retour sur le pardon
Je voudrais revenir sur la question du pardon que j’avais déjà abordée il y a fort longtemps, et sur laquelle la lecture de Spinoza, encore elle, enfin lui, m’a apporté un nouvel éclairage.
Spinoza, dans les parties 3 et 4, de l’Ethique, procède à une démonstration de la nature des sentiments et de la façon dont ils nous affectent. Il distingue trois sentiments principaux, dont les autres ne sont en réalité que des combinaisons plus ou moins complexes : la joie, la tristesse, et le désir. De ces trois sentiments, nous dit-il, découlent l’intégralité de nos comportements et de nos actions.
Ainsi, m’appropriant la méthode de Spinoza (sans évidemment prétendre avoir le moindre espoir d’atteindre son niveau de compréhension et de démonstration), je pourrais dire que la fierté est la joie associée à la perception d’une cause intérieure, la compassion la tristesse ressentie avec et pour autrui, avec l’idée d’une cause extérieure, etc.
Concernant le pardon, me mettant dans la peau de celui qui pardonne, et donc qui a souffert, je dirais que celui-ci est l’acte par lequel il efface une tristesse qui fut liée à l’action d’un autre, celui qu’il pardonne, et donc d’une cause extérieure.
Cette observation, que le pardon est l’effacement de la tristesse vécue, est à mon avis très importante. Car elle permet d’envisager avec précision ce qui permet au pardon d’être bien réel et de n’en point rester à de simples mots vides de sens. Tant que la personne qui pardonne ne parvient pas à dépasser la douleur que l’autre à pu lui causer, je ne donne pas cher de la solidité du lien qu’il propose à ce dernier de reconstituer.
J’y suis attentif, car je me suis récemment demandé si j’avais moi-même pardonné à une personne qui m’avait causé du tort il y a déjà quelques années. Pendant longtemps, je lui en ai voulu, mais sans vraiment lui faire part de mon ressentiment. Elle m’avait demandé son pardon, tout juste après avoir commis sa bévue, et je le lui avais accordé en retour, peu enclin à devoir gérer un conflit.
Mais j’ai compris rapidement que ce pardon que j’avais donné immédiatement avait bien peu de contenu. Et sentant, plusieurs années encore après les faits, une certaine tristesse en moi en songeant aux événements en cause, j’ai compris que d’une certaine façon, je ne lui avais toujours pas tout à fait pardonné ce qu’elle avait fait. Je crois que tant que j’en ressentirai de la tristesse, même si celle-ci est très atténuée désormais, cela signifiera que mon pardon n’est pas complet.
Et pourtant, je ne pense pas qu’il soit bon d’évoluer, après des événements désagréables causés par d’autres, en attendant que la tristesse que ceux-ci nous ont causée ait tout à fait disparue. Je crois bon de savoir forcer ses sentiments dans ce type de cas, et de parvenir, de façon raisonnée, à ne pas écouter cette tristesse afin de limiter ses conséquences sur nous-mêmes. Pardonner devient ainsi l’action raisonné de celui qui préfère faire prévaloir les liens qui l’unit à celui qui lui a causé du tort, plutôt que ce qui l’en sépare, et qui veut privilégier le bienfait que lui apporte le pardon donné, plutôt que la tristesse ruminée.
Mais, me situant désormais dans la peau de celui qui a quelque chose à se faire pardonner, je comprends qu’en ce qui le concerne, si sa démarche lorsqu’il demande pardon recouvre la moindre sincérité, il est nécessaire qu’il cherche à créer les conditions qui permettent à celui dont il doit se faire pardonner d’effacer sa tristesse. Son objectif ne doit pas être en quelque sort de se faire pardonner, mais de faire en sorte que celui à qui il a causé du tort n’en ressente plus de tristesse.
Las, trop souvent voit-on les gens qui demandent pardon, ne réclamer là qu’un laissez-passer pour la tranquillité de leur conscience, sans qu’ils attachent une véritable attention au sort de leur vis-à-vis. Dans leur pardon, c’est encore eux-mêmes qu’ils regardent, et le visage de l’autre leur reste inconnu. C’est désormais très évident pour moi lorsque je remarque que malgré leur demande d’être pardonnés, ils n’entreprennent souvent rien qui puisse aider à atténuer la tristesse de celui auquel ils ont causé du tort.
19:06 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
La raison d'être chez Spinoza
Trouvé à nouveau dans l’Ethique de Spinoza, un petit passage de la partie 4 qui m’a encore beaucoup intéressé, et qui se rapproche à nouveau d’une des idées clé de Laborit :
Scolie de la proposition XVIII
"La raison ne demande rien contre la nature ; elle demande donc que chacun s’aime soi-même, qu’il cherche l’utile qui est sien, c’est-à-dire ce qui lui est réellement utile, et qu’il désire tout ce qui conduit réellement l’homme à une plus grande perfection ; et, absolument parlant, que chacun s’efforce, selon sa puissance d’être, de conserver son être."
Evidemment, je rapproche cette idée de Spinoza, de l’idée centrale de la théorie de Laborit qu’il résume ainsi :
"L’être n’a pas d’autre raison d’être, que d’être."
Je n’ignore pas toutefois qu’il y a quelque facilité dans le rapprochement que je fais entre ces deux auteurs. D’autant que Spinoza semble ici partir d’une vision individualiste que Laborit aurait probablement réprouvée. Mais là aussi je vais en fait trop vite et il faut vraiment lire toute l’Ethique pour bien comprendre le positionnement de Spinoza sur ces questions.
16:30 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |
12/01/2007
Prédictibilité et libre arbitre
J’entame donc ma courte série sur le libre arbitre par un non moins court billet sur la question de la prédictibilité. Je ne serai en effet pas très long sur ce point, car il ne me semble dans le fond pas très compliqué à tirer au clair. Il me semble que l’idée ici est de dire que notre libre arbitre est la source de la grande complexité que nous constatons dans nos comportements. Et que cette complexité est ce qui nous rend fondamentalement imprévisibles. En raisonnant à rebours, on considère que puisque nous sommes imprévisibles, c’est qu’il y a quelque chose en nous qui nous rend trop complexe pour qu’on puisse toujours être sûrs de pouvoir appréhender correctement nos comportements. Et que ce quelque chose, ne peut être que le libre arbitre.
A l’inverse, si notre déterminisme est total, alors il semble raisonnable de dire que nos actes peuvent être prédits. Si en effet, nul hasard n’intervient ni dans nos gestes, ni dans nos mots, c’est donc qu’il existe en tout une chaîne causale, que l’on peut penser mécanique, qui fait que tel effet est produit, et pas tel autre. Or nous percevons bien, de façon intuitive, que la prédictibilité est une lubie. C’est même corroboré par le gouffre d’ignorance que nous apercevons sans cesse devant nous, malgré toutes les découvertes que nous avons déjà pu faire ou sommes sur le point de faire. Il est et il restera toujours parfaitement impossible de prévoir nos actes, car ceux-ci sont le résultat de processus bien trop complexes pour que nous puissions jamais les embrasser dans leur globalité.
Mais c’est mal raisonner que de penser que l’imprévisibilité que nous sommes forcés de constater induise quoi que ce soit sur l’existence du libre arbitre. Si nous ne savons pas prévoir nos comportements, cela n’a rien à voir avec le fait que ceux-ci puissent être guidés par le libre arbitre. Notre incapacité à prévoir ne montre rien d’autre que… notre incapacité à prévoir, soit du fait de notre ignorance des ressorts de nos actes, soit du fait de l’impossibilité qu’il y a pour nos cerveaux limités à envisager l’ensemble des stimuli, physiques, sociaux, environnementaux, etc. qui agissent sur nous et nous poussent à agir de telle ou telle façon.
L’absence de prédictibilité ne montre que notre incapacité à prédire. Cette incapacité à prédire ne dit rien sur notre prétendue liberté d’agir, et donc rien non plus sur notre libre arbitre.
11:00 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook |
Facebook |
10/01/2007
Critique du libre arbitre: plan
 Suite à l’intéressant débat qui avait eut lieu ici sur la question du libre arbitre, et pour répondre au récent billet de Matthieu sur le sujet, je propose ici ma petite contribution. Mon intention première était de produire d’un bloc mon argumentation, mais il n’en sera rien, car cela serait beaucoup trop long pour un simple billet. De plus, ce procédé présente plusieurs avantages. D’abord il me permet d’avancer pas à pas, et de ne pas vous noyer d’un coup sous un trop grand nombre de questions. Et puis surtout il me laisse le temps d’approfondir une question qui m’intéresse beaucoup à titre personnel.
Suite à l’intéressant débat qui avait eut lieu ici sur la question du libre arbitre, et pour répondre au récent billet de Matthieu sur le sujet, je propose ici ma petite contribution. Mon intention première était de produire d’un bloc mon argumentation, mais il n’en sera rien, car cela serait beaucoup trop long pour un simple billet. De plus, ce procédé présente plusieurs avantages. D’abord il me permet d’avancer pas à pas, et de ne pas vous noyer d’un coup sous un trop grand nombre de questions. Et puis surtout il me laisse le temps d’approfondir une question qui m’intéresse beaucoup à titre personnel.
Ce premier billet vous présente donc les jalons de mes prochains billets sur le libre arbitre. Vous y comprendrez déjà quels sont les arguments principaux que je compte développer ensuite. Et à quel point la critique du libre arbitre peut nous pousser loin dans la réflexion sur notre construction personnelle et sur celle des sociétés.
[Edit du 18/01/07: j'ajoute la définition que je fais du libre arbitre: à mon sens, c'est la faculté d'exercer une volonté libre, c'est-à-dire dégagée de tout déterminisme (sociaux, génétiques, tout ce que vous voulez)]
1. Le libre arbitre et la prédictibilité. L’argument de Mathieu est que si nous n’avions pas de libre arbitre, et que donc notre déterminisme était total, alors nos comportements, nos gestes, nos paroles, nos écrits, seraient tous parfaitement prédictibles. Or, ils ne le sont pas, c’est une évidence. S’ils ne le sont pas, c’est bien que notre déterminisme n’est pas total, et donc que le libre arbitre existe bel et bien. Mathieu se trompe ici de conclusion. L’absence, que je crois parfaitement réelle, de prédictibilité de nos comportements, n’est pas le signe de l’existence du libre arbitre. Elle n’est que l’aveu de notre ignorance. Rien de plus.
2. La question morale. Si le libre arbitre n’existe pas, cela pose un problème moral qui semble insurmontable. Car si un individu n’est pas maître en sa demeure et que son comportement n’est pas le résultat de l’exercice de sa volonté mais seulement de son déterminisme, comment le rendre responsable de quoi que ce soit ? Ici je ne répondrai pas réellement aux questions posées, mais je me contenterai de les poser, en proposant de relire les arguments de Saint Thomas d’Aquin. Qui nous permettront d’en arriver à la question de l’instinct, de l’usage de la raison, et de faire un sort à la vision de l’homme robot que craint Mathieu, tout en conservant pourtant notre idée d’absence de libre arbitre.
3. La question du mérite. De même que sur le point 2, si le libre arbitre n’existe pas, quid de notre mérite ? Nous sommes nombreux à connaître dans notre milieu professionnel le principe, parfois élevé au rang de vertu, de la méritocratie. Qui n’est en réalité trop souvent qu’une méthode pseudo savante justifiant les évaluations à la tête du client. Et pour cause. Sur ce point nous reviendrons à nouveau sur Laborit, et sur sa critique acerbe de la notion de mérite, que j’adresserai en particulier à ceux qui s’en croit le plus ornés : mon milieu social petit bourgeois.
4. La question du choix : nous distinguerons ici deux cas. Celui des alternatives à faibles enjeux, et celles dont les enjeux sont importants. La résolution des premières est un peu piégeuse, puisque les alternatives sans enjeux sont celles qui nous portent le plus naturellement à effectuer des choix que nous jugeons par la suite être le fruit du hasard ou de l’indifférence, et donc celle où nous pourrons, en rompant avec le syndrome de l’âne de Buridan, faire un choix qu’on trouvera d’autant plus lié au libre arbitre que ses ressorts ne nous apparaîtront pas clairement. Mais où est le libre arbitre dans le hasard, ou dans l’indifférence ? Et surtout, je fais une autre réponse sur ce point précis : quelle intérêt y a-t-il à se poser la question du libre arbitre sur des points que nous pourrions aussi bien décider en jouant à pile ou face ? La question est dans ce cas à mon avis à ce point sans objet qu’elle ne devrait pas être posée. Le deuxième type d’alternative est donc celui qui doit nous intéresser, plus que le premier. Mais ici sa résolution est en fait assez facile. On pourra revenir rapidement sur la démonstration de Schopenhauer dans son essai sur le libre arbitre pour montrer que nos choix sont la conséquence à la fois de nos prédispositions naturelles au sens large (disons de nos gênes pour faire très court et très schématique), de nos contingences, des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, et enfin de nos désirs, de nos pulsions envers nos gratifications, bref, de nos apprentissages.
5. La connaissance et l’ignorance. Où nous verrons que c’est l’ignorance qui constitue le fondement de ce que nous appelons aujourd’hui à tort le libre arbitre. Et encore notre ignorance qui est la source de ce que nous nommons liberté. Car si nous étions des êtres omnisavants, il n’y a pas de raison pour que nous ne fassions pas toujours le choix de ce qui est le mieux pour nous, et donc que nous fassions tous les mêmes choix. La diversité de nos comportements est donc avant tout l’aveu de notre ignorance et de notre imperfection (et je ne dis pas que c’est là quelque chose dont on doit être triste).
6. La question de la responsabilité. Où je répèterai, avec l’insistance d’un névrosé, quelle est l’importance de séparer ce que nous sommes, ce que nous faisons, et ce que nous avons. Ce qui nous permettra d’apporter une conclusion qui, alors qu’elle établie bien l’inexistence, et pour tout dire la vacuité de l’idée de libre arbitre, que nous n’en devons pas moins être tenus pour responsables de nos actes. Et où l’on verra qu’être déterminé ne signifie pas être passif. Que c’est un mauvais usage des mots qui nous fait conclure de façon erroné sur ce sujet, car notre déterminisme, est tout entier en nous, et qu’il est donc nous-mêmes. Que ce corps, ces sens, et ces influx nerveux qui nous dirigent, sont les briques qui nous constituent, et qu’en conséquence, si l’on veut bien abandonner l’idée de l’existence de l’âme, nous restons bien nous-mêmes acteurs de nos vies, même si trop souvent, nous les conduisons en aveugles.
Enfin, pour ceux qui voudraient lire, outre le billet de Matthieu, un texte intéressant sur le sujet, je conseille fortement la fiche wikipédia du même nom. Ils verront que je m’en inspire en partie.
09:10 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
28/12/2006
La nécessaire révolution des cerveaux
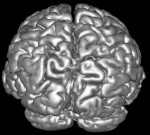 Il y a quelques semaines déjà, Olivier Besancenot avait été invité sur le plateau de la nouvelle émission de Ruquier le samedi soir, au titre un peu bizarre : tu ferais mieux de te pieuter au lieu de regarder ces conneries, d’ailleurs elles ne te permettront certainement pas d’écrire un billet intéressant. Oui mais parfois je me dis quoique. Et comme c’est semble-t-il l’usage dans cette émission, le ou les invité(s) politique(s) passe(nt) par la moulinette de deux grandes figures de la question qui dérange : Michel Polac et Eric Zemmour.
Il y a quelques semaines déjà, Olivier Besancenot avait été invité sur le plateau de la nouvelle émission de Ruquier le samedi soir, au titre un peu bizarre : tu ferais mieux de te pieuter au lieu de regarder ces conneries, d’ailleurs elles ne te permettront certainement pas d’écrire un billet intéressant. Oui mais parfois je me dis quoique. Et comme c’est semble-t-il l’usage dans cette émission, le ou les invité(s) politique(s) passe(nt) par la moulinette de deux grandes figures de la question qui dérange : Michel Polac et Eric Zemmour.
Le débat qui a eu lieu est somme toute convenu, on n’est dans une émission de divertissement après tout, mais une remarque de Zemmour m’a intéressé, lorsqu’il a interpellé Besancenot sur la faisabilité de la révolution qu’il prône. C’est tout le piège des partis d’extrême gauche : les valeurs qu’ils mettent en avant résonnent souvent positivement en nous, mais quand on en vient aux méthodes de mise en œuvre on se demande comment tout cela peut tenir debout.
Car les contradictions que renferment leurs programmes sont importantes: l’engagement pour les pays pauvres, mais le protectionnisme économique et le rejet de la mondialisation (pardon, je ne détaille pas), la défense de l’Homme avec un grand H, mais la stigmatisation de certains qui ne sont vus qu’à travers leur fonction (souvenons-nous à cet égard de ce que produit ce type de comportement de réduction des personnes aux définitions que nous en faisons) critique de tout ce qui ressemble au pouvoir, mais lutte intestine pour savoir qui d’entre eux va le détenir et représenter leur courant aux prochaines élections, etc.
Eric Zemmour conclut lors de l’émission (après un discours un peu différent de ce que je viens de dire) : la révolution n’est pas possible sans contradiction, sans reniement de ce qui la fonde. Il poursuit tranquillement en disant que nous sommes donc bien forcés de poursuivre le chemin actuel, en apportant des changements que par petites touches, mais en oubliant les idées de grand chambardement.
Je suis plutôt d’accord avec lui concernant la révolution que prônent les partis d’extrême gauche, qui me semblent beaucoup plus porteuses de destructions et de drames que d’avancées sociales. Mais pourtant je crois pour ma part qu’il existe une révolution qui non seulement est souhaitable, mais qui va devenir de plus en plus nécessaire avec le temps : la révolution de nos cerveaux.
En quoi consisterait-elle ? Globalement, en une compréhension plus grande des éléments qui fondent nos comportements. Pour parvenir à deux résultats : d’abord prendre connaissance des sources d’asservissement de nos comportements (j’évite volontairement l’expression prendre conscience, parce que ce n’est pas un sentiment ou une impression que nous devons acquérir, mais bien un savoir) : la volonté de domination et de pouvoir, nos besoins primaires satisfaits par l’usage de notre cerveau reptilien, la mémoire limbique qui pousse au réenforcement de nos actions gratifiantes. Ensuite, nous dégager de ce qui fait notre aveuglement face à nos choix : l’utilisation frauduleuse que nous faisons du langage pour barder la moindre de nos action de noblesse et de grandeur d’âme.
Il ne s’agit évidemment pas de supprimer le langage. Ce serait totalement stupide et absurde. Et ce n’est évidemment pas moi, qui aime bien m’adonner à un peu de poésie, qui souhaiterait ôter à tous la possibilité d’en user pour son propre plaisir. Mais je crois en revanche nécessaire que nous parvenions un jour (car non, je ne me fais pas de doute sur la longueur de temps que prendrait la révolution dont je parle ici) à réformer notre façon d’utiliser le langage, et surtout les raisons pour lesquelles nous l’utilisons. Qu’il devienne moins un outil de justification de nos actes et d’évitement de nos responsabilités. Mais pour cela, il est indispensable que nous ayons, avant, compris pourquoi nous l’utilisons comme nous le faisons aujourd’hui.
Deux événements récents viennent à l’appui de mon idée. D’abord, le récent sketch des mouvements antilibéraux pour désigner leur champion. On voit bien là que vers quelque bord que l’on se tourne, la volonté de pouvoir et l’intérêt personnel viennent en premier dans les intentions des individus. Elle reste souvent cachée derrière des discours qui dissimulent derrière de grandes intentions de progrès collectif, de non moins grandes envies de satisfactions individuelles.
J’ai souvent pensé, sans doute comme beaucoup d’autres, que la modestie des conditions sociales ne faisait pas la valeur des gens. Non plus que leur richesse, évidemment. Et que chez les deux, pourvu qu’on leur offre la possibilité, ou même seulement l’espoir d’acquérir du pouvoir, on pouvait assister aux mêmes actions de recherche de domination.
Je me souviens d’une anecdote lue il y a quelques années dans un petit livre de vulgarisation philosophique que j’avais trouvé très amusante : un chanteur célèbre avait lancé une opération humanitaire d’envergure pour protéger des populations sud-américaines de la déforestation et promouvoir leur cause auprès des grandes institutions internationales. L’opération avait eu je crois un certain retentissement et des fonds conséquents furent débloqués. Mais à peine ces fonds étaient-ils arrivés aux représentants locaux de la cause défendues que ces derniers, aussi pauvres à la base que les autres, ont disparus avec l’argent récolté.
En bref, que l’on donne à une personne défavorisée les moyens d’exercer le pouvoir comme le font ceux qu’ils envient et ils répéteront exactement les comportements qu’ils fustigent. Certains mollahs illettrés que l’on voit émerger ici et là en sont le plus bel exemple.
Deuxième événement, qui en fait n’en est pas un, si ce n’est à l’échelle réduite de notre petite blogosphère : les quelques débats qu’on a vu émerger récemment au sujet de l’Europe, dans une version remixée des échauffourées entre ouiistes et nonistes qui avaient eu court en 2005. Où l’on a constaté qu’un an et demi plus tard, la hache de guerre n’était toujours pas enterrée, et que les plus vifs partisans de chaque camps était toujours aussi prêts à en découdre avec ceux de l’autre bord.
Et les « débats » ou supposés tels, ne se sont, à nouveau, résumés qu’à des tentatives de clouage de bec en règle, sans la moindre volonté réelle de convaincre, et encore mois de discuter, mais seulement pour distribuer du haut de chaque piédestal les bons et les mauvais points, en raillant les uns et ralliant les autres. J’avais déjà parlé de ce type de comportement qui consiste à asséner ses idées par coups de marteau, et de l’intention tout sauf débatatoire qu’il démontre. Je n’y reviens pas.
Ce qui m’énerve en fait dans ce cas là, c’est que bien que l’on soit en train de s’écharper, nous restons tous, dans nos tranchées intellectuelles respectives (tranchées… intellectuelles… bref), persuadés de défendre de grandes valeurs, et surtout, surtout, convaincus d’agir en héritage de la tradition démocratique de l’échange argumenté du pays, et de le perpétuer par nos démonstrations.
Alors qu’il m’apparaît tout à fait évident qu’il ne faudrait pas grand-chose pour que ces prétendus débats se transforment en bataille qui traduise dans les gestes la violence des mots. Qu’on nous mette, nous les grands débateurs politiques devant l’éternel, dans le contexte d’un pays moins civilisé, moins développé, dont les lois restent balbutiantes, qu’on nous fasse naître dans un environnement pauvre et peu éduqué, et on verrait ce qu’il resterait de notre capacité à retenir nos coups. Que nul n’en doute : au vu de la méchanceté affichée de chaque côté, et parfois par ceux que l’on croit être les meilleurs, il n’en resterait rien. Prétendre le contraire n’est qu’un pur aveuglement.
C’est pour cette raison qu’appeler à réfléchir d’abord à son propre comportement face à la contradiction, face au pouvoir des autres, face aux contraintes qui empêchent la réalisation de nos désirs, etc. comme je l’ai fait récemment, n’est à mon avis pas si simplet que ça. C’est pour cette raison qu’à l’approche de la nouvelle année, qui sera peuplée d’opportunités de se mettre sur la gueule, comme on dit vulgairement, je nous souhaite de parvenir à trouver les bases sur lesquelles de vrais dialogues peuvent avoir lieu. Et qu’ils ne restent pas que des tournois de lancement de piques et de mise au pilori. Même si je me doute bien que ces changements que j’appelle de mes vœux, ne peuvent être que longs à venir, ne serait-ce que parce que je constate sans cesse mes propres limites à les mettre en oeuvre.
00:25 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |
Facebook |
27/12/2006
Spinoza et la gratification
 Je poursuis lentement ma lecture de l’Ethique, et je m’amuse pas mal à voir les quelques similitudes qui existent chez Spinoza avec ce que j’ai déjà pu lire chez Laborit. Aujourd’hui, je vous livre deux très courts extraits, qui rappellent fortement la théorie de la gratification et du réenforcement. Pour retomber sur une certaine logique, je me permets d’inverser l’ordre d’apparition des deux propositions dont il s’agit :
Je poursuis lentement ma lecture de l’Ethique, et je m’amuse pas mal à voir les quelques similitudes qui existent chez Spinoza avec ce que j’ai déjà pu lire chez Laborit. Aujourd’hui, je vous livre deux très courts extraits, qui rappellent fortement la théorie de la gratification et du réenforcement. Pour retomber sur une certaine logique, je me permets d’inverser l’ordre d’apparition des deux propositions dont il s’agit :
Troisième partie Proposition 36
"Celui qui se souvient d’une chose qui lui a une fois donné du plaisir, désire la posséder dans les mêmes circonstances que la première fois."
Si on venait de lire Laborit, on pourrait croire que celui-ci a copié Spinoza dans le texte. Car on est très près ici de la description du comportement qui suit l’expérience gratifiante. Après avoir vécu une expérience agréable, et avoir enregistré, via la mémoire à long terme du système limbique, les différents éléments qui la composent, on va chercher à reproduire cette expérience afin de retrouver le même plaisir : c’est le réenforcement (mot vraiment très vilain).
Une petite note pour rester toutefois prudent sur les similitudes Laborit-Spinoza. Le véritable argument de Spinoza est que l’on cherche à reproduire TOUS les éléments de l’expérience agréable, et que l’absence d’un seul de ces éléments est de nature à nous faire douter du plaisir que nous apportera la répétition de l’expérience en question, et donc à nous rendre triste. C’est ainsi que nous éprouvons le regret, sentiment de tristesse vis-à-vis d’une chose que nous aimons, mais qui, du moins l’éprouvons nous parfois, nous manque. Spinoza n’ébauche pas une théorie du réenforcement.
Troisième partie Proposition 32
"Si nous imaginons que quelqu’un tire de la joie d’une chose qu’un seul peut posséder, nous ferons tout pour qu’il ne la possède pas."
Ce point est exactement celui que j’ai déjà développé dans mon ancien billet sur la concurrence et la gratification (lien billet). Lorsque nous avons découvert une ou des gratifications qui nous donnent du plaisir, nous cherchons, comme nous l’avons rappelé plus haut, à reproduire les expériences qui nous ont donné ce plaisir. Dans la plupart des cas, ces gratifications vont faire l’objet d’une volonté de possession. Puisque si nous possédons la chose, nous nous assurons plus fortement de pouvoir recevoir la jouissance que celle-ci procure.
Mais la possession, quasiment par définition, ne se partage pas. Sinon elle n’est plus possession. Ainsi, de l’apprentissage que nous faisons de la propriété (car il ne s’agit nullement d’un instinct, la propriété est exclusivement une élément appris, acquis aux cours des années, transmis par nos ancêtres, mais elle n’a rien à voir avec quoi que ce soit d’inné : en d’autres termes, elle n’a rien à voir avec notre nature, mais seulement avec notre culture), de cet apprentissage donc, naît la cause du conflit, puisque deux individus partageant la même envie à l’endroit d’un objet, vont chacun chercher à se l’approprier, au détriment de l’autre.
Et maintenant, je me demande si Spinoza décrit un peu notre appétit du pouvoir…
P.S : ah oui, pour l’illustration, ne cherchez pas à comprendre, je voulais juste poursuivre dans la voie engagée dans mon précédent post.
18:25 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
19/12/2006
Il y a trois siècles, certains l'avaient déjà compris !
"Il y a autre chose, en effet, que je voudrais particulièrement faire remarquer ici : nous ne pouvons rien faire en vertu d’un décret de l’esprit, à moins que nous n’en ayons le souvenir ; par exemple, nous ne pouvons prononcer un mot à moins que nous n’en ayons le souvenir. Mais il n’est au libre pouvoir de l’esprit de se souvenir de cette chose ou de l’oublier. Aussi croit-on que ce qui est seulement au pouvoir de l’esprit, c’est de pouvoir, en vertu du seul décret de l’esprit, taire ou dire la chose dont nous nous souvenons. Pourtant, quand nous rêvons que nous parlons, nous croyons parler en vertu d’un libre décret de l’esprit, et cependant nous ne parlons pas, ou si nous parlons, c’est un mouvement spontané du corps. Nous rêvons aussi que nous cachons aux hommes certaines choses et cela par le même décret de l’esprit qui, pendant la veille, nous fait taire ce que nous savons. Nous rêvons enfin que nous faisons en vertu d’un décret de l’esprit certaines choses que, pendant la veille, nous n’osons faire. Par conséquent je voudrais bien savoir si, dans l’esprit, il peut y avoir deux genres de décrets : décisions imaginaires et décisions libres ? Si l’on ne veut pas tant déraisonner, il faut nécessairement accorder que ce décret de l’esprit que l’on croit libre, ne se distingue pas de l’imagination même ou de la mémoire, et n’est autre chose que l’affirmation qu’enveloppe nécessairement une idée, en tant qu’idée. Et par conséquent, ces décrets de l’esprit naissent dans l’esprit par la même nécessité que les idées de choses existant en acte. Ceux donc qui croient parler, se taire ou faire quoi que ce soit en vertu d’un libre décret de l’esprit, rêvent les yeux ouverts."
Extrait de l'Ethique de Spinoza
Je ne sais pas si Laborit était un grand lecteur de Spinoza, mais je suis sûr que tous les deux auraient pu bien s’entendre sur certains sujets !
15:58 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (33) | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2006
Le surfer d'argent III: Galactus ressuscité !
 Il ya une idée que je n’ai probablement pas bien traduite, ni dans mon premier billet sur le surfer d’argent, ni dans le second, mais là c’est plus normal, car ça n’était pas vraiment le sujet. C’est que le syndrome du surfer d’argent crée les dictateurs (à force de répéter cette expression du syndrome du surfer d’argent, les gens vont bien finir par l’adopter, et je deviendrai alors universellement connu pour en être le créateur, youpi).
Il ya une idée que je n’ai probablement pas bien traduite, ni dans mon premier billet sur le surfer d’argent, ni dans le second, mais là c’est plus normal, car ça n’était pas vraiment le sujet. C’est que le syndrome du surfer d’argent crée les dictateurs (à force de répéter cette expression du syndrome du surfer d’argent, les gens vont bien finir par l’adopter, et je deviendrai alors universellement connu pour en être le créateur, youpi).
Dans le BD de Moebius (le traite, le fourbe, le sournoi, seuls les fans de BD comprendront), le surfer d’argent après avoir battu Galactus est acclamé par la foule qui réclame que le héros règne sur eux pour un monde meilleur. Le surfer d’argent se lamente alors de cette réaction du peuple, et résume sa déception en disant : « ils ne se rendent pas compte que ce qu’ils demandent, c’est un nouveau dictateur ».
C’est l’ironie ultime. Le peuple a été sauvé, par un autre que lui-même d’ailleurs, mais à peine est-il sorti du joug du tyran qui l’opprimait qu’il en redemande, et qu’il fonce tête baissée dans le même piège. Car la remarque du surfer d’argent est juste : élever des champions plus haut que terre, en les parant de mille vertus, est le processus par lequel on construit les tyrans. Parce qu’on crée ainsi les bases du culte de la personnalité.
C’est en fait le plus grand défaut que j’avais à l’esprit en rédigeant mon premier billet sur ce sujet et que je voulais dénoncer. Nous avons trop tendance, lors des différentes élections qui émaillent la vie politique française, et en particulier lors de l’élection présidentielle, à rechercher un champion que les militants décrivent comme une sorte d’être suprême apte à résoudre tous les problèmes existants, et même ceux qui n’existent pas encore.
Ce faisant, on fixe à l’échéance électorale un rôle qu’elle ne doit pas avoir. En effet elle n’est en aucune façon une fin en soi. Elle ne peut être qu’une étape, une petite étape même, car après avoir choisit qui va faire, il faut encore qu’il (ou elle) fasse. Le fait d’élever la personne choisie au rang de héros national, et de lui abdiquer, parce qu’on lui attribue toutes les qualités, nos propres responsabilités, est de nature à créer les conditions d’un gouvernement totalitaire.
Qu’on me comprenne bien. Je ne pense évidemment pas que la campagne électorale actuelle, qui joue à plein régime sur la personnalité des candidats, aboutisse à une dictature en France. Mais je m’inquiète tout de même du résultat final de tout ceci, et surtout de l’aveuglement total de la population quant aux chances d’obtenir dés le lendemain de l’élection la solution à tous leurs problèmes. Le seul fait que les camps se montrent déjà aussi braqués les uns contre les autres, et aussi partiaux, est pour moi le signe d’une erreur de perspective. Car au lendemain du 6 mai, tout sera à faire. Personne ne doit en douter.
J’ai entendu Attali faire une remarque très similaire l’autre soir sur le plateau du Grand Journal. Il disait qu’il était toujours assez inquiet lorsqu’on désignait une personne comme un sauveur. Parce que selon lui, c’était bien ainsi qu’on faisait les tyrans. Je le suis complètement dans cette idée, et je remarque que nous ne faisons vraiment rien d’autre à l’approche des présidentielles que de désigner, dans nos camps respectifs, des sauveurs, des personnes qui devraient par la seule force de leur charisme relever tout un pays du marasme dans lequel il s’enfonce nécessairement avant toute élection (sinon à quoi bon élire quelqu’un ?).
Quand j’observe l’étendue de ce comportement chez les politiciens eux-mêmes, mais également chez leurs observateurs, je ne peux m’empêcher de penser que décidemment, nous ne sommes toujours pas dans des démocraties adultes.
16:50 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |



