13/12/2006
Critique de l'opportunité de juger
 Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais évidemment pas tenter une argumentation Kantienne sur un truc pareil. Je profite simplement de la lecture du dernier billet de Koz pour rebondir dessus, et en particulier sur le mantra que Koz dénonce à mon avis avec justesse : celui qui veut qu’on ne devrait pas juger les autres.
Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais évidemment pas tenter une argumentation Kantienne sur un truc pareil. Je profite simplement de la lecture du dernier billet de Koz pour rebondir dessus, et en particulier sur le mantra que Koz dénonce à mon avis avec justesse : celui qui veut qu’on ne devrait pas juger les autres.
Je me souviens d’une discussion ancienne que j’avais eue avec une amie et mon professeur d’histoire de terminale, suite au décès lors d’un accident de moto d’un copain éloigné de la fille susnommée. Ma sympathique camarade nous avait relaté la façon dont l’accident avait eu lieu, et nous avait rappelé, non sans quelques trémolos dans la voix, la passion qu’entretenait l’accidenté pour les sports mécaniques, et pour la moto en particulier.
Ecoutant cette description, je ne pus m’empêcher de remarquer que cette passion me semblait avoir quelque peu déraillé puisqu’elle avait aboutit à l’excès de vitesse qui était directement la cause du décès de son pote. Et que la satisfaction d’une passion ne saurait nullement l’emporter sur l’intérêt qu’il y a à se maintenir en vie. Bref, je faisais la moue, gêné d’un côté par la douleur visible qu’elle manifestait, mais aussi dérangé par le discours disculpant qu’elle utilisait pour pardonner ce qui à mon avis ne pouvait pas l’être aussi simplement.
Lors que je fis part de ma remarque, elle me rétorqua rapidement : « Mais ne juge pas, tu n’as pas à juger, c’est son choix, pas le tiens ! ». Et là je n’eus pas même le temps de débrayer, puisque ce fut mon professeur qui réagit immédiatement en entendant cela : « Mais comment ça on n’a pas à juger ? Pourquoi on ne devrait pas juger les actes des autres ? Depuis quand ? Bien sûr qu’on juge ! Evidemment qu’on juge, qu’on utilise notre esprit critique pour comprendre un événement, et qu’on ne le laisse pas passer comme une soupe insipide qu’il faudrait avaler sans rien dire ! C’est une responsabilité de juger ! »
Bon, ça s’est passé il y a tellement longtemps, que là j’en rajoute un peu. Mais le fond de sa réaction est vraiment celui-ci. Et je dois dire que j’avais été immédiatement acquis à son argumentation. On entend souvent les gens invoquer ce soi-disant devoir d’absence de jugement pour se prémunir d’avoir à rendre compte, soit de leurs actes, soit de ceux des gens qu’ils approuvent. En général je ne suis déjà pas un grand adepte de toutes ces phrases toutes faites qu’on utilise pour parer ses postures de grandeur creuse, mais je dois dire que celle-ci fait partie des pires.
Car je ne vois effectivement aucune tolérance, ni aucun respect se manifester dans la suspension de la faculté de juger. J’ai beau tourner ça dans tous les sens, je ne vois pas comment on peut parvenir à penser que ne pas juger quelqu’un est par principe une bonne chose. Et surtout, je me demande bien par quel chemin de réflexion on peut passer pour imaginer une seconde qu’on puisse réellement cesser de juger ce qui nous entoure.
Sinon, qui peut m’expliquer comment on procède pour établir ses choix ? Comment on sélectionne parmi les options qui se présentent sans arrêt à nous celle-ci plutôt que celle là ? On voit bien que supposer possible l’arrêt de tout jugement nous fait tomber dans des contradictions de raisonnement insolubles. En fait lorsque ces gens nous disent « ne juge pas ! », ils ne nous demandent pas vraiment de ne pas juger, ce qui est impossible, non, en réalité, ils exigent déjà que nous pardonnions l’acte fautif. Car eux de leur côté, ils ont déjà jugé, mais dans un sens inverse au nôtre.
Je ne prétends pas qu’ils ont forcément tort d’avoir si vivement pardonné. Je ne le pense d’ailleurs pas. Mais je remarque que cette injonction de ne pas juger ne sert qu’à couvrir une prise de position nette par une formulation qui tente de témoigner d’un comportement neutre, comme si cette neutralité était garante de la justesse de notre point de vue. Attribuant implicitement une valeur morale à ce positionnement neutre, elle dénie cette même valeur aux autres positionnements, et cherche donc à forcer le ralliement des autres pour assurer sa propre tranquillité.
Ce piège du langage qui cherche à empêcher toute attitude critique est à dénoncer. Non seulement, il faut juger, ou peut-être comprendra-t-on mieux ceci en disant qu’il faut évaluer, car si nous stoppions l’exercice de cette faculté, nous ne pourrions tout simplement pas survivre (on fait comment si on ne fait jamais de choix ?). Mais surtout, la question ne PEUT tout simplement pas se poser, puisque nous sommes faits de telle sorte que nous ne pouvons pas ne pas juger. Précisément parce que c’est ce qui nous permet de nous maintenir en vie.
La critique de l’opportunité de juger est donc fort courte. Il est inadéquat de parler d’opportunité de juger. Puisque juger est une nécessité, et qui s’impose à nous, non pas du fait d’une quelconque orientation morale ou éthique que nous serions parvenus à nous imposer à nous-mêmes, mais par la pression de nécessité.
Une dernière chose toutefois, pour apaiser les tempes gonflées de sang de ceux qui étaient adeptes de l’idée que j’ai voulue dénoncée ici. Vous n’avez pas tout à fait tort de condamner ceux qui jugent les personnes, au lieu de se cantonner à juger leurs actes. Mais vous vous souvenez peut-être ?
15:15 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (11) | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2006
Verni démocratique
 Lors de ses différentes interventions sur les plateaux de télévision, Nicolas Hulot a à plusieurs reprises évoqué une idée qui me semble très juste, mais que je n’ai encore entendu personne relever. Ni à la télé lors de ses interventions, ni dans la presse, ni sur les blogs. Il dit que si jamais nous n’entamons pas dés maintenant le processus de correction de notre mode de consommation des ressources naturelles, et donc l’objectif et le mode de fonctionnement que nous donnons à nos sociétés, alors notre « verni démocratique » ne résistera pas aux dérèglements qui s’annoncent.
Lors de ses différentes interventions sur les plateaux de télévision, Nicolas Hulot a à plusieurs reprises évoqué une idée qui me semble très juste, mais que je n’ai encore entendu personne relever. Ni à la télé lors de ses interventions, ni dans la presse, ni sur les blogs. Il dit que si jamais nous n’entamons pas dés maintenant le processus de correction de notre mode de consommation des ressources naturelles, et donc l’objectif et le mode de fonctionnement que nous donnons à nos sociétés, alors notre « verni démocratique » ne résistera pas aux dérèglements qui s’annoncent.
Lors de l’émission qu’il avait faite chez Christine Ockrent et dont j’ai déjà parlé (lien billet), il avait rapidement précisé le contenu de cette expression. Selon lui en effet, le développement démocratique que connaissent les pays les plus avancés reste embryonnaire. Et je le suis très volontiers sur ce terrain. Je crois en effet que nous ne sommes encore qu’à l’aube de la démocratie, que nous n’en avons encore esquissé qu’un premier jet, largement perfectible, et que le chemin est encore très long pour que nos régimes occidentaux soient des démocraties solides.
Les exemples en sont d’ailleurs déjà nombreux. Je ne voudrais en rappeler qu’un seul, qui est à mon avis le plus parlant, et qui avait étonné beaucoup de monde lorsqu’il était survenu : le vandalisme qui avait écumé la Nouvelle Orléans après le passage du cyclone Katrina. Les scènes que nous avions alors vues ressemblaient, disait-on, à ce à quoi l’on assistait dans les pays les plus arriérés de la planète, et semblaient soudain faire de l’Amérique un pays sauvage, gouverné par la seule loi de la jungle animale.
Le débat qui a suivi n’a pas aboutit à grand-chose d’autre qu’à la vente de quelques journaux de plus, mais ces événements montraient que même le pays qui se veut le plus à la pointe de la civilisation restait infiniment sensible aux dérèglements naturels, et que son propre verni démocratique, pour reprendre la très bonne formulation de Nicolas Hulot, n’était pas aussi épais que ce que l’on pensait.
 Dans le fond, tous ces siècles d’évolution techniques, scientifiques, philosophiques, etc. n’ont pas changé grand-chose. Nous restons, comme nos aïeux, les yeux rivés sur nos nombrils, et persuadés que nous sommes déjà arrivés au stade ultime, à l’aboutissement final de l’évolution naturelle. Laborit l’a très bien vu en titrant l’un de ses livres : « Copernic n’y a rien changé ». L’héliocentrisme a bien été remis en questions par Copernic, et l’approche scientifique de l’univers révolutionnée. Mais aucune révolution n’a jamais encore eu lieu dans nos cerveaux. Et à voir aujourd’hui l’étendue sidérante de l’aveuglement quant aux sources de nos propres comportements, il est permit de douter que celle-ci intervienne avant longtemps.
Dans le fond, tous ces siècles d’évolution techniques, scientifiques, philosophiques, etc. n’ont pas changé grand-chose. Nous restons, comme nos aïeux, les yeux rivés sur nos nombrils, et persuadés que nous sommes déjà arrivés au stade ultime, à l’aboutissement final de l’évolution naturelle. Laborit l’a très bien vu en titrant l’un de ses livres : « Copernic n’y a rien changé ». L’héliocentrisme a bien été remis en questions par Copernic, et l’approche scientifique de l’univers révolutionnée. Mais aucune révolution n’a jamais encore eu lieu dans nos cerveaux. Et à voir aujourd’hui l’étendue sidérante de l’aveuglement quant aux sources de nos propres comportements, il est permit de douter que celle-ci intervienne avant longtemps.
C’est pourtant d’autant plus étonnant que les régimes démocratiques sont tous très jeunes. Les plus anciens qui n’aient pas été cassés par des dictatures n’ont pas plus de quelques dizaines d’années d’existence. Une paille à l’échelle de l’humanité. Et on a vu au cours du siècle dernier combien ces régimes étaient fragiles. D’où nous vient donc cette certitude d’être arrivés ? Comment parvient-on en si peu de temps à se raconter autant d’histoires sur la force, la solidité et l’immuabilité de nos régimes ? Quelle formidable absence d’esprit nous faire croire que nous sommes définitivement vaccinés et que nos structures résisteraient à n’importe quel défi, qu’il soit politique ou environnemental ?
Je vois une réponse à cette question, qui me vient d’ailleurs comme une évidence. Le coupable, là encore, c’est le langage, ou plutôt, ce que nous en faisons. La force des mots est telle qu’il suffit de les prononcer pour que ce qu’ils désignent nous paraisse être réel. C’est tout le piège des termes abstraits. Nous avons chacun une représentation personnelle de ce qu’ils décrivent, nous en donnerions tous une définition différente, mais jamais on ne se demande quelle est la réalité qu’il y a derrière les lettres qui les composent.
Et il suffit de faire tourner le mot démocratie dans des journaux, dans nos têtes, sur des textes de lois, et de les échanger fréquemment entre nous pour nous convaincre que nous sommes bien les modèles que le monde attendait. Ce que l’homme sait faire le mieux, c’est dresser des écrans de fumée devant ses yeux, pour se persuader qu’il est un type bien, civilisé, que ses actes répondent à des choix éthiques, moraux, que ce sont ses valeurs humaines qui le guident. Et pour établir ces écrans de fumée, il n’y a rien de plus pratique que le langage.
Tant que nous n’auront pas appris à utiliser le langage pour ce qu’il est, et seulement pour ce qu’il est, sans l’exploiter à des fins d’autojustification, je me demande quels espoirs peuvent être raisonnablement fondés sur la justesse de notre vision du monde, et sur notre capacité à bien répondre aux défis que celui-ci nous pose.
13:35 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2006
Le surfer d'argent II, le retour !
 Lorsqu’on regarde les émissions de divertissement à la télé, il y a une scène à laquelle on assiste souvent : un invité se lance dans une longue tirade humaniste sur les autres, la différence, le respect, la tolérance, bref tout le tremblement tire-larme autosuffisant habituel, et le public qui assiste à l’émission, vibrant de tant d’humanité affiché entre un spot pub et la promo du dernier bouquin d’actu creux à la mode, applaudit d’un seul homme, marquant ainsi son identification, et par la même occasion celle de l’émission, de son animateur et de toute l’équipe de prod, à ces grandes valeurs déclamées avec autant de vibrato.
Lorsqu’on regarde les émissions de divertissement à la télé, il y a une scène à laquelle on assiste souvent : un invité se lance dans une longue tirade humaniste sur les autres, la différence, le respect, la tolérance, bref tout le tremblement tire-larme autosuffisant habituel, et le public qui assiste à l’émission, vibrant de tant d’humanité affiché entre un spot pub et la promo du dernier bouquin d’actu creux à la mode, applaudit d’un seul homme, marquant ainsi son identification, et par la même occasion celle de l’émission, de son animateur et de toute l’équipe de prod, à ces grandes valeurs déclamées avec autant de vibrato.
En tant que spectateur c’est peu de dire qu’en général je supporte très mal ce type de manifestation du grand discount de la conscience collective. En fait, je suis tout à fait prêt à croire que les personnes qui entonnent ces chants d’absolution de l’âme humaine le font avec sincérité, et certaines témoignent d’ailleurs parfois d’un engagement très concret pour les causes qu’elles défendent. Mais ce qui rend invariablement exaspérant ces instants sentimentalo-cathodiques ce sont les applaudissements.
Ceux-ci sont en effet toujours, sans que cela souffre malheureusement la moindre exception, l’expression du syndrome du surfer d’argent : le rattachement de la foule à un héros dont la geste témoigne d’une grande âme, auquel il suffit de s’identifier en l’acclamant pour que l’on se croit revêtu des mêmes habits de noblesse humaine, et pour se permettre de se dédire de la même responsabilité que celle assumée par notre héros sans trop de frais. On s’est déclaré admiratif devant untel ou unetelle, on montre ainsi qu’on partage les mêmes valeurs, donc pas besoin d’aller plus loin, dans le fond les autres n’en font pas plus, notre déclaration d’intention leur suffira amplement.
Dans mes moments de mégalomanie aggravée, je m’imagine parfois dans la peau du surfer d’argent. Sur un plateau de télévision, à la République des blogs, à n’importe quel endroit où il me serait donné d’être moi-même le héros de cette foule avide de grandeur, mais s’il vous plaît, sans les responsabilités qui vont avec. Et je crois que je ne supporterai pas mieux leurs applaudissements que je ne les supporte lorsque je reste spectateur.
Tout ce que j’aurais envie de dire à ces nouveaux supporters c’est de ne surtout pas applaudir. De ne surtout pas manifester leur appui. De ne pas verser de larme d’assentiment, dont certaines ne seraient que des larmes d’a-sentiment. De cesser ces comportements d’auto-lustrage du poil par procuration. S’ils sont si convaincus de la valeur du discours que leur surfer d’argent tient, ce que l’on doit attendre d’eux ce ne sont pas des applaudissements ni des hochements de tête, c’est un alignement comportemental dans le sens des valeurs qu’ils disent être les leurs.
Applaudir c’est déjà commencer à se dédire de cette responsabilité de changer soi-même. C’est déjà chercher un ersatz qui permet de rester dans le confort de l’immobilisme.
11:50 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2006
Vers une société de dématérialisation
 Nicolas Hulot était hier soir l’invité de l’émission France Europe Express dans laquelle il présentait notamment le pacte écologique qu’il a mis au point avec bon nombres de scientifiques réputés au bout d’un travail de plusieurs mois. Le débat fut plutôt intéressant, sans doute grâce à un sujet de départ qui est finalement assez peu polémique et qui oblige plutôt à une vraie réflexion plutôt qu’aux réactions politiciennes pavloviennes habituelles.
Nicolas Hulot était hier soir l’invité de l’émission France Europe Express dans laquelle il présentait notamment le pacte écologique qu’il a mis au point avec bon nombres de scientifiques réputés au bout d’un travail de plusieurs mois. Le débat fut plutôt intéressant, sans doute grâce à un sujet de départ qui est finalement assez peu polémique et qui oblige plutôt à une vraie réflexion plutôt qu’aux réactions politiciennes pavloviennes habituelles.
Mais ce n’est pas vraiment du sujet de l’émission dont je voudrais parler, mais plutôt d’une idée qui m’est venue lors d’une remarque d’un des intervenants. En effet, vers le milieu de l’émission, Jacques Attali a fait une remarque à Nicolas Hulot, et lui a dit en gros : « le plus grand défi pour l’avenir, c’est de parvenir à gérer notre passage à une société de l’information ».
Immédiatement cette formule de « société de l’information » a fait tilt dans ma tête. D’abord parce que je me méfie toujours des formules de ce style que tout le monde feint de comprendre mais que chacun définirait d’une façon différente des autres. Mais aussi, et surtout, parce que je vois une imperfection dans cette formule qui la rend finalement parfaitement inefficace pour rendre compte des défis que justement nous avons à relever.
 Car il est faux de dire que nous entrons dans une société de l’information. Cette formule laisse à croire qu’il s’agit là d’un avenir, alors qu’il n’en est rien. La société de l’information, nous y sommes déjà, et depuis de nombreuses années. Depuis même beaucoup plus longtemps que vous ne l’imaginez en lisant ces mots. Cette société de l’information ne date pas des dernières décennies qui se sont accompagnées de tant d’évolutions technologiques. En réalité, la première société que l’homme a créée, il y a des milliers d’années de cela, était déjà une société de l’information.
Car il est faux de dire que nous entrons dans une société de l’information. Cette formule laisse à croire qu’il s’agit là d’un avenir, alors qu’il n’en est rien. La société de l’information, nous y sommes déjà, et depuis de nombreuses années. Depuis même beaucoup plus longtemps que vous ne l’imaginez en lisant ces mots. Cette société de l’information ne date pas des dernières décennies qui se sont accompagnées de tant d’évolutions technologiques. En réalité, la première société que l’homme a créée, il y a des milliers d’années de cela, était déjà une société de l’information.
Aujourd’hui nous avons le réflexe d’associer ce terme d’information à une activité de type tertiaire, abstraite. N’ayant entendu parler d’économie tertiaire étendue que tardivement dans le XXème siècle, nous datons donc l’émergence de la « société de l’information » dans les quelques décennies qui viennent de s’écouler. Certains même estiment qu’elle n’est encore qu’à venir (ça semble être le cas de Jacques Attali).
Mais depuis qu’il vit, l’homme ne fait pourtant rien d’autre que de traiter de l’information. L’information de son environnement, qui lui indique ce qu’il va pouvoir manger et boire, l’information venant des autres êtres vivants qui peuplent le même territoire que lui, et qui lui indiquent notamment quelles sont les limites de sa propre action, l’information lui venant de lui-même, enfin, de son corps, qui lui dis quand il est malade, affamé, assoiffé, triste, heureux, etc. Ce que nous faisons chaque jour, ce n’est rien d’autre que traiter toutes ces informations, les mélanger ensemble et réagir aux messages qu’elles nous envoient.
Tout ce qui existe dans notre société n’est que le résultat d’un traitement de l’information. C’était le cas notamment dans les décennies qu’on a baptisées « ère industrielle ». Car lorsqu’un industrie, quel que soit son activité, produit un objet, une barre de fer, une voiture, une coque de navire, tout ce que vous voulez, elle ne fait rien d’autre que transformer une multitude d’informations (de savoirs), et la condenser dans un résultat palpable. Mais que ce résultat soit palpable ne signifie en rien qu’il n’est pas lui-même un condensé d’information.
A ce stade on estimera peut-être que la remarque que je fais dans ce billet est un peu oiseuse. Après tout, il ne suffit donc que de définir ce qu’est l’information dans l’expression « société de l’information », en disant qu’il s’agit des informations non matérielles, des pensées, des opinions, etc. et hop, le tour sera joué. Je crois qu’il n’en est rien pourtant, et je persiste dans mon idée.
Dans le fond, il me paraît beaucoup plus juste de définir une société par le support qu’elle utilise pour traiter l’information. Puisque toutes les sociétés sont des sociétés de l’information, presque par définition, puisqu’elles sont composées d’hommes, et que les activités de hommes ne consistent qu’à traiter de l’information, il me semble plus pertinent pour les décrire, d’identifier quel est le support par lequel elles traitent prioritairement cette information. Au XIXème siècle, il s’agissait principalement de l’industrie. On a donc, à juste titre, qualifié cette période d’industrielle.
Alors aujourd’hui comment peut-on appeler notre société ? Quel support utilise-t-elle en priorité pour traiter ses informations. Et bien je propose une formulation, qui il me semble apporte de vraies lumières pour comprendre notre monde moderne. Notre société utilise de plus en plus des supports immatériels pour traiter son information. Nous sommes dans une société de dématérialisation de l’information. C’est cela la vraie révolution que nous vivons ces dernières années, révolution qui s’accélère, on le comprend sans difficulté, avec le développement d’Internet et de toutes les technologies de télécommunication.
Ce terme permet à mon avis de mieux comprendre certains défis qui se posent à nous aujourd’hui. Car je crois que cette tendance à la dématérialisation pose à chacun de nous, de façon individuelle, un problème, hum, vais-je oser le terme, hum, un problème ontologique. Car elle va en quelque sorte à l’encontre des stratégies que notre nature biologique à mises au point pendant tant d’années pour maîtriser son environnement.
En effet, la première chose par laquelle nous apprenons à connaître le monde, à l’appréhender et à l’intérioriser, ce sont nos sens. Notre vue, notre ouïe, notre toucher, notre odorat, et notre goût. Nous connaissons le monde avant tout en le palpant, en le sentant, en l’observant de toutes les façons qu’il nous est donné de pouvoir le faire. C’est cette découverte sensorielle qui permet au nouveau-né de progressivement sortir de son « moi tout », en comprenant qu’il ne fait que partie d’un ensemble, d’un univers avec lequel il va devoir création des interactions afin de trouver les bonnes réponses à ses propres besoins.
C’est par cette démarche, avant tout autre, que nous nous définissons nous-mêmes, et que nous nous connaissons nous-mêmes. D’ailleurs, il n’y a pas que les bébés qui passent leur temps à s’observer, à se tâter, à se regarder, etc. Les adultes le font également, et au-delà du narcissisme qu’on peut y voir, cela montre aussi que nous avons besoin de ce lien des sens avec notre corps.
Les technologies qui se développent de nos jours modifient de plus en plus la façon dont nous pouvons traiter les informations qui nous entourent. Et pour ma part, je me demande si cette remise en cause de l’appréhension de notre environnement et de notre corps par les sens au profit d’une démarche plus immatérielle, n’est pas justement la cause de ce qu’on appelle de plus en plus dans nos sociétés modernes, la crise DU sens.
Pourquoi sinon proposerait-on si vivement le retour à la nature, qui n’est rien d’autre qu’un retour à une information primaire, basique ? Pourquoi observe-t-on tant de personnes qui se sentent perdues dans leurs vies, perdues dans leurs activités professionnelles, perdues dans leurs relations avec les autres ? Il me semble très possible, étant donné la place qu’occupe le traitement de l’information dans l’activité des hommes au quotidien, que la dématérialisation, qui en quelque sorte le déracine de lui-même, soit en grande partie la cause de cette crise du sens, de cette crise d’identité, de cette crise ontologique (choisissez l’expression qui vous convient le mieux, pour moi elles sont à peu près équivalentes).
Peut-être est-on en train de vivre une nouvelle mutation, d’une forme un peu inédite. Pas une mutation biologique à proprement parler, mais une mutation sociale, une mutation des esprits, qui vont devoir s’acclimater à des supports de traitement de l’information qui relèguent l’utilisation des sens à une place moins dominante.
15:20 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2006
Le gêne égoïste, c'est chez Matthieu
Xavier a entamé une critique intéressante et construite du petit lexique que j'ai réalisé afin de simplifier l'approche des travaux de Laborit, en s'appuyant notamment sur les réflexions de Richard Dawkins et en particulier sur un de ses livres les plus connus: Le gêne égoïste.
Coïncidence, depuis quelques jours déjà, Matthieu propose des notes de lecture détaillées de ce livre, là, là, et aussi là. Je recommance ces lectures à ceux qui sont intéressés par ce petit débat de biologie comportementale. J'essaierai moi-même de revenir dessus, après avoir pris le temps de lire les trois articles de Matthieu (pour l'instant je n'ai lu que le premier).
11:40 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
06/09/2006
Lévinas nous foutra-t-il un jour la paix?
Lundi soir Arte diffusait en deuxième partie de soirée un entretien fait il y a plusieurs années avec Emmanuel Lévinas, dans lequel l’occasion lui avait été donnée de revenir sur ses travaux et réflexions. Je n’ai regardé cet entretien que d’un œil, tout occupé que j’étais à rédiger mon article sur le naturel et la mémoire, mais tout de même j’en ai retenu quelques passages, d’autant plus intéressants qu’ils me semblaient compléter, avec le regard du philosophe, certaines des choses que je découvrais dans les travaux de Laborit.
Un passage notamment m’a frappé lorsque Lévinas a abordé la question de la connaissance, notamment de la connaissance interpersonnelle, c’est-à-dire la connaissance que les gens construisent les uns des autres.
Avant de revenir spécifiquement sur les propos de Lévinas, je voudrais faire un petit détour sur la question du langage et de la connaissance, en repassant par la case Laborit (et donc j'inclus également ce billet dans ma série sur ses travaux). Dans ses travaux, Laborit a beaucoup insisté sur l’ambiguïté du rôle du langage dans notre développement personnel. Car celui-ci, s’il est d’abord un miracle, qui nous permet de développer des pensées élaborées, et des liens avec les autres fabuleusement plus riches que ce qui existe dans le règne animal, peut aussi se transformer en piège lorsqu’on ne sait pas correctement identifier ses limites.
En effet, le langage pose un problème du fait du niveau d’abstraction qu’il crée dans notre rapport avec les choses. Car trop souvent, nous avons tendance à donner aux signes qu’utilise le langage pour désigner les choses, la même valeur de réalité qu’aux choses elle-même.
Je m’explique.
Lorsque je regarde le stylo qui est posé seul devant moi sur mon bureau et que je dis : « stylo », mon collègue qui a suivi la scène s’inquiète certes pour ma santé mentale, mais il comprend bien de quoi je parle, il n’y a pas de confusion dans son esprit sur ce qu’est un stylo, et nous en partageons tous les deux une image qui recouvre la même réalité. Mais lorsque mes mots vont désigner des « objets » plus complexes, et notamment lorsque j’évoquerai des concepts stratégiques abstraits en réunion, alors il y a fort à parier que nous ne comprenions pas lui et moi exactement les mêmes choses, voire qu’il me traite intérieurement de consultant.
C’est ce que j’avais déjà subodoré l’an dernier, lorsque j’avais entamé ma série sur la communication, en reprenant une idée que Kundera présentait dans L’Insoutenable légèreté de l’être. Deux personnes ne construisent jamais une représentation identique des choses. Les mots qu’ils utilisent pour désigner celles-ci portent une histoire, des expériences, un vécu différents, tant et si bien que la réalité qu’ils projettent sur ces mots ne peuvent pas être les mêmes et que la compréhension qu’ils auront l’un de ce que dit l’autre se confrontera toujours à une barrière invisible, qui empêchera que leur osmose soit parfaite.
Toute la difficulté est là. Le langage nous fait créer des interprétations des éléments et des évènements qui nous entourent. Mais il ne peut pas prétendre recouvrir en toute circonstance la réalité objective de ceux-ci. Notre cerveau fonctionnant de façon associative, il associe à un objet tous les éléments circonstanciels qui entourent la rencontre de cet objet. La lumière, la chaleur, la quantité, les personnes présentes, notre état de santé, etc. Et il construit ainsi une image complexe de cet objet et le rend éminemment subjectif, c’est-à-dire lié à un état émotionnel qui est spécifique à nous et à nous seul.
C’est ce qui fait que l’expérience que nous avons des choses et des gens qui nous entourent peut être similaire à celle qu’ont d’autres personnes, mais que jamais elle ne leur sera véritablement identique. Or le problème, c’est que nous avons pourtant une tendance naturelle à attribuer une réalité objective aux représentations que nous formons ainsi, alors qu’elles ne font que révéler l’expérience personnelle que nous en avons. Nous prenons la carte (la représentation que nous avons de l’objet) pour le territoire (l’objet lui-même). Et malheureusement ceci se manifeste quotidiennement dans nos comportements, sans que nous en soyons jamais vraiment conscients.
Les conséquences de ceci sont importantes. On comprend notamment qu’à la lumière de cette analyse, on doit envisager la notion de connaissance d’une façon nouvelle. Car comment se manifeste une connaissance, si ce n’est à travers le langage ? Lorsqu’un professeur donne son cours à ses élèves, quel est le medium privilégié pour leur transmettre le savoir et la connaissance ? Evidemment le langage. Mais étant donné l’imperfection que nous venons de lui découvrir, comment pouvons-nous prétendre que ce que le professeur leur transmettra sera bien LE savoir et LA connaissance ? Et que savons-nous de ce qui va rester du message initial dans les esprits de nos enfants après la transformation que leur cerveau en aura faite ? Et d’ailleurs, ce professeur est-ce bien LE savoir et LA connaissance qu’il transmet ? On est bien tenté de répondre non et qu’il ne va pouvoir enseigner que les représentations que lui-même se sera fait des éléments de sa discipline (en fait, les sciences dures, et surtout les maths, sont les seules qui permettent d’éviter cet écueil).
Mais alors la question se pose : qu’est-ce que la connaissance ? Que peut-on prétendre réellement connaître ? Difficile de répondre sur ce point, et je ne vais pas m’y aventurer. Je veux juste dire deux choses ici. La première, c’est qu’on aurait bien tort de s’imaginer que la suite logique de cette remise en perspective est d’enjoliver l’ignorance. Je n’ai jamais été un partisan du « puisqu’on ne peut rien savoir, alors n’étudions rien » et l’obscurantisme n’est pas ma tasse de thé.
Mais en revanche je crois très important de remettre la connaissance à sa juste place. Sa quête est certes essentielle dans notre développement à tous, et elle doit être favorisée. Mais il m’apparaît très important de savoir identifier les limites de ce que nous prétendons connaître. Trop souvent je vois des gens se hisser facticement au-dessus des autres parce qu’ils connaissent ceci ou cela, parce qu’ils peuvent citer de tête la descendance complète des bourbons, ou réciter d’affiler l’intégrale des poèmes d’Hugo. Quelle importance à tout ceci ? Pourquoi avons-nous une tendance si forte à estimer que la connaissance constitue une vertu supérieure alors qu’elle n’est qu’une capacité technique ? Encore une fois je ne dis pas qu’elle est mauvaise en soi, mais simplement qu’elle ne doit pas être élevée au rang d’absolu qu’on la voit si souvent avoir dans les cercles les plus éduqués. Et que la valeur d’un homme n’attendra jamais la quantité de ses connaissances.
J’en reviens maintenant à l’entretien avec Lévinas que je mentionnais en introduction. Lorsque j’avais écris mes billets concernant le racisme et l’antisémitisme en m’appuyant sur le livre de Finkielkraut, La Sagesse de l’amour, j’avais évoqué le piège qu’il pouvait y avoir à décrire les personnes qui nous entourent par divers qualificatifs. En procédant ainsi disais-je, on prend le risque d’enfermer la personne dans les qualificatifs que nous lui attribuons, et ainsi de lui réfuter toute possibilité d’être autre que ce que nous imaginons. En conséquence nous l’empêchons quasiment ainsi d’être elle-même.
La « connaissance » que nous prétendons avoir de l’autre se transforme alors en une violence que nous lui faisons en voulant la formater à l’aune de la représentation que nous en avons. Nous cherchons à lui faire porter le masque que nous avons construit pour elle. Ce n’est plus une connaissance que nous avons de l’autre, c’est un diktat que nous voulons imposer, le plus souvent d’ailleurs pour faire en sorte que cette identité, que nous cherchons donc à fabriquer nous-même, ne vienne pas bouleverser le court de nos propres certitudes.
Lévinas, dans son entretien, propose ici une idée que je trouve lumineuse (je cite de mémoire) : « Pourquoi ne pas remplacer la connaissance de l’autre, par la proximité ? » C’est-à-dire qu’il accorde une importance bien supérieure aux liens que l’on saura tisser avec les autres qu’aux connaissances que nous prétendrons pouvoir en avoir. L’objectif que poursuis Lévinas dans sa réflexion est d’atteindre la paix pour tous. Mais, dit-il de façon magnifiquement juste : « donner la paix à l’autre, ce n’est surtout pas lui foutre la paix ! » C’est la proximité, le lien social qui constitue la source de la paix, et certainement pas l’éloignement, auquel malheureusement, certaines « connaissances » aboutissent encore trop souvent.
16:55 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (8) | ![]() Facebook |
Facebook |
05/09/2006
Chassez le naturel, la mémoire revient au galop !
Ce billet est le premier de ceux qui alimenteront les apartés de ma série sur Henri Laborit. Ceux-ci me permettront de donner un peu de chair à la théorie et de l’ancrer dans l’actualité.
Il y a quelque jours, Koz a publié un billet très intéressant, comme il en a l’habitude, billet qu’il a intitulé : "l’ignorance péremptoire". Il s’agit là d’un concept, inventé par lui-même, et qui lui vaudra bientôt une reconnaissance zénithique dans la nation toute entière, qui désigne la tendance de certains, malheureusement trop nombreux aux yeux de Koz, à brandir leur ignorance comme un argument de discussion sur le thème : "les experts nous éloignent des grandes décisions et confisquent les éléments du débat : c’est louche, et bien que je n’y connaisse rien, je vais tout de même donner mon avis, ça fera contrepoids. D’ailleurs mon ignorance étant un gage de mon innocence, cela devrait suffire à démontrer que mon opinion est la plus impartiale, et donc la plus juste."
A ces cris, effarouchés que des gens puissent oser se prétendre experts en tel ou tel domaine, et de surcroît en tirer légitimité pour s’exprimer à leur sujet, Koz répond : " … il ne s’agit que du processus naturel selon lequel certains disposent davantage que d’autres de certaines aptitudes". Avant de critiquer cette position, je dois d’abord dire que je rejoins évidemment Koz dans son agacement contre cette tendance ridicule qu’ont certains à prétendre que si des gens se prétendent experts, c’est forcément pour comploter contre nous. Et qu’il faut bien appeler cela de la jalousie, nourrie d’ailleurs par un sentiment d’incapacité de se hisser soi-même au même niveau d’expertise (ce qui explique pourquoi ces gens-là avancent la plupart du temps des raisons exogènes à leur méconnaissance, la reconnaissance de ses propres limites n’étant pas affaire de couche sociale…).
Mais pourtant…
La formulation qu’utilise Koz pour démontrer son propos recèle une imprécision qui la rend probablement fautive. Car s’il est parfaitement raisonnable, après avoir constaté qu’il existe effectivement des différences de compétences entre les individus pour traiter de tel ou tel sujet, de vouloir se tourner vers les plus compétents afin qu’ils éclairent les débats de leurs lumières, il s’en faut sans doute de loin que l’on puisse affirmer que ces compétences ont quoi que ce soit à voir avec un processus naturel. On m’objectera peut-être qu’il s’agit là d’un détail, mais on verra à la lecture de ma critique détaillée qu’il n’en est rien. Car c’est tout un processus de construction sociale que l’on se propose ici, grâce aux outils théoriques proposés par le professeur Laborit, de remettre en cause (quoi, on dit bien que plus c’est gros plus ça passe, non ?).
D’abord, qu’entend-on par "processus naturel" ? Qu’est-ce qui, dans l’individu que je suis aujourd’hui, relève exactement d’un "processus naturel" ? "Naturel" ça veut dire quoi ? A priori, je serais tenté de dire en premier ressort que cela désigne ce qui en moi n’a pas été affecté (sans sous-entendu négatif sur ce terme) par mon environnement (culturel, familial, géographique, etc.). Dés lors si j’essaie d’identifier ces éléments naturels en moi, je m’aperçois vite qu’il en existe peu, et qu’ils ne recouvrent très probablement que des fonctions basiques qui n’entrent nullement en jeu dans mes compétences intellectuelles.
En gros quels sont-ils ? Et bien ce sont tous les comportements primitifs qui se manifestent encore en moi : manger, boire, dormir, se reproduire. Tous les comportements qui sont principalement orientés vers ma survie organique. Laborit montre dans ses travaux que ces comportements sont effectivement des comportements instinctifs. Ils sont gérés par notre cerveau reptilien (je reparlerai plus tard des trois cerveaux), qui existe avec une fonction identique chez les autres animaux dotés d’un système nerveux.
Ces comportements répondent à nos besoins fondamentaux, innés, identiques chez tous les individus de la même espèce, et même chez tous les individus tout court (les végétaux ont aussi ces besoins, en revanche, ils n’ont pas de système nerveux, ne peuvent agir sur leur environnement pour répondre à ces besoins, et restent donc complètement dépendants de celui-ci. Leurs besoins sont donc identiques aux nôtres, mais pas leurs comportements). Ils sont régis par la "mémoire" de l’espèce, celle qui est contenue dans les gènes qui dirigent l’organisation du système nerveux. Il s’agit donc là d’une mémoire transgénérationnelle, qui se transmet d’une génération à l’autre, et qui reste intacte dans le temps.
Et maintenant, en dehors de ces instincts, de ces besoins fondamentaux que nous devons satisfaire, qu’y a-t-il d’autre qui soit "naturel", inné en somme ? Et bien rien. Tout le reste est acquis, c’est-à-dire qu’il dépend d’un processus d’apprentissage. Nos connaissances et compétences d’aujourd’hui bien sûr, mais également une grande part de ce que nous considérons à tort comme étant des choses innées (et qui ne sont donc que des compétences acquises).
Avant d’en venir au plus important sur ce point, débarrassons-nous d’une objection que je sens poindre dans le fond de la salle. Quoi ? Il n’existe donc pas d’individus particulièrement prédisposés à certaines disciplines ? N’est-il pas de notoriété publique qu’Einstein avait un cerveau d’une taille supérieure à la normale ? Mozart n’a-t-il pas dés le plus jeune âge montré un potentiel exceptionnel dans le domaine musical ? Et dans nos familles, ne voit-on pas que nous développons les uns les autres des capacités différentes, alors même que nos parents nous donnent la même éducation ?
Certes, certes, mais on oublie ici deux choses importantes. La première, c’est que nous sommes encore aujourd’hui bien en peine de dire précisément de quoi fut et est encore faite notre propre éducation. C’est-à-dire, pour être plus précis, que nous sommes tout à fait incapable de saisir, au milieu des éléments distinguables de notre éducation (la religion que nos parents nous enseignent, les valeurs humaines qu’ils nous donnent, le milieu social dans lequel nous baignons), quel est l’impact des éléments non distinguables, de tous ces micros évènements, qui nous paraissent trop insignifiants en eux-mêmes pour pouvoir nous influencer, mais qui pourtant le font, par pichenettes successives, sur notre parcours personnel. Eléments qui mis bout à bout, font qu’un frère et une sœur, bien qu’ayant été éduqués par les mêmes parents, n’auront jamais transformé les messages de ceux-ci en la même expérience personnelle, et qu’ainsi, de multiples grains de sable seront parvenus à faire bifurquer des chemins que pourtant tout destinait à être semblables.
 Et surtout, lorsque l’on pense à ces grands hommes qui ont essaimé l’histoire de leurs talents, on oublie qu’eux-mêmes n’auraient rien été s’ils n’avaient pas reçu l’éducation leur permettant d’exprimer ces talents. Et par cette éducation, j’entends jusqu’à des choses très primaires, comme le fait de marcher, de parler, de communiquer. Laborit montre bien que tout ceci n’est en aucun cas le fait d’un savoir inné, et que cela reste du domaine de l’acquis. Pour donner un exemple précis, un nouveau-né qui serait laissé à l’abandon avec simplement une intraveineuse pour le sustenter, sans aucun contact humain, sans même la moindre possibilité d’effectuer la moindre expérience, resterait, si l’on ose dire, à l’état de larve, ne développant pas la moindre des facultés qui aujourd’hui nous apparaissent pourtant comme étant proprement humaines. Il ne marcherait pas, il ne parlerait pas, il n’établirait pas de stratégie pour atteindre ce qui l’entoure, en bref, comme le dit Laborit, il ne deviendrait pas un homme.
Et surtout, lorsque l’on pense à ces grands hommes qui ont essaimé l’histoire de leurs talents, on oublie qu’eux-mêmes n’auraient rien été s’ils n’avaient pas reçu l’éducation leur permettant d’exprimer ces talents. Et par cette éducation, j’entends jusqu’à des choses très primaires, comme le fait de marcher, de parler, de communiquer. Laborit montre bien que tout ceci n’est en aucun cas le fait d’un savoir inné, et que cela reste du domaine de l’acquis. Pour donner un exemple précis, un nouveau-né qui serait laissé à l’abandon avec simplement une intraveineuse pour le sustenter, sans aucun contact humain, sans même la moindre possibilité d’effectuer la moindre expérience, resterait, si l’on ose dire, à l’état de larve, ne développant pas la moindre des facultés qui aujourd’hui nous apparaissent pourtant comme étant proprement humaines. Il ne marcherait pas, il ne parlerait pas, il n’établirait pas de stratégie pour atteindre ce qui l’entoure, en bref, comme le dit Laborit, il ne deviendrait pas un homme.
Cela n’a absolument rien d’une simple représentation théorique. Je me souviens d’un fait divers particulièrement odieux, rapporté il y a de ça de nombreuses années, et qui m’avait suffisamment marqué pour que je m’en souvienne encore aujourd’hui. Un jeune garçon d’une dizaine d’années avait été retrouvé dans la cave de sa maison, vivant là comme un animal. Les policiers qui l’avaient découverts avaient vite compris qu’il s’agissait d’un enfant non désiré, que ses parents avaient élevé au sens propre comme un chien, en lui donnant à manger dans une gamelle, sans couverts, et en ayant avec lui des rapports humains qui se résumaient à lui jeter sa nourriture et à l’insulter.
Les policiers avaient été marqués par le fait que le garçon, une fois sorti des griffes de ses parents-bourreaux, ne manifestait aucune rancœur envers eux, et même, semblait parfaitement stupéfait du nouveau traitement qu’il recevait. N’ayant été "éduqué" dés son plus jeune âge, que comme un animal sans importance, il n’avait développé aucun des comportements humains normaux pour un enfant de son âge et était resté à l’état primitif que ses parents lui avaient assigné. Il s’exprimait de façon désordonnée, montrait un comportement "sauvage", et il restait incapable d’éprouver les émotions et d’avoir les comportements "humains" auxquels tous nous nous attendrions dans de telles circonstances. Il s’était "adapté" au mode de vie qui lui avait été proposé, et celui-ci lui semblait donc comme étant le seul "normal".
Ainsi on voit bien que des choses aussi simples, ou semblant telles, que parler, marcher, etc. sont des savoirs, des capacités, que l’on acquiert et qui ne sont donc pas innées. Bien sûr, notre patrimoine génétique porte en lui le potentiel de ces capacités, mais il n’en reste pas moins que celles-ci ne sont pas innées. Pour faire court, prédisposition n’est pas disposition.
Venons-en maintenant à l’analyse de nos comportements appris, analyse qui va nous permettre de reboucler sur la critique de la position de Koz. D’où viennent la plupart de nos comportements appris, comment ceux-ci sont-ils aujourd’hui guidés ? On peut le comprendre à travers l’analyse du fonctionnement de la mémoire. On a vu précédemment, que nos comportements primitifs, reptiliens si l’on peut dire, sont régis par notre mémoire génétique, "naturelle". Mais nos comportements sociaux, sont eux régis par une autre mémoire, qui existe au niveau du système limbique (ou cerveau mammalien).
On considère généralement que le système limbique est essentiellement le siège des émotions, des sentiments. Laborit lui donne un rôle plus précis :
"Considéré classiquement comme le système dominant l’affectivité, il paraît plus exact de dire qu’il joue un rôle essentiel dans l’établissement de la mémoire à long terme, sans laquelle l’affectivité ne paraît guère possible".
En effet, l’expérience a montré que les différents influx nerveux qui parcourent notre cerveau, passent de préférence par les voies neuronales déjà utilisées pour coder les mêmes expériences. En gros, lorsque pour la première fois nous embrassons une fille ou un garçon, l’influx nerveux qui s’ensuit va dégager des molécules particulières qui vont atteindre une synapse, et la modifier. Par la suite, lorsque nous répèterons cette expérience, l’influx nerveux généré passera préférentiellement par ce canal, car il a déjà été codé préalablement pour traiter son information. C’est ainsi que se forme la mémoire.
Comment agit ensuite cette mémoire ? Et bien lorsqu’un évènement survient, elle enregistre les sentiments et les émotions éprouvées qui sont liés à cet évènement. Cet enregistrement va permettre ensuite à l’individu, soit de répéter l’expérience éprouvée comme agréable, soit d’éviter l’expérience désagréable. Je ne vais pas aujourd’hui décrire tout ce processus, cela fera l’objet d’un autre billet dans ma série concernant les travaux de Laborit. Je compte seulement m’arrêter ici sur les stratégies mises au point pour répéter les expériences agréables.
Lorsqu’un individu a vécu une expérience agréable, sa mémoire va entrer en jeu et il va vouloir par la suite répéter cette expérience. C’est ce que Laborit appelle le réenforcement, ou répétition de l’action gratifiante. Or, pour pouvoir répéter cette action, il faut que l’objet sur lequel l’expérience agréable initiale s’est produite soit encore accessible et à la disposition de la personne. Laborit montre que c’est ce processus qui est donc à l’origine de ce que l’on appelle faussement l’instinct de propriété. Car il ne s’agit nullement d’un instinct, qui aurait alors une dimension innée, mais bien de l’apprentissage fait, par la voie de la mémoire, d’une expérience agréable que l’on va souhaiter reproduire.
Ayant identifié certaines expériences qui lui permettent de se faire plaisir, l’individu va comprendre qu’il ne pourra donc les revivre que si les objets liés à ces plaisirs restent à sa disposition, qu’il en est en quelque sorte propriétaire. Et c’est alors qu’il va mettre en place les stratégies qui vont l’assurer que ces biens restent toujours à sa disposition. Il va alors chercher à étendre sa maîtrise du territoire sur lequel se trouvent ces objets gratifiants. Laborit montre d’ailleurs que le territoire, s’il ne contenait aucun objet gratifiant, ne serait jamais défendu.
On le comprend déjà, une des stratégies les plus efficaces pour s’assurer la disponibilité des biens gratifiants est la dominance :
"Nous verrons qu’en situation sociale, ces besoins fondamentaux ou acquis ne peuvent généralement s’assouvir que par la dominance", dit Laborit.
La dominance devient nécessaire à établir lorsque deux groupes d’individus entrent en lutte pour les biens gratifiants qu’offre un même territoire. Leur confrontation va résulter en l’établissement d’une hiérarchie entre eux, qui va déterminer à quelle quantité de biens gratifiants les uns et les autres vont avoir accès. La volonté de maîtrise de "son" territoire, née de la notion de propriété, est donc à la source de la guerre (ce point méritera d’autres développements).
Or aujourd’hui, et c’est bien évidemment surtout le cas dans nos sociétés modernes, la dominance est assurée par la maîtrise d’informations abstraites, de concepts langagiers, de théories. C’est la capacité de manipulation de ces données abstraites qui permet à son détenteur de se hisser au-dessus des autres et d’obtenir une position dominante. Cela signifie notamment que la perpétuation de ces concepts, et aussi leur renouvellement, participe à faire perdurer la hiérarchie existante.
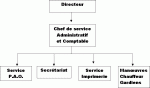 On peut trouver un exemple très simple de ce phénomène : la tendance au jargon si répandu dans le milieu professionnel des cols blancs. Ayant moi-même suivi un enseignement supérieur en école de commerce, j’ai toujours été frappé de la complexité, voire parfois de l’étrangeté des termes employés pour désigner des situations simples. Combien de théories stratégiques, combien de modèles managériaux n’a-t-on pas inventé ? Or, que produit in fine un jargon ? Exactement ce que produit tout langage : un cloisonnement entre ceux qui le maîtrisent et ceux qui ne le maîtrisent pas. En bref, il établit une hiérarchie de savoir et de compétences, et dans l’exemple que j’indique, cela s’étend à l’établissement d’une hiérarchie sociale.
On peut trouver un exemple très simple de ce phénomène : la tendance au jargon si répandu dans le milieu professionnel des cols blancs. Ayant moi-même suivi un enseignement supérieur en école de commerce, j’ai toujours été frappé de la complexité, voire parfois de l’étrangeté des termes employés pour désigner des situations simples. Combien de théories stratégiques, combien de modèles managériaux n’a-t-on pas inventé ? Or, que produit in fine un jargon ? Exactement ce que produit tout langage : un cloisonnement entre ceux qui le maîtrisent et ceux qui ne le maîtrisent pas. En bref, il établit une hiérarchie de savoir et de compétences, et dans l’exemple que j’indique, cela s’étend à l’établissement d’une hiérarchie sociale.
J’ai déjà indiqué cette idée dans un précédent billet: le langage participe d’une fermeture du groupe qui le détient, car il définit pour partie son identité. Ici, dans le cas qui nous occupe, cette fonction est beaucoup plus criante que pour nos langues maternelles. Vraiment, quand aujourd’hui j’entends certains directeurs ou consultants utiliser un verbiage pompeux pour justifier telle ou telle stratégie d’entreprise, je ne peux m’empêcher de penser qu’en même temps ils envoient un message implicite pour rappeler à quel milieu social ils appartiennent et réaffirmer ainsi leur dominance.
Cependant, je dois reconnaître sur ce point, et j’en terminerai là-dessus, qu’il est fort probable qu’ils envoient ce message de façon relativement inconsciente. Car aujourd’hui, après des milliers d’années passées à établir des stratégies de dominance, nous avons perdu la conscience du but premier de celle-ci : nous permettre de répéter des actions gratifiantes. Laborit l’explique très bien, et je le laisse donc vous le dire :
"…le langage, signifiant support de toute sémantique qui lui est propre, n’exprime plus l’objet seulement mais l’affectivité liant celui qui s’exprime à cet objet. L’homme est passé ainsi de la description significative au concept lui permettant de s’éloigner de plus en plus de l’objet et de manipuler des idées à travers les mots, sans être vraiment conscient de ce qui animait sa pensée, à savoir ses pulsions, ses affects, ses automatismes acquis et ses cultures antérieures. Ainsi, en croyant qu’il exprimait toujours des faits qu’il appelle objectifs, il ne s’est pas rendu compte qu’il ne faisait qu’exprimer toute la soupe inconsciente dont ses voies neuronales s’étaient remplies depuis sa naissance, grâce à l’enrichissement culturel, c’est-à-dire à ce que les autres, les morts et les vivants, avaient pu coder dans ces voies neuronales".
Certains hocheront probablement de la tête de façon dubitative en songeant qu’ils ont bien l’impression d’être la plupart du temps parfaitement conscients de ce qui les fait agir. Ils se trompent. J’en ai eu encore confirmation dans l’émission Rayon X diffusée la semaine dernière sur le service publique. Elle rappelait que 90% (oui oui 90%) de nos actions étaient exclusivement liées à des automatismes comportementaux dont nous étions parfaitement inconscients. 90% de tout ce que nous faisons dans une journée est fait plus par ce qu’on pourrait appeler la mémoire du corps, qui se souvient de ce qu’il a à faire dans telle ou telle situation que par un véritable processus de pensée consciente (au fait, vous n'avez aucun tics vous?, hm?). Ce point également fera l’objet d’une plus ample analyse ultérieurement.
Il me faut maintenant conclure ce billet déjà bien long. Je voudrais tenter de le faire en reprenant la formulation de Koz pour l’ajuster avec ce que nous avons ici découvert. Ainsi sa phrase :« il ne s’agit que du processus naturel selon lequel certains disposent davantage que d’autres de certaines aptitudes » devient désormais :« Il s’agit de l’héritage de choses apprises et inscrites dans nos cerveaux depuis des milliers d’années, qui font qu’aujourd’hui, certains se sont dotés davantage que d’autres de certaines aptitudes, et dont ils se servent pour maintenir leur dominance ».
Je vous raconterai la suite plus tard, et Jean Rochefort, dans Les tribulations d'un chinois en Chine, ajoutait: "Elle ne manque pas de sel !"
N.B: toutes les citations de Laborit utilisées dans cet article sont extraites de son livre La colombe assassinée.
14:35 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |
Facebook |
19/07/2006
Déménagements et projet de société
Lorsque j’étais en terminale, notre professeur de philosophie, qui portait le cheveu savamment bouclé, et qui avait l’habitude de nous regarder avec un petit sourire supérieur en coin lorsqu’il citait un grand philosophe, pour nous épater, et nous montrer l’écart qu’il y avait entre nous, pauvres béotiens, et lui, le philosophe, qui savait voir les choses avec une oreille humant l’air du temps dégagée des carcans de pensée traditionnels, et ainsi ouverte à une vraie réflexion, nous gratifiait parfois de remarques qu’il voulait aussi marquantes qu’elles étaient censées aller à contre-courant de l’air du temps (Gustave Labarbe, sort de mon corps ! *).
Mais parfois, il arrivait que ces sorties originales nous donnent l’occasion d’entendre quelque chose de vraiment intéressant. Ou plutôt, qu’il nous donne quelques idées pour démarrer nous-même notre réflexion, ce qui, dans le fond, est probablement une bonne manière d’enseigner la philosophie.
Ainsi, nous avons abordé un jour la question du sens qu’on pouvait donner à ce qu’est une société de consommation. En se basant très simplement, et comme souvent d’ailleurs, sur le sens des mots, et donc en particulier sur celui du mot consommer. Je recopie ici la définition qu'on trouve dans le dictionnaire de l'académie française: v. tr. XIIème siècle, au sens de « détruire, anéantir ». Emprunté du latin consummare, « faire la somme de », d'où « accomplir, achever », mais, sous l'influence, dès le latin chrétien, de consumere, « consumer, manger », d'où « détruire ». Ce dictionnaire suggère même de se reporter au mot consumer pour en savoir plus ...
Consommer un produit, c’est l’utiliser, et ainsi l’user, ce qui conduit à plus ou moins long terme à sa destruction. Consommer de la nourriture ou une boisson même, cela ne veut rien dire d’autre que la détruire de façon immédiate lorsqu’on l’ingère. De sorte qu’il n’est pas ridicule à ce stade d’estimer qu’une société de consommation est par conséquent aussi une société de destruction, une société qui, puisqu’elle rappelle si souvent sa nature consommatrice, semble par conséquent assumer que sa principale activité est d’utiliser, transformer puis consommer et donc détruire, les produits et les matières qui sont mis à sa disposition par la nature.
Cette perspective inspire le pessimisme à deux titres. D’abord parce que comprendre que la société à laquelle on participe, tend vers une fin bien éloignée des grands idéaux dont on aurait voulu pouvoir la draper, a quelque chose d’assez déprimant pour nos égos. On peut toutefois estimer que cet objectif, n’en est pas vraiment un, mais qu’il n’est en réalité que la conséquence éloignée, et il faut bien l’admettre, pas si évidente que ça à identifier, de notre comportement naturel de recherche de confort et de richesses. Mais alors ceci laisse supposer que l’érection de cet « objectif » s’est faite de façon quasi inconsciente, ce qui n’a rien pour nous rassurer quant à notre capacité à le remettre en cause, puisque il est alors en grande partie lié à des éléments que nous contrôlons mal voire pas du tout.
Ensuite et surtout, parce qu’intuitivement on comprend bien qu’il n’est pas possible de détruire éternellement, et qu’il existe nécessairement une limite qui ne peut pas être dépassée. Certes il apparaît d’emblée très compliqué d’identifier où se situe cette limite, et pourtant on perçoit bien que cela constitue un des défis les plus importants qu’il nous revient de relever dans les décennies à venir. Car si nous n’y parvenons pas il se pourrait que l’on franchisse cette limite sans s’en apercevoir, avec à la clé les conséquences irréversibles que cela suppose.
Mais bien sûr on comprend que ce tableau reste caricatural et simpliste. Je ne vais pas m’avancer trop loin dans cette réfutation, je la laisse plutôt aux économistes, qui seraient le plus à même d’indiquer les limites de ces remarques. Tout juste puis-je subodorer que les circuits économiques ne sont pas purement linéaires, partant d’une production pour aller jusqu’à la consommation, qui serait la fin de vie du produit, mais qu’ils fonctionnent souvent en cycles, dans lesquels la consommation n’est qu’une étape dans un processus plus long, voire procède d’une transformation du produit initial pour en faire autre chose. Il me semble qu’il existe des types de « consommations » qui ne résultent pas dans la disparition du bien consommé mais qui peuvent participer à son renouvellement ou à la régulation de sa « population » (je pense à la chasse par exemple), ou encore que cette consommation peut entraîner un développement sur un autre plan (une personne qui mange se donne les forces nécessaires pour se développer, travailler, etc.). Qu’en bref, c’est une question complexe et que donc ma première impression reste insuffisante pour bien la cerner.
Pourtant je ne peux m’empêcher d’y percevoir une vérité. Vérité qui apparaît de façon très frappante lors d’un évènement personnel courant et dont je deviens un habitué ces temps-ci: un déménagement. Il suffit d’avoir à vider une maison dans laquelle furent entassés plusieurs années d’achats de bric et de broc pour s’apercevoir du volume que l’on « consomme » et que l’on se voit obligé de jeter ledit jour du déménagement, et saisir ainsi à quel point cette consommation peut se transformer en une destruction pure et simple. Vraiment tout y passe : des meubles qui servirent un jour et qui sont devenus inutilisables tant ils sont rongés par le temps, aux vêtements qui déjà à l’époque devaient faire rire nos camarades (quoi qu’ils ont dû porter les mêmes), en passant par les gadgets achetés sur un coup de tête, qu’on n’a jamais utilisés, et qui ont pris la poussière en restant dans leurs emballages. Les déménagements s’apparentent ainsi fréquemment à de grands coups de balais qui alimentent les décharges presque plus sûrement que nos futures habitations.
Et ce phénomène est d’autant plus étrange lorsque l’on doit pourtant passer ses week-ends à refaire les magasins pour s’équiper en mobilier et en matériel de tous les jours…
* : j’offre un dragibus jaune au premier qui comprend cette parenthèse.
19:15 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook |
Facebook |
07/06/2006
Réponse à Pan: les incohérences du libéralisme
Pan propose un débat intéressant sous ma récente note concernant la journée sans tabac organisée par l'OMS. Un débat sans doute un peu (beaucoup?) rabâché, mais qui me donne l'occasion de revenir d'une façon personnelle sur quelques points qui m'apparaissent contestables dans la logique libérale. J'ai d'abord envisagé de répondre à Pan en commentaire, mais tout cela étant finalement assez long, je préfère répondre en postant ce billet, c'est plus lisible ainsi. Vous excuserez je l'espère la construction peut-être un peu inhabituelle de ce post, puisque c'est principalement à Pan que je m'adresse ici. Pour mieux le comprendre, je suggère que vous vous réferriez à la discussion engagée jusqu'ici, ou encore au document proposé par Pan et qui présente quelques fondements de la théorie libérale.
Pan, je crois comprendre à la lecture du document que vous proposez que vous estimez que les lois ne devraient pas exister puisqu'elles sont le fait de l'état. Seuls comptent le respect des droits individuels.
Plusieurs éléments m'apparaissent contradictoires sinon irréalistes dans cette vision.
Tout d'abord, qui établit quels sont les droits individuels ? Vous? Chaque individu de façon isolée et dans son coin? Un groupe d'individu (auquel cas on va d'une certaine façon retomber dans une organisation par groupe qui aurait les mêmes défauts fondamentaux que ceux que vous attribuez à l'état) ? On s'aperçoit déjà sur ce point qu'on tombe sur un os. Il est absolument évident qu'on ne peut pas se fier à l'agrégation des envies de chacun pour établir quels doivent être les droits individuels, sinon on obtiendrait une liste interminable, impossible à suivre et à faire respecter. Et vous ne pourriez pas me répondre: "les droits individuels sont, le droit à la propriété, etc." Vous ne feriez là que dire que sont les droits individuels SELON VOUS, et ça ne saurait en aucun cas refléter ce que veulent également les autres (la probabilité pour que votre opinion sur la question soit suivie par l'ensemble de la population avoisinant le zéro absolu). Or, si ça ne reflète pas ce que veulent les autres, la seule solution que vous auriez pour les faire respecter serait d'utiliser la force, ce que précisément vous semblez rejeter comme étant le travers de l'organisation étatique classique.
On voit donc déjà sur ce point qu'il est tout à fait illusoire de prétendre établir quels sont les droits individuels sans avoir recours à un organisme d'une forme ou d'une autre. Et bien évidemment, que cet organisme relève de fonds privés ou public ne change rien au fond de l'affaire: il faut remettre, au moins partiellement, dans les mains d'autres personnes, le choix de ce qui est bon pour nous.
Le deuxième point, mais je l'ai en fait déjà abordé juste avant, c'est que quelques soient les problèmes à résoudre, il est absolument irréaliste de prétendre que les solutions envisagées par tel ou tel individu puissent être universellement acceptées. Et pourtant il est bien nécessaire de parvenir à ce consensus, faute de quoi, une personne au moins se trouvant lésée, toute la rhétorique qui veut soutenir la logique libérale s'effondre sur elle-même. Il suffit d'une personne. Si elle n'est pas satisfaite de ce qu'on lui propose, alors le lui imposer est nécessairement lui faire violence selon votre "philosophie". Et comment, sur une planète de 6 milliards d'hommes parvenir à ce consensus ? Qui peut sérieusement croire que c'est possible ? Personne. La seule chose qui est atteignable, et encore difficilement, c'est "un moindre mal", un compromis dans lequel chacun accepte de céder sur certaines de ses revendications pour obtenir satisfaction sur d'autres. Et ce compromis, on l'obtient précisément en établissant des structures, des institutions, qu'on souhaitent être le plus représentatives possibles des volontés des personnes, et qui vont être en charge de faire des choix. Et là également, le débat argent public argent privé tombe à plat puisque les fondements du problème à résoudre restent strictement les mêmes dans un cas comme dans l'autre. D'ailleurs, il n'est pas anormal que des personnes qui souhaitent voir leurs volontés réalisées au travers d'une institution, dotent cette institution des moyens nécessaires à son travail. En bref, qu'ils la financent par des fonds publics (les leurs). Vous n'êtes pas d'accord avec cette réalité des choses? Je peux le comprendre, mais dans la mesure où elle a été choisie par les autres, vous ne pouvez pas la déconstruire sans exercer une violence contre eux. Or ceci vous mettrait en porte-à-faux vis-à-vis des idées que le libéralisme semble prôner: pas de violence, sous peine de quoi vous vous rendriez vous-même dictateur.
Dans le fond, il me semble de plus en plus clairement que le libéralisme est un idéalisme, une utopie, quelque chose de parfaitement irréalisable parce qu'il nécessiterait un universalisme de pensée qui est et qui restera impossible (et que je ne crois pas souhaitable).
Mais aussi parce que, dans la mesure où ni l'état ni les lois n'existeraient, et qu'il n'y aurait donc aucune autorité pour faire respecter les droits individuels, cela nécessiterait que chaque individu sache en toute circonstance, et à chaque instant de sa vie, se comporter de façon rigoureusement respectueuse des autres. Non seulement ceci est totalement impossible dans un groupe de 6 milliards d'individus qui sont constamment en interaction, et donc en partie en confrontation les uns avec les autres, mais même à la seule échelle individuelle, c'est une vue de l'esprit de croire que c'est possible. C'est un rêve. Ca n'a encore jamais existé, et ça n'existera jamais. Et Pan, je ne doute pas que vous soyez une personne très respectable et que votre comportement soit principalement inspiré de bonnes valeurs humaines, mais je parie ma chemise que vous n'êtes pas parfait. Et si vous ne l'êtes pas, et que rien ne garantit que vous n'ayez un jour un comportement violent ou agressif injustifié et bien je veux qu'il existe des moyens pour vous contraindre à l'être plus que par la seule action de votre conscience.
Ce monde que vous semblez souhaiter, il n'existe pas, et à mon avis il n'existera jamais, en tout cas pas sur cette planète. Ce qui est le plus frappant pour moi, c'est que les limites de la vision que vous indiquez me semblent évidents, vraiment frappants. Le texte que vous indiquez en lien est intéressant, il présente des idées que j'aurais tort de repousser d'un revers de la main, et je sais bien qu'il existe des études sans doute encore plus savantes que celui-ci pour expliquer en quoi le libéralisme est bon. Mais cette complexité de langage et de réflexion ne m'apparaît poursuivre en réalité qu'un seul but: justifier d'une façon complexe et élaborée, et qui nécessite donc un travail approfondi pour être contestée, un comportement absolument basique qui est la volonté de satisfaire sans entrave ses désirs personnels. Rien d'autre. C'est le bonheur personnel que l'on cherche ici, et en aucun cas un bien collectif. Ce qu'on veut à travers toutes ces explications, c'est juste trouver un moyen de rendre acceptable un comportement exclusivement égocentrique, et ainsi pouvoir supprimer toutes les entraves, même celles qui seraient morales et non légales, à son expression.
Mais sur ce dernier point, que les adversaires du libéralisme ne se réjouissent pas trop: il est plus que probable qu'ils agissent de même pour justifier leurs propres orientations. C'est ce que l'on verra sur ce blog dans quelques temps, à travers une série détaillée que j'envisage de faire concernant Laborit et ses travaux. Ce n'est pas exactement pour tout de suite, mais j'espère y arriver à bout durant cet été. C'était peut-être ça, la série mystérieuse que j'avais promise un soir de brume ...
15:05 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (45) | ![]() Facebook |
Facebook |
29/05/2006
Ne méprisons pas la souffrance
Mon blog est en train de se faire avaler par un grand trou noir. Je n’ai plus d’ordinateur personnel depuis quelques semaines (disque dur mort), j’ai été pris toute la semaine dernière par mes travaux (qui avancent, mais punaise quand on est seul et de surcroît génétiquement handicapé pour les travaux manuels, c’est pas facile), et la fréquentation de cet espace s’en ressent très lourdement (même si je note que, très sympathiquement, Blogspirit continue de faire semblant de compter des entrées).
C’est donc en situation « blogging de survie » que je poste ce billet (si mon chef me lit, je le salue). Sur un sujet qui va en plus passionner tout le monde et qui en dit long sur mon niveau de connection avec les dernières informations : le passage de Joey Starr chez Ardisson samedi soir.
Il présentait son dernier livre, une autobiographie écrite avec Philippe Manœuvre, intitulée « Mauvaise réputation ». J’en avais un peu entendu parlé la veille dans le magazine de la santé, sur France5, et la présentation qui en avait été faite donnait un peu envie de tourner quelques pages dudit ouvrage. Visiblement, Joey Starr s’est livré à un exercice pas évident, et peut-être encore moins pour lui qui semble plus souvent chercher à donner des gages de virilité qu’à se dévoiler, en racontant un peu les détails de son enfance, et notamment de l’éducation reçue par son père.
On y découvre que Joey Starr a été élevé par son père, à la ceinture, et dans une ambiance générale pour le moins « virile ». L’anecdote la plus marquante étant sans doute celle du lapin. Un jour, le père de Didier Morville (puisque c’est son vrai nom) ramène un petit lapin blessé, et le lui donne. L’enfant s’en occupe, s’y attache, l’aide à se rétablir. En quelques jours, celui-ci devient le petit centre chaud de sa vie quotidienne. Puis un matin, son père lui demande d’amener son lapin, et le petit Didier s’exécute. Son père donne alors deux coups de planches au lapin pour le tuer, et force son fils à le manger au repas de midi. Sympa.
Ce qui m’a frappé durant l’interview du chanteur, ce fut l’attitude générale des gens sur le plateau, tant d’Ardisson-Baffie, que des invités, et en particulier de Maurice Druon. Car alors que l’on raconte l’histoire d’une enfance battue et maltraitée, tout le monde semble faire comme si de rien n’était, comme s’il s’agissait dans le fond d’une histoire cocasse, haute en couleur, de celle que l’on connaît fréquemment chez les artistes, en particulier quand ils sont de cette trempe là, et donc bon, rien de très particulier à tout ça, dans le fond on reste dans le connu et le prévisible, et Joey Starr, maintenu dans un univers violent, même si ce n’est pas lui l’auteur des violences en questions, n’est dans le fond perçu que perpétuant ce pour quoi on l’attend : une histoire sordide d’un gosse des cités.
Puisqu’il a la politesse de bien conserver l’étiquette publique qu’on lui colle volontiers, alors même que son bouquin semble donner quelques pistes pour faire comprendre qu’il ne peut pas tout à fait être résumé à cette seule étiquette, personne ne bronche, et l’interview se poursuit sur le ton bon enfant qui sied le mieux aux émissions de divertissement. Maurice Druon, disais-je, se détache tout de même un peu du lot, en se rapprochant plus que les autres du pire. On le voit arborer un sourire immense, pouffer lors de l’explication de certains passages du livre. Pour lui pas de doute, on raconte là l’histoire d’une enfance exotique et bigarrée qui le change du milieu engoncé de l’Académie Française.
Et il touche le sommet lorsque, en intervenant suite à la mention des coups de ceinture et de ceinturon, il indique que selon lui, l’éducation s’accommode très bien de quelques coups donnés à un enfant, pour lui faire comprendre le concept d’autorité. Je ne souhaite pas ici aborder le débat sur l’éducation des enfants pour savoir s’il est bon qu’elle soit musclée ou non, mais relever l’incroyable absence de sensibilité, dont le par ailleurs très valeureux Druon, a témoigné à ce moment là.
Car ce n’est pas une éducation normale qu’on évoquait alors, on ne parlait pas de la gifle traditionnelle donnée en réprimande d’une bêtise. Et il s’agissait encore moins d’une « histoire » seulement bonne à remplir un livre. Non, on parlait d’un enfant qui a été maltraité et battu par son père, et qui semble toujours témoigner, du moins pour ce qu’en montrent les médias, de l’influence qu’a exercé cet environnement violent sur lui.
D’ailleurs, à l’image, cette dichotomie apparaissait assez nettement. Car tandis que les autres persistaient dans leur légèreté, Joey Starr se montrait lui peu à l’aise, touché par moment par certains détails qui étaient rapportés par Ardisson. Son comportement, ses gestes, le choix de certains mots, témoignaient, il me semble, de la blessure encore vive qu’avait laissé ce père dans la vie du garçon. L’un des cameramen fut apparemment le seul de la joyeuse bande à saisir ce malaise, qui fit plusieurs gros plans sur les mains de l’artiste, lorsque celles-ci se joignaient nerveusement, comme pour contenir les émotions que l’histoire soulevait.
Et lorsque Druon indiqua qu’il trouvait qu’une bonne paire de gifles faisait parfois le plus grand bien, on vit Joey Starr se rejeter légèrement en arrière, tourner la tête en sens opposé à l’académicien qui était à sa gauche, esquisser discrètement un signe négatif de la tête. Je me trompe peut-être, mais je crois qu’à ce moment là c’était très clair : Joey Starr n’assimilait pas son enfance et les coups de ceinture de son père à de simples claques, et non il ne devait pas trouver que ce qu’il avait subit pouvait être ainsi méprisé et rabaissé à une banale histoire de choix d’éducation. Je crois que s’il avait ouvert la bouche à ce moment là, il aurait volontiers dit qu’il aurait bien aimé voir Druon à sa place pour savoir s’il prendrait toujours la chose avec le même sourire.
Qu’on comprenne bien de quoi il s’agit ici pour moi. Pas de faire des différents participants de l’émission des monstres sans cœur et incapables de réagir avec sensibilité devant un récit sordide. Mais plutôt d’adresser un avertissement contre ces comportements qui laissent trop facilement passer des faits ignobles sous le seul prétexte que c’est du passé et que celui qui les a vécu semble s’en être bien sorti. En passant, on voit très bien dans cet exemple quel mal peuvent faire les étiquettes lorsqu’elles collent trop solidement aux gens. Je suis absolument persuadé que si ce récit avait été fait par un garçon auquel ne collait pas une image aussi sulfureuse et entourée de violence que Joey Starr les réactions auraient été beaucoup plus peinées et attentives.
-----------------
L’ironie de l’histoire pour moi, c’est que c’est chez Fogiel dimanche soir que j’ai entendu la phrase qui me semblait la plus percutante pour répondre à ces attitudes. Il présentait en fin d’émission le livre semble-t-il très intéressant de Xavier Pomerreau, intitulé Ado à fleur de peau, qui traitait des signes de souffrance manifeste que les adolescents laissent parfois (j’ai eu du bol, je n’ai regardé que ce passage de l’émission). Xavier Pommereau a eu une phrase clé selon moi, que je reproduis environ : « Il n’y a rien de pire que de mépriser la souffrance des adolescents. »
Je crois qu’on peut clairement généraliser cette idée à tout le monde, aux adolescents autant qu’aux non-adolescents. Et dire qu’il n’y a rien de pire pour quelqu’un qui souffre ou qui a souffert, de voir les autres remettre en cause la réalité ou même seulement la force de cette souffrance. C’est comme si l’on niait ce que l’autre à vécu et qui fait pourtant partie de ce qui l’a le plus marqué. C’est aussi un message qui dit en substance : « nous ne t’aiderons pas », puisque précisément on ne considère pas que cette souffrance en vaille la peine. On enfonce ainsi un peu plus la personne qui souffre dans sa solitude, ce qui est pourtant dans de très nombreux cas exactement ce qu’elle a besoin de rompre pour se donner une chance de ne plus souffrir.
On trouvera peut-être que mon jugement est excessif, mais pour moi une telle absence de sensibilité est quasiment criminelle. Elle fait partie de ces comportements scandaleux dont Camus écrivait dans le Mythe de Sisyphe qu’ils sont aussi nombreux que répandus parmi les hommes.
14:55 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook |
Facebook |



