21/12/2005
Amour subit ou choisit ?
Attention, billet long.
Billet précédent de la série
Dernière note sur La sagesse de l’amour, pour conclure cette longue série entamée il y a déjà un mois et demi. Il est d’ailleurs temps d’en finir car je sens que mes billets Finkielkrautiens n’ont intéressé que peu de monde, voire ont fait fuir une partie de mon lectorat qui était déjà restreint. J’ai tout de même tenu à aller au bout de ces notes ne serait-ce que pour me constituer à titre très personnel une base de textes de réflexion que je pourrais reprendre plus tard. Que cette démarche un peu égocentrée ne vous empêche pas toutefois de continuer à commenter si vous le souhaitez. Cet espace est fait pour ça.
Aujourd’hui je voudrais revenir sur un point spécifique du livre de Finkielkraut, un peu plus éloigné des questions du totalitarisme, du racisme et de l’antisémitisme que je cherchais à préciser par la lecture de son livre, et plus proche de la question de l’amour, du sentiment amoureux. Le sujet en vaut vraiment la peine, et je l’aborde ici avec un vrai plaisir.
Finkielkraut, vers la fin de son livre, montre son pessimisme sur la pureté innocente qu’on peut être tenté d’associer au sentiment amoureux. On aurait été surpris qu’il l’évoque autrement tant il insiste dès le début sur la violence que l’intrusion de l’autre fait subir. Double violence puisque non seulement autrui m’arrache à ma quiétude solitaire en surgissant, mais en plus m’impose la responsabilité de son destin, par l’intermédiaire de son visage. Dans cette requête qu’il me fait, il m’accuse a priori si d’aventure je n’y réponds pas. En même temps qu’il me dégrise de moi-même il me pointe du doigt, moi et ma recherche de tranquillité égoïste.
Car pour Finkielkraut il est clair que cette assignation faite par autrui de le prendre en compte n’est pas quelque chose de choisi. C’est l’autre qui s’impose à moi et non moi qui le désire. Je suis en quelque sorte un spectateur impuissant auquel on demande de monter sur scène et de prendre part à la pièce contre son gré. C’est l’autre qui fait irruption et qui m’enchaîne à lui. Ainsi Finkielkraut écrit :
« Je suis dérangé, dégrisé de ma vie, réveillé de mon sommeil dogmatique, expulsé de mon royaume d’innocence, et appelé par l’intrusion d’autrui à une responsabilité que je n’ai ni choisie ni voulue. »
« Amour si l’on veut mais amour à contrecoeur ; amour éprouvant ; amour qui est le nom le plus courant de la violence avec laquelle l’autre me débusque. »
Et enfin :
« Voici mon existence condamnée à ne pas trouver sa justification en elle-même. »
En effet, dans la relation qui se noue avec autrui, celui-ci m’indique en quelque sorte que je ne peux pas être sans lui. Puisqu’il condamne la possibilité de mon évitement, il rend illégitime ma solitude. Ma vie ne peut donc plus être vécue seule. Elle doit, pour acquérir sa légitimité, porter attention à autrui. Voilà la violence ultime que celui-ci me fait subir, et à laquelle je peux chercher à échapper (notamment en répondant par la haine nous dit Finkielkraut).
Il n’y aurait donc pas de mouvement naturel qui nous pousse vers l’autre. Le lien que l’on noue avec autrui serait avant tout fondé sur une prise de pouvoir imposée par lui, et qui pour moi se fait « à contrecoeur ». Exit la belle idée de l’élan spontané, de l’amour romantique donné sans retenue. Mais alors quid des qualités humaines telles que la générosité, le don, la bonté ? Ne seraient-ce donc que des mots par lesquels nous donnons une image romancée, idéalisée, et dans le fond erronée, de nos comportements ? Voici ce que dit Finkielkraut de la bonté :
« Qu’est-ce que la bonté ? C’est le fait de répondre « me voici » à l’interpellation d’un visage […] C’est se sentir mis en question par la voix qui vous parle –obligé, accusé, requis- et c’est accepter cette responsabilité exorbitante. C’est, au lieu de se raidir, ou de se détourner, accueillir le prochain dans la mauvaise conscience, qui est la modalité de l’hospitalité morale. On peut parler de bonté quand un être suspend son mouvement spontané d’exister et se désintéresse de son être pour se préoccuper d’un autre être. »
Là encore, la bonté n’est pas au départ un mouvement spontané et gratuit de moi vers l’autre, mais seulement la réponse donnée « dans la mauvaise conscience » à l’appel de l’autre. Finkielkraut voit dans l’amour et la bonté non pas des vertus, mais des charges, des « vocations indésirables » et non désirées, vers lesquelles on ne s’oriente que sous la contrainte, par le fait du sentiment de culpabilité que l’autre a fait naître en nous.
Diantre.
Avant d’en venir à ma critique de ce point de vue, je voudrais essayer de me faire un peu l’avocat du diable en complétant l’idée de Finkielkraut par ce que j’ai lu chez Laborit (je dois un peu donner l’impression de faire des fixations maniaques sur mes lectures, non ?). Dans l’Eloge de la fuite (suivez ce lien, vous y lirez un excellent texte de synthèse sur les idées sociologiques de Laborit), Laborit décrit l’amour d’une façon qui recoupe en partie la vision de Finkielkraut.
L’idée de Laborit (sur l’amour mais aussi sur tous nos comportements) est très bien résumée dans cette phrase : « Nous ne vivons que pour maintenir notre structure biologique, nous sommes programmés depuis l’œuf fécondé pour cette seule fin, et toute structure vivante n’a pas d’autre raison d’être que d’être. » En d’autres termes, tous nos prétendus élans bienfaiteurs ne sont que des réponses biologiques, programmées dans nos cellules, afin que notre organisme puisse assurer son équilibre au mieux. Il ne s’agit que de préserver notre structure organique, et pour cela de faire en sorte que nous puissions réaliser nos actions gratifiantes. Mais pour pouvoir les réaliser « ni vu ni connu », nous avons besoin de déculpabiliser nos actions, de leur donner l’apparence du pacifisme inoffensif, voire mieux, d’un sentiment pur et positif envers autrui. C’est le rôle de l’amour qui va permettre de prendre possession de l’autre (cet autre étant notre gratification), de façon exclusive (pas question de partager ! En tout cas si c’est bien l’autre qui est notre gratification, et pas ce que l’on peut accomplir à travers lui), et en donnant à cette manœuvre les atours de la noblesse de coeur.
En bref, l’amour n’est que le mensonge que l’on utilise pour cacher la vraie raison de notre liaison avec l’autre : la recherche de la dominance. Là où Finkielkraut voyait dans l’amour la réponse à contrecoeur à la violence faite par l’intrusion de l’autre dans notre vie, Laborit dit lui que l’amour n’est au fond qu’un mot romantique pour cacher une réalité biologique, presque animale, à laquelle nous répondons de façon programmée et où nul véritable sentiment n’intervient.
Oui mais voilà, je suis pour ma part un incorrigible romantique. Et bien que Laborit m’a déjà expliqué que la réflexion ne servait dans le fond qu’à donner des alibis à nos choix égocentrés, je veux quand même tenter ma chance.
Tout d’abord, il y a je crois une limite dans le raisonnement de Finkielkraut, et qu’on perçoit d’ailleurs quand on lit l’argument de Laborit. Il n’envisage la relation avec l’autre que sous l’angle de celui qui « reçoit l’autre ». A aucun moment il n’envisage la part d’acteur qu’a nécessairement l’individu dans sa confrontation avec autrui. Car si autrui fait intrusion dans ma vie et rompt la tranquillité de ma solitude, je n’exerce pas moins exactement la même pression contre lui. En d’autres termes, il me semble que la première erreur de Finkielkraut (ou disons une limite de son analyse) est qu’il envisage la relation avec l’autre de façon exclusivement unilatérale alors qu’elle est par essence bilatérale. Il n’y a pas seulement un « moi avec l’autre » dans la relation, mais un « nous », une interaction, alors que Finkielkraut en reste imperturbablement à la vision égocentrée de l’individu qui prend l’autre dans la figure (ho ho ho).
Dès lors on comprend que chaque détournement du visage de l’autre devient une occasion pour moi de faire un pas et à mon tour de lui signifier l’assignation que je lui fais de me considérer. C’est un échange qui s’installe, où chacun va avancer vers l’autre, céder des parts de son terrain, et conquérir celles que l’autre aura laissées accessibles sur le sien. Là aussi il y a une sorte de contrat qui prend forme, mais dans lequel chacun reçoit et donne.
Mais surtout, je crois qu’il y a une faille importante dans les raisonnements de Finkielkraut et de Laborit. C’est que tous les deux n’envisagent l’homme que dans un comportement de réponse à ses pulsions naturelles. Chez le premier l’autre ne peut être violence contre le cours tranquille de ma vie solitaire que si je me perçois uniquement comme individu qui agit en tout pour répondre à ses tendances « naturelles », à ses inclinations, et ceci à l’exclusion de toutes autres considérations. Et chez Laborit, l’argument est encore plus fort : l’homme est un être biologique, comme tous les autres êtres vivants, et en tant que tel toutes ses actions ne sont entreprises que pour assurer son équilibre biologique, comme pour tous les autres êtres vivants. En bref nous sommes tout entiers soumis à notre déterminisme naturel.
Cette vision des choses ma paraît partielle. Je ne crois pas comme Finkielkraut et Laborit que l’homme ne puisse orienter son comportement que vers la satisfaction de ses inclinations, même si je leurs reconnais une force que l’on sous-estime largement (sans doute à cause de notre orgueil d’ailleurs). Et c’est peut-être d’ailleurs cette faculté de ne pas toujours agir conformément à ces désirs qui nous différencie du règne des animaux. Mais d’où proviendrait donc cette faculté, cette liberté (il s’agit bien de cela) de s’extraire de son déterminisme et de ses bassesses égoïstes ? De l’exercice de la volonté, qui me permet de dépasser ma recherche du plaisir et d’envisager un bien autre que celui directement orienté vers moi.
Car le seul but recherché à travers la réponse à nos inclinations c’est notre plaisir, qu’on confond bien souvent avec le bonheur. Je me souviens d’une émission de télévision où une invitée avait fait cette remarque : « Peut-être que le but de l’humanité n’est pas le bonheur. » Kant répondrait sans doute qu’avant la recherche du bonheur, le premier devoir de l’homme est d’agir conformément à la morale. Avant de chercher à être heureux nous devons d’abord faire en sorte que notre comportement soit conforme aux « maximes qui peuvent s’ériger en lois universelles » (je fais court).
Notre nature intègre cette notion de volonté, et notamment de volonté bonne ou tout du moins (Kant lui-même s’interrogeait sur l’existence de cette volonté bonne dans Les Fondements de la métaphysique des moeurs) cette recherche d’une volonté bonne. Etre homme c’est donc aussi dépasser ses inclinations par cette recherche, par cette tension vers cet horizon idéal de l’exercice d’une volonté bonne. Loin de contrefaire ma nature par cette recherche je l’exprime au contraire dans ce qu’elle a de plus abouti.
Ainsi, il m’est possible de choisir, de décider de m’élever au-delà de mes inclinations, au-delà de mon déterminisme biologique. Car réaliser entièrement ma nature d’homme c’est peut-être justement apprendre à me dompter moi-même, à apprivoiser ma nature biologique, et à décider de me rendre d’emblée vulnérable à l’intrusion de l’autre. Il perd alors son statut d’intrus non désiré. Certes il continue d’exercer une pression sur ma vie (mais le terme de violence me semble en partie exagéré), mais cette pression je l’ai acceptée a priori, en acceptant la vulnérabilité par laquelle je peut m’offrir à l’autre et rompre avec mon existence égoïste. Le « me voici » de Finkielkraut n’est plus une réponse donnée à la requête de l’autre, il intervient avant même que celui-ci n’ait surgit. C’est le sacrifice préalable de la part égoïste de mes inclinations, c’est le renoncement choisi, voulu à la satisfaction systématique de mon plaisir.
Et c’est par ce choix, par cette acceptation de cette humilité d’être d’emblée accessible à l’autre et de lui offrir des parts de mon territoire, que j’exprime pleinement ma nature d’homme, et que je transcende en moi celui qui est « les liens qu’il tisse avec les autres ». La faculté d’aimer pourrait donc être la sagesse et la supériorité de l’homme sur le règne animal, le choix contre nature qui se transforme en affirmation de sa vraie nature.
18:25 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (11) | ![]() Facebook |
Facebook |
20/12/2005
Stress, humour et commissariat
Une fois n'est pas coutume, je recopie in extenso un passage rédigé sur mon site de gestion du stress pour le sujet d'aujourd'hui, auquel il ne me semble pas utile d'ajouter grand chose.
"L'humour permet de prendre de la distance par rapport aux événements qui nous affectent. Du point de vue psychologique, le rire est une détente pour l'esprit. Il possède une action relaxante. C'est une défense contre le stress, et la tristesse. Pour les psychanalystes, l'humour et le rire sont un moyen de détourner la souffrance psychique et de se protéger : c'est un processus de défense, "une sorte de réflexe de fuite dont la tâche est de prévenir la naissance du déplaisir". Beaumarchais disait déjà "je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer". Mais le rire n'a pas qu'une efficacité psychique. Il a aussi des vertus physiologiques. Sous l'effet du rire, le diaphragme subit des contractions/décontractions alternatives qui contribuent à réaliser une véritable gymnastique interne, agissant sur les poumons, les organes abdominaux et le système cardio-vasculaire. Cette sorte de massage interne serait responsable du sentiment de bien-être et de décontraction que l'on ressent après un bon fou rire. Plus globalement, le rire diminue le tonus musculaire général et élimine ainsi tensions et agressivité."
Par exemple, hier au commissariat au milieu de la plainte déposée pour agression, l'inspecteur reprend un extrait de la déclaration: "son compagnon était sur le trottoir au bout de la rue, et faisait le guet". J'ai d'abord un peu tilté sur l'usage du terme "compagnon" (on dit plutôt complice que compagnon, non?) mais ce n'est que quelques instants après, en repassant toute la phrase dans ma tête, que j'ai éclaté de rire !
Et ben ça m'a vachement décontracté le diaphragme.
10:00 Publié dans Un peu de développement personnel | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2005
Aux sources du racisme et de l'antisémitisme (tentative de conclusion)
Billet précédent de la série
Je termine presque ma lecture de La sagesse de l’amour de Finkielkraut. J'ai conscience que l'étude que je mène ici est un peu en déphasage avec l'actualité de l'auteur. Mais d'autres (et notamment eux) parlent déjà de façon intéressante de cette actualité, et peut-être l'étude dépassionnée d'un texte de fond de l'auteur pourra-t-elle aussi apporter son grain à ces discussions animées.
Aujourd’hui je voudrais compléter la réflexion que j’avais entamée dans mon billet précédent sur les sources du racisme et de l’antisémitisme. A nouveau je vais procéder en traitant séparément racisme et antisémitisme, afin que mon propos soit le plus clair et le plus ordonné possible. J’avais avancé que le racisme « classique » naissait notamment de ce que la couleur de l’autre stigmatisait sa différence et interdisait ma tentative d’échapper à celle-ci. Lorsque le visage de l’autre m’assigne la responsabilité de le considérer, mon premier réflexe est de chercher une échappatoire, une issue qui me permette de retrouver ma quiétude initiale, mon innocence tranquille. Mais si je peux espérer y parvenir en face d’un visage qui me ressemble (et tous les critères peuvent intervenir pour établir cette ressemblance, la couleur de peau bien sûr, mais aussi l’origine culturelle, les critères sociaux, etc.), cette tentative est d’emblée réduite à néant face à un visage qui exprime aussi violemment sa différence que par sa couleur de peau. Impossible d’y échapper.
Mais un aspect important du racisme m’a échappé dans ma première analyse. Et qui intervient autant dans l’antisémitisme. C’est la vision hiérarchique des hommes qui prévaut dans ces idéologies. Que dirent les premiers conquérants européens lorsqu’ils découvrirent ces peuples « barbares » d’Amérique ou d’Afrique ? Ces gens-là ne sont pas des hommes. Ce sont des sauvages qui ne nous sont nullement comparables. Ils n’ont pas la même valeur que nous, il y a une hiérarchie dans la valeur que l’on peut accorder aux êtres vivants et ceux-là nous sont inférieurs. Comment cette hiérarchie est-elle établie ? Et bien justement par la différence visible que l’autre m’offre. Sa seule différence me permet de dire qu’il existe une hiérarchie. Elle me donne l’opportunité de dire : « puisque nous sommes différents, nous ne pouvons pas avoir la même valeur ». C’est là presque uniquement une question de logique. En effet, si deux éléments sont différents, c’est qu’ils n’ont pas les mêmes caractéristiques, et partant, ils ne peuvent pas avoir les mêmes vertus. Désormais le plus important est fait. Il existe une hiérarchie dans la valeur des hommes, et sa seule réalité va suffire à justifier toutes les discriminations possibles.
Car à partir du moment où c’est moi qui établis l’existence de cette hiérarchie il m’est facile et « naturel » de me situer tout en haut de cette échelle. C’est ma culture, mon niveau de maîtrise technologique, l’ancienneté de mon histoire qui vont m’apporter les arguments justificatifs de ma supériorité. Voire encore plus simplement la démonstration de ma supériorité en force : je suis le conquérant, c’est donc bien moi le dominant, l’être supérieur. Voilà l’alibi suprême que se donne le racisme contre l’homme de couleur. Il n’y a pas à le traiter avec autant d’égard que j’attends moi-même d’être traité car il n’a pas la même valeur que moi. Il apparaît dès lors logique que j’étalonne mon comportement vis-à-vis de lui en fonction de sa « vraie valeur ».
Cette erreur reste très argumentée et c’est la raison pour laquelle on a encore souvent bien du mal à s’en dépatouiller et à la déconstruire. Mais pourtant elle est énorme. Parce qu’elle assimile les personnes à leurs caractéristiques. Dans le fond ce qu’elle dit ce n’est rien d’autre que : « tu es les caractéristiques dont je te qualifie », « tu es ce que je vois en toi », « ma carte est la vérité de ton territoire ». Elle clame de façon définitive que l’autre est bien cet assemblage de qualificatifs qu’on a fait de lui, et rien d’autre que cela. Il est son masque, ce que j’affirme être son « vrai visage ». Son visage nu n’existe pas. On oublie par là que l’homme n’est pas ce qu’il a ni ce qu’il fait (à ce sujet, c’est un sentiment assez particulier de voir certaines notions sur lesquelles je réfléchis de façon particulière depuis l’ouverture de mon blog se recouper et parfois se renforcer, se préciser les unes les autres). Mais je reviendrai là-dessus dans ma conclusion.
Passons maintenant à l’antisémitisme. Le point particulier de la haine du juif me semblait être essentiellement que celui-ci, alors même que par l’apparition de son visage me donnait la responsabilité de le considérer, m’indiquait par son comportement, par sa « force » qu’il n’avait pas besoin de ma sollicitude. Il m’oblige et simultanément me dit qu’il n’a pas besoin de moi, que je lui suis inutile, il m’interdit le passage. Et je lis dans les dernières pages du livre de Finkielkraut un passage qui me semble valider l’idée que j’avais ainsi formulée.
« Le grief le plus ancien dirigé contre les juifs vise […] leur fidélité tenace à un mode de vie rigoureux, leur fermeture au monde et les barrières qu’ils dressent, comme à plaisir, entre eux et le reste de l’humanité. »
Mais Finkielkraut avance un autre élément, qui n’intervient que dans l’antisémitisme, et vient s’ajouter à la partition du rejet. C’est l’insaisissabilité de la différence du juif, son caractère vaporeux, presque fantomatique. On ne parvient pas à l’identifier clairement et à la catégoriser. Elle est impalpable et ne se laisse pas enfermer aussi simplement qu’une « bonne vieille couleur de peau noire » (mon expression).
« La différence juive n’est inquiétante que parce qu’elle est inassignable. »
On leur reproche d’être une société invisible, serpentaire, qui complote dans son intérêt et contre celui des autres. Le juif n’offre donc pas la simplicité de la différence visible et clairement identifiable. Et c’est là sa plus grande « trahison ontologique » dit Finkielkraut. De ne pas dévoiler sa différence de façon à ce que je puisse m’en saisir facilement. Et en réfléchissant bien c’est très probablement ce défaut de différence visible qui a poussé les nazis à réclamer le port de l’étoile de David en brassard. Ainsi ils disposaient d’un signe extérieur distinctif qui leur permettait de reconnaître le juif parmi les autres. La société secrète était enfin dévoilée au grand jour.
Je voudrais terminer cette analyse par un point précis évoqué par Finkielkraut dans sa description des mécanismes qui ont rendu la solution finale possible. Il montre, notamment à travers le témoignage recueilli à l’époque d’un chef de camp, le rôle de l’indifférence dans le geste terminal qui a envoyé des millions d’individu dans les fours crématoires. Lorsqu’on lui demande comment il a pu agir ainsi, ce chef de camp indique qu’il ne voyait pas en eux des hommes. Ils n’étaient qu’un magma informe de chair grouillante et gesticulante. C’est notamment la raison pour laquelle ils faisaient enlevé aux déportés leurs vêtements avant de les gazer. Pour ne plus avoir à affronter leur réalité, leur visage, celui-ci se faisant, presque littéralement, recouvrir par leurs corps dénudés. Les visages n’étaient alors plus visages mais seulement peau uniforme, extrémités d’un bloc uni et non identifiable comme être humain. C’est bien l’indifférence qui a permis de dépasser tous les stades de l’horreur. Mais Finkielkraut semble hésiter sur le rôle de l’indifférence et il la mélange à l’expression de la haine.
« Avec le nazisme, ce principe d’indifférence littéralement déchaîné, se répand partout, jusque dans le domaine qui lui paraît le plus irréductible : la haine de l’autre homme. »
Je crois précisément que si les nazis avaient « seulement » haït les juifs, ils n’auraient pas pu se livrer à une destruction aussi systématique. C’est parce qu’ils ont élevé l’indifférence à son plus haut degré, qu’ils ont pu adopter une démarche aussi dépassionnée de tuerie méthodique, organisée, industrielle. On voit là clairement pourquoi, comme je le disais dans un billet plus ancien, l’indifférence c’est la mort, la négation le plus aboutie de l’autre.
D’ailleurs plus loin, Finkielkraut semble rejoindre cette idée (c’est bien pourquoi il me semble un peu confus sur ce point précis du rôle de l’indifférence) lorsqu'il écrit :
« Parce qu’était neutralisé le visage de ses victimes, tout lui était possible. Tout, c’est-à-dire le dépassement des limites dans lesquelles le Mal reste maintenu lorsqu’il fonctionne à la rage et n’obéit qu’aux impulsions de la bestialité. »
J’aurais peut-être quant à moi ajouter « et de la haine » pour finir sa phrase.
Il est temps maintenant de conclure sur les sources du racisme et de l’antisémitisme. Fondamentalement ces deux comportements se fondent sur le rejet de l’autre en tant qu’homme. C’est parce qu’on trouve une façon de nier à l’autre sa qualité d’homme qu’on peut se permettre de le haïr et de le rejeter. Si l’on ne trouvait pas de moyen pour supposer cette non humanité de l’autre, la tâche de son rejet serait insurmontable. J’ai toujours pensé qu’un des moteurs principaux de nos actions et de nos choix est de maintenir toujours et en toute circonstance notre innocence initiale. Nous ne tolérons pas d’être accusables de quelque chose, et cherchons sans cesse à nous disculper, voire à nous trouver de bons sentiments pour cacher nos penchants égoïstes ou destructeurs des autres (je fais très très court là). Le racisme et l’antisémitisme doivent eux aussi résoudre ce dilemme. Il leur faut un alibi, une justification, et la plus argumentée possible pour qu’elle offre un minimum d’angles d’attaque, pour pouvoir « s’épanouir » complètement, pour être absout de la faute qu’ils commettent.
Comment faire en sorte de préserver, au moins pour soi, l’image de l’innocence, de la bonne vertu morale ? Et bien en annihilant l’inhumanité de notre action par la déshumanisation de notre victime. On ne fait pas de mal à proprement parler à un masque, à un morceau de chair. Et dès que la barrière morale a sauté, tout est permis, on peut se déchaîner. Parce que je ne vois qu’un tas de chair informe dépourvue de visage et d’humanité s’avancer vers les chambres à gaz, je peux tolérer la tuerie systématique à laquelle je me prête. Effrayant aveuglement que celui de la négation de l’humanité de l’autre, que cette indifférence programmée pour absoudre des fautes commises.
« Techniquement » si j'ose dire, cette déshumanisation de l’autre passe par la stigmatisation de sa différence : la couleur de peau, le brassard avec l’étoile de David. Une fois que l’autre est différent et reconnu comme tel, je peux envisager par un raisonnement « logique » qu’il existe une hiérarchie dans la valeur des hommes. Et puisque c’est moi qui établit cette hiérarchie cela me place naturellement en haut de celle-ci. Je suis le décidant, celui qui défini pour les autres quelle place leur revient. Puisque l’autre m’est inférieur, alors je peux, en toute logique, le traiter comme tel, et donc avoir moins d’égard pour lui que j’attends d’en recevoir.
En fait dans ce processus de rejet on s’aperçoit que systématiquement on fait parler en l’autre son milieu, son histoire et son passé. Ce n’est pas l’autre qui me fait face mais ce à quoi je le rattache culturellement et en quoi je crois percevoir la réalité de son être. Il est possédé par son environnement, et n’existe pas en tant que tel. On oublie ici la complexité de l’individu qui, si elle se nourrit de son environnement, de ses expériences, de ses lectures, etc. n’en est pas pour autant réductible à ces seuls éléments extérieurs. Je ne suis pas La sagesse de l’amour, je ne suis pas la gestion du stress, je ne suis pas mes haïkus. Bien sûr ils désignent certains de mes caractères, mais ils ne suffisent pas à m’identifier, à me donner mon identité.
Et surtout, j’en reviens à ce que j’indiquais dans cet ancien billet : fondamentalement, j’ai la même valeur que tout autre homme que moi, quelques soient les actions de celui-ci, quel que soit son passé ou même que ses intentions. Cela ne veut pas dire qu’on doit nier les différences qui peuvent tout de même exister entre les individus. Mais il faut les remettre à leur place. Ce qui est différent, ce sont nos attributs, nos goûts, bref les signes extérieurs qui soulignent nos choix et nos orientations, mais seulement cela. Ce sont éventuellement nos passés et nos intentions qui n’ont pas les mêmes valeurs, et que l’on peut juger et condamner, mais moi, en tant qu’homme, je ne puis établir de hiérarchie entre moi et l’autre. L’autre me vaut, et je le vaux. Il est mon semblable, et dans l’interaction qui se joue dans l’échange de nos regards (interaction que Finkielkraut oublie d’ailleurs complètement dans son livre et sur laquelle j’espère revenir dans un prochain billet) je me reconnais en lui, je comprends que répondre à son assignation, c’est répondre simultanément, et pour moi-même, à celle que je lui soumets. Parce que c’est en traitant l’autre en homme que je manifeste, que j’affirme en même temps ma nature d’homme.
Billet suivant de la série
14:55 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (10) | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2005
Partition neuve

Attraper les absences, les doutes, les murmures,
Capturer les maux, les souffles et les silences
Puis délier les paroles
Les tracer en portée joyeuse, en notes vives.
Et jouer la horde éclatante du renouveau
A lire en fredonnant la musique pour soi (saurez-vous trouver de quel morceau il s’agit ?)
15:40 Publié dans Un peu de poésie | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2005
Stress et croyances
Nos croyances interviennent à plein dans le niveau de notre stress face à telle ou telle situation. Parce qu’elles influencent notre manière de réagir face à ces situations, elles nous conditionnent à les recevoir de telle ou telle manières. Ainsi, un contrôle policier pourra-t-il engendrer des réactions différentes selon la façon d’appréhender le rôle des policiers. Quelqu’un qui aura été éduqué d’une façon très protégée, et n’ayant vu des uniformes que dans Julie Lescaut pourra ressentir un stress important lors d’un banal contrôle d’identité, alors que pour le d’jeun de banlieue ayant la chance d’appartenir aux « minorités visibles » ce sera là l’occasion d’une bonne rigolade et du renouvellement du lien de franche camaraderie qui l’unit aux gardiens de l’ordre public.
Il en va de même au travail. Pour celui qui perçoit l’entreprise comme un lieu d’oppression et d’exploitation de l’homme, le stress lié au travail sera très important. En revanche le jeune issu d’école de commerce qui verra dans l’entreprise l’outil par lequel il va enfin pouvoir montrer tout ce qu’il vaut et qui a tant manqué au monde pendant tout le temps de ses études sera beaucoup moins stressé : pour lui l’entreprise n’est pas un lieu d’oppression mais au contraire celui qui va lui donner sa chance, celui par lequel il va se réaliser et s’épanouir.
C’est parce que nos croyances ont un impact fort sur notre stress qu’un travail de fond sur soi-même est nécessaire si l’on veut réellement apprendre à gérer son stress. Parce que nos croyances, bien souvent, presque tout le temps même, nous viennent d’expériences lointaines, de conditionnements, d’éléments profonds de notre éducation (ou de notre construction pour reprendre un terme intéressant de Quoique). Travailler sur nos croyances, ce n’est pas pour autant les déconstruire complètement, sous peine de prendre le risque de défaire tout à fait nos repères, ce qui engendrerait sans doute un stress bien plus grand. Il s’agit en revanche de savoir les mesurer pour leur donner leur juste place, et permettre des remises en cause lorsque cela est nécessaire, afin d’acquérir une plus grande fléxibilité.
Et bien sûr les croyances religieuses figurent parmi les plus importantes. Une étude étonnante coréalisée en 2000 par David Larson et compilant les données de 42 recherches a d’ailleurs montré que « avoir la foi et pratiquer sa religion prolongerait l’espérance de vie de 29% » ! La prière apparaît notamment comme un très bon « médicament » anti-stress. Elle agit sur l’hypothalamus qui influe sur le rythme cardiaque et la tension artérielle, ainsi que sur la production d’hormone comme le cortisol (le niveau de cortisol est directement en relation avec notre sensation de stress). Qu’on comprenne bien : ce qui importe ici ce n’est évidemment pas les signes extérieurs de la foi, mais l’enracinement de celle-ci pour la personne. Quelqu’un qui vivra pleinement sa foi aura un outil de plus pour gérer son stress. (Je précise que personnellement je suis non croyant).
On voit ici qu’en introduisant les croyances dans nos sources de stress, on va pouvoir formuler une critique de l’échelle de Holmes et Rahe, proposée en 1967 et dont voici le détail (mis sous forme Excel). L'échelle Holmes-Rahe est utilisée pour calculer le niveau de stress et déterminer la probabilité que la santé soit affectée au cours de l'année qui vient. Ne tenez compte que des événements qui se sont produits au cours des 24 derniers mois et calculer votre niveau de stress en additionnant les points qui correspondent aux différents évènements listés.

Si d'autres événements ou situations stressantes se sont produits au cours des 24 derniers mois, vous devez les noter en leur accordant une valeur identique à celle d'événements comparables (ex: grève et modification des conditions de vie, conflit avec des collègues de travail et problèmes avec les beaux-parents, etc.). Vous ajouterez leur valeur à celle du total de vos points.
Résultats
Moins de 150 points: stress modéré
Entre 150 et 300 points : stress élevé
Plus de 300 points : stress très élevé
Quand on lit certains évènements listés sur l’échelle de Holmes et Rahe on peut être surpris. Personnellement, je suis étonné que le mariage figure parmi ceux-ci, et encore plus les voyages ou les vacances. Mais je comprends que ma manière d’appréhender ces évènements peut être différente pour d’autres. Ceux qui n’ont jamais voyagé dans leur vie doivent effectivement se sentir peu à leur aise le jour du départ, et pour ceux qui vivent leur ont une vie privée décevante ou stressante, la venue des vacances n’est pas forcément une bonne nouvelle. Mais on se rend bien compte ici qu’il est nécessaire d’intégrer ces éléments pour bien juger de l’impact de ces évènements. Et c’est la première limite de l’échelle de Holmes et Rahe, que certains relèvent avec humour.
Mais à mon sens, il y a un deuxième défaut dans cette échelle, et qui est peut-être encore plus grave, parce qu’il ne concerne pas la méthode de celle-ci, mais son projet. Imaginez quelqu’un qui ne parvient pas à se sortir de ses problèmes et qui va rechercher fiévreusement une solution pour réduire son stress. Si cette personne applique au premier degré la solution implicite de la méthode Holmes et Rahe que va-t-elle faire ? Et bien elle va très logiquement se mettre en situation d’éviter tous les évènements de la liste. Et comment peut-elle réussir ce pari ? En limitant au maximum l’apparition d’évènement dans sa vie, en balisant son environnement et son quotidien de sorte qu’aucune surprise (bonne ou mauvaise si l’on suit la logique de l’échelle) ne vienne « perturber « la course de sa vie. Bref, en ne vivant plus. On comprend immédiatement que cette logique est néfaste. Quel stress ressentira cette personne lorsqu’à 40 ans elle se retournera sur sa vie et qu’elle ne verra rien ! Le problème n’est donc pas de limiter les facteurs de stress, mais d’apprendre à les gérer, à les accepter pour ce qu’ils sont, et seulement pour ce qu’ils sont.
15:55 Publié dans Un peu de développement personnel | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |
09/12/2005
La culture d'origine: Kelman & Krysztoff v Mona Cholet
Krysztoff a produit hier un billet intéressant issu de sa lecture du livre de Gaston Kelman « Je suis noir et je n’aime pas le manioc », qui l’a visiblement pas mal marqué. Une des idées les plus intéressantes qu’il rapporte est la déconstruction faite par Gaston Kelman de la notion de « culture d’origine » à laquelle on chercherait encore (trop) souvent à rattacher les enfants d’anciens immigrés (ou les enfants des enfants d’immigrés, ou… etc). On attribue à ces personnes, de façon presque pathologique, une culture originelle qui est celle du pays d’où viennent leurs aïeux, alors même qu’ils n’ont jamais connu autre chose que la France et ne sont parfois jamais parti à l’étranger.
Ainsi, Kelman relève l’idée qui me semble très juste que ces jeunes fils et filles d’immigrés sont bien plus rattachés à la culture française qu’à tout autre. Un jeune qui est né en banlieue parisienne et y a vécu toute sa vie est culturellement parlant plus proche d’un parisien dont toute la lignée a vécu en France que des habitants du pays d’où venaient ses parents. Et ainsi, il ne s’agit pas du tout d’intégrer ses jeunes à la société française, mais bien de reconnaître enfin leur appartenance pleine et entière à notre société et à notre culture. Ils n’en sont pas des éléments originaux auxquels échouerait un travail d’inscription de notre culture dans leur comportement. Le « travail » revient surtout à ceux de souche gauloise qui n’acceptent toujours pas que ces descendants d’immigrés sont bel et bien des citoyens français à part entière.
Cette idée de Kelman est intéressante et je crois qu’elle devrait être un des fondements de la réflexion à mener dans la lutte contre certains processus d’exclusion. Mais j’y vois une limite, que relève en partie Mona Cholet dans l’article qu’elle a rédigé en avril 2004 au sujet du livre de Kelman, et que Krysztoff indique en lien. Je dois d’abord dire que si je trouve des éléments intéressants dans son texte, Mona Cholet ne me paraît pas moins procéder à une caricature très excessive de la pensée de Kelman. Mais donc, je vois une limite aux propos de celui-ci, et qui est très manifeste lorsque Krysztoff résume son idée en disant : « oui, culturellement parlant, ses ancêtres sont bien des gaulois ».
Il me semble que Kelman et Krysztoff vont trop vite sur ce point. Parce qu’il choisissent pour ces individus à quelle culture ceux-ci doivent se rattacher, alors que cela ne peut provenir que du propre choix des intéressés. Certes ils sont nés (et peut-être déjà leurs parents, voire leurs grands-parents) en France, et y ont vécu toute leurs vies. Mais pourquoi cela devrait-il signifier qu’ils doivent assimiler intégralement la culture française presqu’au point de renier de leurs origines anciennes ? S’ils se sentent proches de cette culture originelle, je ne vois pas de raison de les en déraciner, même s’ils vivent en France sous l’auspice de nos lois et de nos institutions. C’est à eux de déterminer à quelle culture ils entendent le plus se rattacher.
Pour que mon idée soit claire je vais tenter une analogie avec un enfant adopté. Un jour ses parents adoptifs lui annoncent qu’ils ne sont pas ses géniteurs. Ce jour là, libre à lui s’il le souhaite de chercher ses « vrais parents ». Il peut tout à fait décider de ne pas entreprendre de recherches, comme il peut au contraire chercher à comprendre plus précisément d’où il vient. Et s’il retrouve ses géniteurs, il doit pouvoir être libre de choisir de rester avec eux ou du moins de les intégrer pleinement à sa vie, ou de ne pas le faire.
A mon sens il en va de même pour les individus issus de près ou de loin à une culture étrangère. Qu’on me comprenne bien (et je pense que Krysztoff a d’abord dû sursauter en lisant mes premières lignes). Il ne s’agit bien sûr pas d’accepter ces personnes et leurs cultures quoi qu’il en coûte, et entre autre au détriment de la nôtre. S’il y a un élément dans leurs cultures qui est en contradiction forte avec nos valeurs, et notamment avec notre droit, il ne me semble pas normal qu’il soit accepté. Certes une certaine flexibilité a priori doit à mon avis présider vis-à-vis de ces différences afin de ne pas les rejeter de façon trop mécanique (sinon on s’interdit d’évoluer), mais il serait je crois idiot de décréter qu’on peut tout accepter. La différence n’est pas nécessairement belle parce qu’elle est différence. Il faut savoir l’évaluer, la mesurer, la juger pour ce qu’elle est vraiment.
Mais dans la mesure où leurs cultures ne rentrent pas en conflit avec la nôtre, ou leur expression ne devient pas exclusive de nos valeurs, et qu’elles apportent la richesse de leur altérité (promis bientôt j’arrêterai de me gargariser avec ce terme), elles doivent pouvoir être accueillies à bras ouverts. Ou alors c’est qu’on a une vision figée de la société, qu’on ne lui donne pas les chances de découvrir d'autres horizons et d’évoluer. Et même, la fierté que peut ressentir une personne quant à ses origines ne me paraît pas nécessairement en contradiction avec son acceptation de la culture du pays où elle vit. On peut tout à fait être fier du passé de ses ancêtres sans pour autant rejeter le système dans lequel on vit parce que celui-ci est différent. C’est simplement l’affirmation de (toute) son identité, et cela ne signifie pas forcément que celle-ci est réduite à cette fierté et qu’elle n’est pas autant construite par son environnement quotidien.
D’ailleurs on s’aperçoit là que le vrai problème n’est pas que certains aient choisi de se rattacher à la culture de leurs (parfois lointaines) origines, mais plus qu’ils l’ont fait de façon exclusive, c’est-à-dire en rejet de toute autre culture et en particulier de la nôtre. Ce n’est donc pas en proposant à notre tour un système exclusif qu’on pourra résoudre ce problème. On ne ferait ainsi qu’exacerber le conflit en radicalisant encore plus les positions. C’est une culture de la tolérance et de l’ouverture saines qui doit être favorisée. Quand je dis « saines » cela veut dire, en respect de règles sans lesquelles cette tolérance et cette ouverture ne seraient qu’un « gant sans main » (expression que j’emprunte à Kandinsky), parce qu’inapplicable.
17:55 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |
Facebook |
Imprécis de ... euh... de lol et de ptdr
C'est vendredi, le week-end approche, rions un peu. Aujourd'hui je vous conseille la lecture de la dernière planche de Stanislas Gros (qui a décidemment un coup de crayon fantastique) et qui fait une démonstration très rigolote sur les lol, mdr et autre ptdr (on apprend même les traductions étrangères de ces expressions internetiennes).
10:17 Publié dans Un peu de rire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2005
Inférences et surinterprétations
Je dois faire un petit retour sur un ancien billet écrit dans ma série sur la communication et l'écoute et qui traitait des inférences. En effet, pour toute personne qui n'a pas travaillé un peu au préalable sur cette question, je m'aperçois que ce que j'écrivais peut porter à confusion en mélangeant inférences et surinterprétations. Les inférences (enfin il ne s'agit ici que de celles qui sont trompeuses) ne sont pas assimilables à des surinterprétations, simplement elles peuvent en être la cause.
Petit rappel, sans doute pas inutile. L'inférence est ce par quoi on va aboutir, à partir d'une observation, à une conclusion susceptible de guider un choix, une décision. Ce qui est bien pratique dans la vie de tous les jours. Par exemple, lorsque j'observe un chien avec un collier courrir tout seul dans la rue, je me dis qu'il s'est enfuit de chez lui, et qu'il pourrait être bon de le récupérer et de contacter ses maîtres afin d'éviter un accident malheureux (toute ressemblance avec un évènement vécu serait une sacrée coïncidence).
Mais parfois on se laisse berner par nos inférences, on oublie leurs limites, et on s'empresse de conclure sur la base d'observations qui ne sont pourtant pas suffisantes pour le faire. C'est ainsi qu'une personne pourra croire que si elle a gagné au loto, c'est grâce au trèfle à quatre feuilles ramassé plus tôt dans la journée. En dépit du manque évident de lien logique entre les deux évènements. On attribue à un phénomène une cause imaginaire, non corroborée. C'est le même processus qui agit dans certains types de surinterprétations, lorsque l'on veut prêter à des gens des idées qui seraient à la source de certains de leurs discours.
Un exemple que j'avais pris dans mon premier billet était celui de personnes très promptes à déceler sous le moindre propos économique une intention libérale nécessairement ennemie du peuple. Et il est bien possible qu'on retrouve le même type de procédé derrière certains discours anti-racistes "faciles" et empressés de stigmatiser l'autre sans vraiment chercher à comprendre son discours. Je pense ici notamment au dernier commentaire de Kryztoff qui me semble aller dans le même sens. Qu'on me comprenne bien, je ne pense pas que Finkielkraut (puisqu'il s'agit encore de lui) ait été très fin dans ses propos recueillis par Ha'aretz. Mais à lire certaines critiques qui lui sont faites, je crois qu'on va un peu trop vite pour vraiment être objectif dans l'analyse de son intention.
Et c'est d'ailleurs, chose amusante, la lecture de La sagesse de l'amour, toujours du même, qui vient en renfort de mon idée. Finkielkraut décrypte vers la fin du livre une forme de bêtise qui est je crois très répandue: celle des gens qui savent mieux, de ceux "à qui on ne la fait pas" et qui prétendent lire derrière les paroles des autres la vérité que ceux-ci chercheraient à cacher. Pour ne pas faire de doublon et que cette idée soit bien claire je cite:
"Glorieuse surdité de celui à qui on ne la fait pas parce qu'il a l'oreille plus fine. C'est ainsi que se répand une bêtise travestie en vigilance. Ses adeptes n'invoquent pas pour couper court au dialogue le sceau d'une autorité transcendante. Ils lisent derrière les propos du partenaire la vérité cachée qui le détermine. A leur vis-à-vis ils opposent non le front têtu de qui n'entend pas mais le sourire en coin de qui entend mieux. Leur arrogance et leur ressassement se donnent l'alibi en béton d'une compréhension plus profonde."
Ces interprétations sont difficiles à déceler, chez les autres, et probablement encore plus chez soi (notamment à cause de l'entrée en jeu de l'orgueil). Il est pourtant important de le faire si l'on ne veut pas se transformer en sourd. Et pour revenir à l'intention initiale de ce billet, les inférences ne sont donc pas les jumelles des surinterprétations mais le terreau dans lequel ces dernières peuvent trouver leurs meilleures racines.
18:05 Publié dans Un peu de développement personnel | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook |
Facebook |
Les bras d'une fille
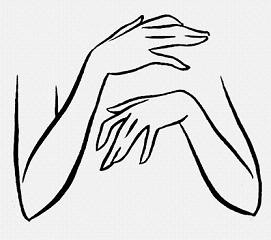
Ses bras tiennent l’enfant,
En une courbe attentive et reposée.
Leurs sourires s’échangent, leurs yeux se répondent,
Alimentent la brise qui court encore entre eux.
Puis celle-ci les quitte,
Porte jusqu’aux autres,
et les réchauffe à leur tour.
Un infini merci à Poipoipanda pour son magnifique dessin.
15:30 Publié dans Un peu de poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2005
Où l'on reparle de Finkielkraut
C'est amusant, il y a des moments comme ça où les évènements semblent se focaliser, se réunir autour d'un ventre chaud comme on se blottit autour du feu en hiver. Et ces temps-ci, c'est un peu Finkielkraut qui fait l'âtre. On en viendrait presque à croire qu'il pilote cette activité qui l'entoure, un peu à la façon d'un Sarkozy (ça y est, j'ai écris Sarkozy dans mon blog, je suis virtuellement (auto)-adoubé parmi les blogs d'actualité) hyperactif pour faire entendre parler de lui au moindre battement d'aile des papillons.
Hier c'était une déclaration de notre ministre de l'intérieur (vous avez vu, là je me retiens) qui se félicitait que l'on ait encore en France des philosophes commes Finkielkraut. Je me suis demandé toutefois si l'intéressé aurait vraiment ratifié la suite des propos de Sarkozy, et notamment son passage expliquant que c'était la bien-pensance qui avait porté le Front National à 24% (24%? c'était quand qu'ils ont fait ce score?) ce qui est pour le moins "rapide".
Quelques jours auparavant (samedi 4) un article très dur de Mona Chollet (via le Big Bang Blog) qui revient sur d'anciens écrits du philosophes et qui tente de démontrer que ses récentes déclarations n'ont rien d'étonnantes. Lecture intéressante, mais que je trouve tout de même caricaturale et teintée d'un a priori néfaste à une vraie analyse.
Et enfin aujourd'hui, une nouvelle interview (via Pierre Assouline) qui pourrait faire dresser les cheveux des blogueurs convaincus (et espérant) que leur outil est une révolution en passe de dérouter les médias traditionnels. C'est un avis que je partage peu car je crois qu'il surestime l'argement l'impact actuel d'Internet en France, même si je trouve tout de même que les blogs présentent, parfois, un grand intérêt dans leurs contenus et la possibilité de dialogue qu'ils offrent (sinon ça ferait longtemps que je ne serais plus ici).
P.S: je n'ai pas terminé ma lecture de La sagesse de l'amour mais espère vous livrer mes dernières notes sur celle-ci avant la fin de la semaine. Pfou, va falloir me mettre au boulot maintenant!
16:50 Publié dans Un peu du nombril des blogs | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook |
Facebook |



